-
Source : Libération IrlandePréface au « Procès de Burgos »
Texte de J.-P. Sartre écrit en 1971.
S’il faut en croire la presse, le procès de Burgos n’a fait un tel scandale que pour avoir mis en lumière la férocité absurde du régime franquiste. Je n’y crois pas : la sauvagerie fasciste a-t-elle tant besoin d’être démontrée? N’y avait-il pas eu, depuis 1936, des incarcérations, des tortures et des exécutions un peu partout sur le sol de la péninsule ibérique ? Ce procès a troublé les consciences, en Espagne et hors d’Espagne, parce qu’il a révélé aux ignorants l’existence du fait national basque ; il est apparu clairement que ce fait, bien que singulier, était loin d’être unique et que les grandes nations renfermaient des colonies à l’intérieur des frontières qu’elles s’étaient données. À Burgos, enchaînés et, pour ainsi dire, bâillonnés, les accusés, au prix d’une bataille de tous les instants, sont parvenus à faire le procès de la centralisation. Coup de tonnerre en Europe : pour ne prendre qu’un exemple, on enseigne aux petits Français que l’histoire de France n’est autre que celle de l’unification de toutes « nos » provinces, commencée sous les rois, poursuivie par la Révolution française, achevée au XIXe siècle.Il fallait, me disait-on quand j’étais à l’école, en être fier : l’unité nationale, réalisée chez nous de bonne heure, expliquait la perfection de notre langue et l’universalisme de notre culture. Quels que fussent nos partis pris politiques, il était interdit de la remettre en question. Sur ce point, socialistes et communistes se trouvaient d’accord avec les conservateurs : ils se jugeaient les héritiers du centralisme jacobin et, réformistes ou révolutionnaires, c’était à l’hexagone pris comme un tout indivisible qu’ils voulaient apporter les bienfaits du nouveau régime. Que l’absolutisme monarchique soit né tout à la fois du développement des voies et des moyens de communication, de l’apparition du canon et des exigences « mercantilistes » du capital marchand, que la Révolution et le jacobinisme aient permis à la bourgeoisie au pouvoir de poursuivre l’unification de l’économie en faisant sauter les dernières barrières féodales et ethniques et de gagner des guerres étrangères par une levée en masse de tous les habitants en âge de porter les armes sans souci de leur origine ethnique et que le XIXe siècle ait fini le job par l’industrialisation et ses conséquences (l’exode rural, la concentration et l’idéologie nouvelle ou nationalisme bourgeois), que l’unité présente soit, somme toute, l’effet du projet séculaire de la classe actuellement dominante et que celle-ci ait tenté de produire partout, de la Bidassoa à la frontière belge, le même type d’homme abstrait, défini par les mêmes droits formels – on est en démocratie ! – et les mêmes obligations réelles sans tenir compte de ses besoins concrets, personne aujourd’hui n’en a cure : c’est ainsi, voilà tout, on n’y touchera point.
D’où la stupeur de décembre 70 : le procès était infâme et absurde mais pouvait-on contester la validité des accusations portées contre les prisonniers sans, du même coup, tenir au moins en partie pour valables les objectifs que se propose l’E.T.A. ? Bien sûr, le gouvernement espagnol est fasciste ouvertement et cela brouillait les cartes : ce que visaient en claire conscience la plupart des protestataires, c’était le régime de Franco. Mais il fallait soutenir les accusés et l’E.T.A. ne disait-elle pas : nous ne sommes pas seulement contre le franquisme, nous luttons avant tout contre l’Espagne ? Telle était la pilule indigeste qu’il fallait avaler. Comment admettre que la nation basque existât de l’autre côté des Pyrénées sans reconnaître à « nos » Basques le droit de s’y intégrer ?
Et la Bretagne alors ? Et l’Occitanie ? Et l’Alsace ? Fallait-il récrire l’histoire de France à l’envers, comme le proposait récemment Morvan-Lebesque et voir dans Du Guesclin, héros du centralisme, un simple traître à la cause bretonne ? Le procès de Burgos attirait l’attention sur ce fait nouveau : la renaissance un peu partout de ces tendances que les gouvernements centraux ont pris coutume d’appeler « séparatistes ». En U.R.S.S. beaucoup de républiques, à commencer par l’Ukraine, sont travaillées par des forces centrifuges ; il n’y a pas si longtemps que la Sicile a fait sécession ; en Yougoslavie, en France, en Espagne, en Irlande du Nord, en Belgique, au Canada, etc., les conflits sociaux ont une dimension ethnique ; des « provinces » se découvrent nations et réclament plus ou moins ouvertement un statut national. On s’aperçoit que les frontières actuelles correspondent à l’intérêt des classes dominantes et non aux aspirations populaires, que l’unité dont les grandes puissances tirent tant d’orgueil cache l’oppression des ethnies et l’usage sournois ou déclaré de la violence répressive.
Le renforcement actuel des mouvements nationaux s’explique par deux raisons claires. En premier lieu, la révolution atomique. Morvan-Lebesque rapporte qu’un dirigeant autonomiste de Bretagne, apprenant l’explosion d’Hiroshima, s’était écrié : « Enfin le problème breton existe ! » Avant cela, en effet, le centralisme unificateur se justifiait et se renforçait en évoquant la menace que faisait peser sur le pays l’hostilité des pays voisins. Avec l’arme atomique, ce chantage n’est plus de saison : le centralisme de la guerre froide s’exerce à partir de Moscou et de Washington sur des nations et non plus sur des provinces. Du coup, dans la mesure où ces nations s’inquiètent d’appartenir à l’un ou l’autre bloc, d’autres nations plus petites et qu’on prétendait intégrées reprennent conscience de leur entité.
La deuxième raison, liée d’ailleurs à la première, je la trouve dans le processus de décolonisation qui s’est engagé après la dernière guerre mondiale sur trois continents. Imaginez un jeune homme né dans le Finistère allant, vers 1960, faire son service au Maghreb. Il s’agit, lui a-t-on dit, de prêter la main à une opération de simple police pour réprimer l’agitation folle et coupable de quelques départements français d’outre-mer. Or voici que les Français, battus, rempochent la division départementale, se retirent d’Algérie et lui reconnaissent le statut de nation souveraine. À quoi correspond, alors, pour le soldat démobilisé, le fait d’être un habitant du Finistère ? Il a vu, à Alger, que les départements sont des divisions abstraites qui cachaient là-bas la conquête par la force et la colonisation.
Pourquoi n’en serait-il pas de même de l’autre côté de la Méditerranée, dans ce qu’on appelle la « Métropole » ? Le Finistère – qui n’a d’existence réelle que pour l’administration – disparaît dans l’abstraction sous les yeux du jeune homme : celui-ci se sent Breton, rien de plus, rien de moins, et Français par droit de conquête. Va-t-il se résigner à être colonisé ? S’il en était tenté, l’exemple des Algériens et celui des Vietnamiens sont là pour le conduire à la révolte. Les victoires du Viêt-nam, surtout, lui apprennent que les colons avaient habilement limité le champ des possibles pour lui et ses frères.
On lui avait inculqué le défaitisme : Français, lui avait-on dit, il pouvait tout puisqu’il avait le droit de vote tout comme un Beauceron ; Breton, il ne pouvait pas même lever un doigt et sûrement pas se dresser contre le pouvoir central qui l’écraserait sur l’heure. Mais, en Indochine, quelques millions de paysans pauvres ont jeté les Français à la mer et luttent à présent victorieusement contre la plus grande puissance militaire du monde capitaliste : cela aussi, c’était impossible. Eh bien, non : le champ de ses possibles s’élargit d’un seul coup : si les puissances colonisatrices n’étaient que des tigres aux dents de papier ? Fission de l’atome et décolonisation, voilà ce qui exalte dans les « ethnies » conquises un patriotisme original. Cela, au fond, tout le monde le sait ; mais beaucoup, en France, en Espagne, au Canada pensent que cette volonté d’indépendance n’est qu’une velléité née de fausses analogies et que les mouvements séparatistes disparaîtront d’eux-mêmes.
Or l’exemple du Pays basque est là pour nous apprendre que cette renaissance n’est pas occasionnelle mais nécessaire et qu’elle n’aurait pas même eu lieu si ces prétendues provinces n’avaient eu une existence nationale qu’on a pendant des siècles tenté de leur ôter et qui, obturée, voilée par les vainqueurs, était demeurée là comme le lien historique et fondamental entre leurs habitants et si l’existence de ce lien, tacitement reconnu par le pouvoir central, ne rendait pas raison de la situation inférieure de l’ethnie conquise au sein du pays conquérant et, conséquemment, de la lutte farouche que celle-ci mène pour l’autodétermination.
Le fait basque, s’imposant à Burgos dans sa nécessité, n’a pas fini d’éclairer Catalans, Bretons, Galiciens, Occitaniens sur leur destinée. Je veux tenter ici d’opposer à l’universalité abstraite de l’humanisme bourgeois l’universalité singulière du peuple basque, de montrer quelles circonstances ont amené celui-ci par une dialectique inéluctable à produire un mouvement révolutionnaire et quelles conséquences théoriques on peut raisonnablement tirer de sa situation actuelle, c’est-à-dire quelle mutation profonde la décentralisation peut apporter dès aujourd’hui au socialisme centralisateur.
Si nous nous reportons à l’histoire, sans préjugé centraliste, il apparaît clairement que l’ethnie basque diffère en tout des ethnies voisines et qu’elle n’a jamais perdu conscience de sa singularité, marquée en tout cas par des caractères biologiques qu’elle a conservés intacts jusqu’à aujourd’hui et par l’irréductibilité d’euzkara, sa langue, aux langues indo-européennes. Dès le VIIe siècle, le duché de Vasconia groupe une population de montagnards qui inflige aux armées de Charlemagne la défaite de Roncevaux. Ce duché se transforme vers l’An Mille en un royaume de Navarre qui entre en déclin à partir du XIIe siècle et que l’Espagne annexe en 1575. Malgré la conquête et, sans doute aussi, à cause d’elle, la conscience basque – ou conscience d’être basque – se renforce. Il faut dire qu’on sort à peine de l’ère féodale et que la centralisation espagnole est encore hésitante : elle conserve aux vaincus certains droits qu’ils possédaient au Moyen-Âge, les fueros, qui demeureront longtemps le bastion de la résistance basque, que défend le peuple entier.
Que celui-ci ne se contentât pas de cette autonomie relative, qu’il rongeât son frein et n’ait pas perdu l’espoir de retrouver l’indépendance, c’est ce que prouve, au temps où Napoléon refaisait l’Europe, la proposition vainement faite à l’Empereur par un député de Biscaye : qu’il créât, à l’intérieur de l’Empire, un État basque indépendant. On sait la suite et que, la Constitution de 1812 ayant pratiquement supprimé les fueros, le mouvement nationaliste se fourvoya dans une aveugle tentative pour restaurer le passé : contre Isabelle II, plus libérale mais centralisatrice à la française, les forces populaires défendirent le prétendant absolutiste Don Carlos, autre passéiste mais qui, pour l’amour du passé, voulait restituer à la Navarre son autonomie féodale.
Deux guerres, deux défaites : en 1879, Euzkadi perd ses derniers privilèges et s’enlise dans un traditionalisme bigot qui tourne le dos à l’histoire. Il se réveillera six ans plus tard quand Sabino Arana fondera le P.N.B. (Parti nationaliste basque) qui réunira surtout des bourgeois et des intellectuels : il ne s’agit plus de militer pour l’absolutisme dans l’espoir de reconquérir les fueros mais le P.N.B., politiquement progressiste, puisqu’il réclame l’indépendance, et socialement conservateur, demeure en partie passéiste comme le prouve un de ses slogans : « Vieilles lois et souveraineté. » La résistance basque frappait à ce point les Espagnols qu’il y en eut plus d’un, à l’époque, pour proposer – comme l’anarchiste Pi y Margall – une solution fédéraliste aux problèmes de la péninsule.
Plus tard, pendant la République, le projet fut repris et le gouvernement central reconnut le principe de l’autonomie des régions à condition qu’il fût approuvé, dans un référendum, par 70% des populations concernées. La Haute Navarre, essentiellement rurale et de ce fait attachée au carlisme (les carlistes vont bientôt se battre aux côtés de Franco) vote contre l’autonomie ; les trois autres provinces votent pour, à une énorme majorité. Le gouvernement républicain, plus centraliste qu’il n’y paraissait, fait traîner les choses, sans bonne grâce, jusqu’en 36. S’il reconnaît enfin l’autonomie, à cette époque, c’est sous la pression des événements et pour des raisons essentiellement pratiques et même militaires : il s’agissait de se gagner le Pays basque et de s’assurer qu’il résisterait au putsch de Franco par la lutte armée.
Aussitôt le gouvernement basque est fondé : trois socialistes, deux libéraux, un communiste, ce qui montre à la fois que l’influence du P.N.B. s’étend aux couches sociales les plus diverses et qu’il assouplit un peu son conservatisme originel. Les troupes basques, jusqu’en avril 37, défendent farouchement le Guipuzcoa et la Biscaye. On sait la suite : Franco envoie des renforts, fait régner la terreur et bombarde Guernica : 1.500 morts ; au mois d’août, c’est la fin de la République d’Euzkadi. À la guerre succède la répression : emprisonnements, tortures, exécutions.
Le président Aguirre, chef du P.N.B., se réfugie en France ; pendant la Seconde Guerre mondiale, il joue la carte des démocraties, espérant que la chute de Hitler et de Mussolini serait suivie par celle de Franco. On mesure aujourd’hui quelles furent notre honte et sa naïveté : le P.N.B. avait joué son rôle : depuis 45, il ne cesse de décliner. En 47, pourtant – sans doute dans l’intention de mettre les Alliés au pied du mur – il déclenche une grève générale. Les Alliés ne bougent pas et laissent Franco briser la grève par une impitoyable répression. C’est la fin : le parti conserve en Euzkadi un prestige certain parce qu’il est le parti « historique » qui reste à l’origine de l’éphémère République basque. Mais il n’a plus la possibilité d’agir : ses moyens d’action ne correspondent plus à la situation. Les exilés vieillissent, Aguirre meurt. N’importe : nous verrons tout à l’heure comment l’E.T.A surgit à point nommé pour remplacer le vieux parti bourgeois. Ce bref résumé suffit à montrer qu’Euzkadi, ethnie récemment conquise par l’Espagne, a toujours refusé farouchement l’intégration. Si l’on faisait voter les Basques aujourd’hui, je laisse à penser à quelle écrasante majorité ils décideraient de l’indépendance.
Accepterons-nous pourtant de dire, comme l’E.T.A., que l’Euzkadi est une colonie de l’Espagne ? La question est d’importance car c’est dans les colonies que lutte des classes et lutte pour l’indépendance nationale se confondent. Or, dans le système colonialiste, les pays colonisés fournissent à bon compte des matières premières et des produits alimentaires à une métropole industrialisée : c’est que la main-d’œuvre y est sous-payée. Et l’on ne manquera pas de faire remarquer que le Pays basque, surtout dans ses provinces de Guipuzcoa et de Biscaye, est depuis le début de ce siècle en plein développement industriel. En 1960 la consommation d’énergie électrique par habitant et par an est de 2.088 kW dans les deux provinces, de 650 kW pour l’Espagne et la Catalogne. La production d’acier par habitant et par an est de 860 kg en Biscaye, de 450 en Euzkadi, de 45 en Espagne-Catalogne. La répartition de la population active, en Guipuzcoa, s’établit ainsi : secteur primaire 9,45 %, secteur secondaire 56,80 %, secteur tertiaire 33,75 % ; en Biscaye : 8,6%, 57,5% et 33,9% ; alors qu’en Espagne-Catalogne, le secteur primaire emploie 43,50 % des travailleurs, le secteur secondaire 27,20 % et le tertiaire 29,30 %.
Le gonflement considérable des deux derniers secteurs, joint au fait que, dans ces provinces, la population rurale est en constante diminution, montre assez l’énorme effort du Pays basque pour se donner une industrie. Le Guipuzcoa et la Biscaye sont, de ce point de vue, les régions pilotes de la péninsule ibérique. Ainsi l’on rencontrerait, si colonie il y avait, ce paradoxe que le pays colonisateur serait pauvre et surtout agricole au lieu que le pays colonisé serait riche et qu’il offrirait le profil démographique des sociétés hautement industrialisées.
À mieux y regarder, le paradoxe n’est qu’apparent : Euzkadi peut être prospère mais il ne compte que 2 millions d’habitants ; il en avait beaucoup moins en 1515 et, à cette époque, la population était rurale : la conquête s’est faite parce que les deux pays étaient de structure homogène et que l’un d’eux était beaucoup plus peuplé que l’autre. De l’autre côté de la Bidassoa, la Basse Navarre a été systématiquement pillée, ruinée, dépeuplée par le conquérant français : la colonisation est plus aisément visible. Il est clair que la léthargie de l’Espagne pendant les trente premières années du siècle a permis à l’Euzkadi-Sud de s’assurer une économie florissante de région, autour d’un pôle économique, Bilbao. Mais à qui profite cette économie ? Voilà la question. On peut y donner un semblant de réponse en disant qu’il n’est pas d’exemple qu’un pays conquis ne paye tribut à son conquérant. Mais il est plus sûr de consulter les données officielles. Elles nous apprennent que l’Espagne se livre à un véritable pillage fiscal du Pays basque. La fiscalité écrase les travailleurs ; elle est, en Guipuzcoa, la plus élevée de toute la péninsule.
II y a plus : dans toutes les provinces qu’il tient pour espagnoles, le gouvernement dépense plus qu’il ne perçoit en impôts : 150 % à Tolède ; 151 % à Burgos, 164 % à Avina, etc. Les deux provinces industrialisées du Pays basque paient au gouvernement étranger qui les exploite 4 milliards 338 millions 400 000 pesetas, l’État espagnol, par contre, dépense en Euzkadi 774 millions de pesetas. Il vole donc 3 milliards 500.000 pesetas environ pour entretenir le désert castillan. Encore faut-il ajouter que la majeure partie des 774 millions « rendus » vont aux organes d’oppression (administration espagnole ou espagnolisée, armée d’occupation, police, tribunaux, etc.) ou de débasquisation (l’université où l’on n’enseigne que la langue et la culture espagnoles). Or le problème de l’industrie basque est, avant tout, celui de la productivité : pour produire à des prix compétitifs sur le marché mondial, il faudrait importer des machines modernes : l’État espagnol, partiellement autarcique, s’y oppose ; quant au crédit madrilène, il est discriminatoire et favorise la Castille aux dépens de la Biscaye. Pour que Bilbao et Pasajes s’adaptent au trafic maritime et reçoivent des bateaux à fort tonnage, il faut les équiper à neuf : les travaux seraient considérables comme aussi ceux que réclament les ports de pêche. Rien n’est fait.
De même le réseau ferroviaire, installé autrefois par les Espagnols, est un lourd handicap : pour aller par le train de Bilbao à Vitoria il faut faire 137 kilomètres ; par la route 66. Mais l’administration et l’I.N.I. (Institut national de l’industrie), organe de l’État oppresseur, abritent des bureaucrates ignorants et tatillons, qui ne comprennent nullement les besoins du pays (en partie parce qu’ils le considèrent comme une province espagnole, au moins théoriquement) et empêchent les aménagements indispensables. Les produits non compétitifs, l’Espagne se réserve de les absorber. Elle fait la politique du tarif préférentiel à l’envers : en empêchant certains coûts de baisser, elle se donne le privilège de consommer les produits basques sans que les bénéfices du producteur en soient plus élevés. La conséquence est inévitable : le revenu per capita est un des plus hauts de la péninsule, ce qui ne veut rien dire ; et le revenu des salariés (85 % de la population active) est très inférieur à celui des Madrilènes, des habitants de Burgos, de Valence, etc. Il faut remarquer d’ailleurs que le taux d’augmentation des salaires a été, de 1955 à 1967, pour l’Espagne, de 6,3 % par an et pour Euzkadi de 4,15 %.
Ainsi, en dépit de la sur-industrialisation du pays, nous retrouvons deux composantes essentielles de la colonisation classique : le pillage – fiscal ou autre – du pays colonisé et la surexploitation des travailleurs. À cela s’ajoute une troisième qui n’est que la conséquence des deux premières : le rythme de l’émigration et de l’immigration. Le gouvernement espagnol a profité des besoins de l’industrialisation pour expédier en Euzkadi les sans-travail de ses régions démunies. On leur a promis des avantages (par exemple, ils sont prioritaires pour le logement) mais, surexploités comme les Basques et sans conscience de classe développée, ils constituent pour le patronat une masse de manœuvre : on compte 300 à 351.000 immigrants sur une population de 1.800.000 à 2 millions d’habitants. Inversement les Basques des régions pauvres émigrent. Tout particulièrement les Navarrais : on compte de 150.000 à 200.000 Basques à Madrid dont près de 100.000 Navarrais. Cette importante ponction et l’entrée des travailleurs espagnols dans les régions industrielles peuvent être considérées comme un début de déstructuration coloniale.
Cette politique constante du franquisme implique évidemment la complicité des grands patrons de Biscaye et de Guipuzcoa. Ceux-ci, en effet, dès les guerres carlistes, quand la haute bourgeoisie apparaît à Bilbao, étaient centralisateurs et libéraux. Depuis quelques années l’émigration des sièges sociaux des grandes entreprises à Madrid a commencé. La grosse bourgeoisie ne voit que des avantages au freinage de la modernisation par l’incompétence et l’autarcie espagnoles : le vaste marché d’Espagne absorbe les produits non compétitifs à l’échelle mondiale ; le patron est assuré d’un fort pourcentage de bénéfices sans être obligé à de gros investissements. Étrangers aux véritables intérêts de la nation, ces « collabos », dont le centralisme finirait par ruiner l’économie basque, s’excluent eux-mêmes de la communauté et jouent le rôle – classique, lui aussi – de ceux qu’on a nommés compradores.
En dernière analyse, en effet, et dans le cadre du système centralisateur, ils trouvent leur compte dans un certain malthusianisme. La conclusion est claire : en dépit des apparences, la situation d’un salarié basque est tout à fait semblable à celle d’un travailleur colonisé : il n’est pas simplement exploité – comme l’est un Castillan, par exemple, qui mène la lutte de classes « chimiquement pure». – mais délibérément surexploité puisque, à travail égal, son salaire est inférieur à celui d’un ouvrier espagnol. Il y a surexploitation du pays par le gouvernement central avec la complicité des compradores qui, sur la base de cette surexploitation consentie, exploitent les travailleurs.
La surexploitation ne profite pas aux capitalistes basques, simples exploiteurs surchargés d’impôts et protégés par une armée étrangère, elle ne profite qu’à l’Espagne, c’est-à-dire à une société fascisée, soutenue par l’impérialisme américain. Les classes travailleuses, toutefois, n’ont pas toujours conscience de la surexploitation et beaucoup de salariés songeaient, hier encore, à s’associer aux revendications et aux actions des ouvriers madrilènes ou de Burgos, ce qui les aurait conduits à un centralisme négatif. Il fallait leur faire comprendre que, dans le cas d’Euzkadi, la question économique et sociale se pose en termes nationaux : quand le pays ne paiera plus de tribut fiscal à l’occupant, quand ses vrais problèmes se formuleront et se régleront à Bilbao et à Pampelune plutôt qu’à Madrid, il pourra du même coup transformer librement ses structures économiques.
Car, il faut le répéter, les Espagnols surexploitent les Basques parce que ceux-ci sont basques. Sans jamais l’avouer officiellement, ils sont convaincus que les Basques sont autres, ethniquement et culturellement. Croit-on qu’ils ont perdu le souvenir des guerres carlistes, de la République de 1936, des grèves de 1947 ? S’ils n’en avaient gardé mémoire, mettraient-ils un tel acharnement à détruire la langue basque ? Il est clair qu’il s’agit ici d’une pratique coloniale : les Français pendant cent ans se sont efforcés de détruire la langue arabe en Algérie ; s’ils n’y sont pas parvenus, au moins ont-ils transformé l’arabe littéraire en une langue morte qu’on n’enseignait plus ; ils ont fait de même, avec des succès divers pour l’euzkara en Basse Navarre, pour le breton en Bretagne.
Ainsi, des deux côtés de la frontière, on essaie de faire croire à une ethnie tout entière que sa langue n’est qu’un dialecte en train d’agoniser. En Euzkadi-Sud on en interdit pratiquement l’usage. On défend d’établir des iskatolas, on a procédé à l’élimination des publications en euzkara, les écoles et l’Université enseignent la langue et la culture de l’oppresseur ; la radio, le cinéma, la télévision, les journaux expliquent en espagnol les problèmes de l’Espagne et font la propagande du gouvernement madrilène ; le personnel de l’administration est espagnol ou espagnolisé : on le recrute par des concours qu’organisent en espagnol des fonctionnaires madrilènes.
Par cette raison – c’est-à-dire parce que l’étranger l’a ainsi voulu – on dit amèrement à Bilbao : « La langue et la culture basques ne servent à rien. » Et la presse inspirée répète volontiers un mot malheureux d’Unamuno « La langue basque va bientôt mourir. » Cela ne suffit pas : dans les écoles, on punit les garçons qui parlent basque. Dans les villages, on tolère que les paysans s’expriment en euzkara. Mais qu’ils ne s’avisent pas de le faire à la ville : un des accusés de Burgos avait l’autorisation de recevoir dans sa prison les visites de son père ; cette autorisation lui fut retirée lorsqu’on s’aperçut que celui-ci ne lui parlait qu’en basque – non certes par provocation mais parce qu’il ne connaissait pas d’autre langue.
La suppression par force de la langue basque est un véritable génocide culturel : c’est une des plus vieilles langues d’Europe. Certes elle est apparue en un temps où l’économie du continent tout entier était rurale et si, par la suite, elle ne s’est pas adaptée souplement à l’évolution de la société, c’est parce que le conquérant espagnol en interdisait l’usage. Pour qu’elle devienne une langue du XXe siècle – ce qu’elle est partiellement déjà – il suffit qu’on la parle. L’hébreu en Israël, le breton à Quimper ont rencontré les mêmes difficultés et les ont résolues : les mêmes Israéliens qui peuvent discuter entre eux de l’informatique ou de la fission de l’atome lisent les manuscrits de la mer Morte comme nous lisons Racine ou Corneille, et Morvan-Lebesque note que le breton a des mots plus régulièrement formés pour désigner les réalités modernes que le français, langue « nationale ». Les ressources d’une vieille langue restée jeune parce qu’on l’a empêchée de se développer sont considérables. Si le basque redevenait l’idiome national d’Euzkadi, il apporterait, par ses structures propres, toutes les richesses du passé, une manière de penser et de sentir spécifique et s’ouvrirait largement au présent et à l’avenir. Mais ce que l’Espagnol veut faire disparaître avec celui-ci, c’est la personnalité basque.
Se faire basque, en effet, pour un habitant de Biscaye, c’est parler euzkara : non seulement parce qu’il récupère un passé qui n’est qu’à lui mais surtout parce qu’il s’adresse, même dans la solitude, à la communauté de ceux qui parlent basque. À Burgos, les dernières déclarations des « accusés » ont été faites en euzkara ; récusant le tribunal espagnol qui prétendait les juger et ne les comprenait même pas, ils convoquaient leur peuple tout entier dans la salle. À l’instant, il y fut, invisible. Le procès-verbal officiel note à ce propos que les accusés ont tenu des propos inintelligibles dans une langue « qui paraissait être du basque ». Merveilleux euphémisme : les juges n’y entendaient goutte mais savaient pertinemment de quoi il s’agissait ; pour éviter de paraître s’apercevoir que la nation de Vasconia avait envahi le prétoire, ils ont réduit le basque à n’être qu’une langue probable, si parfaitement obscure qu’on ne sait jamais si l’interlocuteur la parle vraiment ou s’il ne prononce pas des vocables dépourvus de sens.
Tel est donc le noyau de la culture d’Euzkadi et le plus grand souci des oppresseurs : s’ils parvenaient à la détruire, cette langue, le Basque serait l’homme abstrait qu’ils souhaitent et parlerait l’espagnol, qui n’est ni n’a jamais été sa langue ; mais, comme il ne cesserait pas pour autant d’être surexploité, il suffirait qu’il prenne conscience de la colonisation pour qu’euzkara ressuscite. Naturellement l’inverse aussi est vrai : parler sa langue pour un colonisé, c’est déjà un acte révolutionnaire.
Les Basques conscients d’aujourd’hui vont plus loin encore lorsqu’il s’agit de définir la culture qu’on leur donne et celle qu’ils veulent se donner. La culture, disent-ils, est la création de l’homme par l’homme. Mais ils ajoutent aussitôt qu’il n’y aura pas de culture universelle tant qu’on n’aura pas détruit l’oppression universelle. La culture officielle, en Euzkadi, est aujourd’hui universaliste en ceci qu’elle veut faire du Basque un homme universel, dépourvu de toute idiosyncrasie nationale, un citoyen abstrait semblable en tout point à un Espagnol, sauf en ceci qu’il est surexploité et ne le sait pas. En ce sens, elle n’a d’autre universalité que celle de l’oppression. Mais les hommes, pour opprimés qu’ils soient, n’en deviennent pas pour autant des choses : ils se font, tout au contraire, la négation des contradictions qu’on leur impose. Non d’abord par volonté mais parce qu’ils sont dépassement et projet. Ainsi des Basques qui ne peuvent manquer d’être d’abord la négation de l’homme espagnol qu’on a mis en chacun d’eux. Négation non pas abstraite mais minutieuse, au nom de tout ce qu’ils trouvent de singulier en eux-mêmes et dans leur environnement.
En ce sens la culture basque doit être aujourd’hui d’abord une contre-culture : elle se fera par la destruction de la culture espagnole, le refus de l’humanisme universaliste des pouvoirs centraux, l’effort considérable et constant pour se réapproprier la réalité basque qui est à la fois donnée sous les yeux – c’est aussi bien le paysage, l’écologie, les traits ethniques que la littérature en euzkara – et travestie par l’oppresseur en folklore innocent et périmé pour touristes étrangers. C’est pourquoi ils ajoutent cette troisième formule : la culture basque est la praxis qui se dégage de l’oppression de l’homme par l’homme en Pays basque. Cette praxis n’est pas tout de suite consciente de soi et voulue : c’est un travail quotidien, provoqué directement par l’absorption de la ration de culture officielle, pour retrouver le concret, c’est-à-dire non pas l’homme en général mais l’homme basque. Et ce travail, inversement, doit déboucher sur une praxis politique car l’homme basque ne peut s’affirmer dans sa plénitude que dans son pays redevenu souverain.
Ainsi, par une dialectique inexorable, la conquête, la centralisation et la surexploitation ont eu pour résultat de maintenir et d’exaspérer en Euzkadi la revendication de l’indépendance par les efforts mêmes que l’Espagne a faits pour la supprimer.
Nous pouvons tenter, à présent, de déterminer les exigences précises de cette situation concrète, c’est-à-dire la nature de la lutte qu’elle réclame aujourd’hui du peuple basque. Il existe, en effet, deux types de réponses à l’oppression espagnole, toutes deux inadéquates. Pour leur donner une chair et une figure, nous dirons que l’une est celle du P.C. d’Euzkadi et l’autre celle du P.N.B.
Le P. C. tient l’Euzkadi pour une simple dénomination géographique. Il prend ses ordres à Madrid, du P.C.E., et ne tient pas compte des réalités locales, en sorte qu’il demeure centraliste – entendons socialement progressiste et politiquement conservateur : il tente d’entraîner les travailleurs basques vers la lutte de classes « chimiquement pure ». C’est oublier qu’il s’agit d’un pays colonisé, c’est-à-dire surexploité. Le P. C. ne comprend pas – en dépit de quelques déclarations opportunistes en faveur de l’E.T.A. lors du procès de Burgos – que les actions qu’il propose ont des objectifs inadéquats et, du coup, sans portée.
Si les Basques se mettent à lutter contre l’exploitation pure et simple, ils abandonnent leurs propres problèmes pour aider les travailleurs espagnols à renverser la bourgeoisie franquiste. C’est se débasquiser soi-même et se borner à réclamer une société socialiste pour l’homme universel et abstrait, produit du capitalisme centralisateur. Et quand cet homme-là sera au pouvoir à Madrid, quand il possédera ses instruments de travail, les Basques peuvent-ils compter sur sa reconnaissance pour se voir octroyer l’autonomie ? Rien n’est moins sûr : on a vu que la République s’était fait tirer l’oreille ; et les pays socialistes sont, aujourd’hui, volontiers colonisateurs. Contre la surexploitation et la débasquisation qui en est la conséquence, les Basques ne peuvent combattre que seuls.
Cela ne veut pas dire qu’ils n’auront pas d’alliances tactiques avec d’autres mouvements révolutionnaires quand il s’agira d’affaiblir la dictature de Franco. Mais stratégiquement, il leur est impossible d’accepter une direction commune : leur lutte se fera dans la solitude car ils la mènent contre l’Espagne – et non contre le peuple espagnol – par la raison qu’une nation colonisée ne peut mettre fin à la surexploitation qu’en se dressant, souveraine, contre le colonisateur.
Inversement, le P.N.B. a tort de considérer l’indépendance comme une fin en soi. Formons, dit-il, une République basque d’abord ; nous verrons ensuite s’il y a lieu d’apporter des aménagements à notre société. Mais, si, par impossible, il parvenait à constituer un État basque de type bourgeois, il est vrai que la surexploitation espagnole prendrait fin mais il ne faudrait pas longtemps pour que cet État tombe sous le coup du capitalisme américain. Tant que la société garderait une structure capitaliste, on peut bien penser que les compradores se vendraient aux plus offrants : les capitaux étrangers submergeraient le pays, les États-Unis le gouverneraient par l’intermédiaire de la bourgeoisie locale, le néo-colonialisme succéderait à la colonisation et, pour être plus masquée, la surexploitation n’en subsisterait pas moins. Seule une société socialiste peut, non sans de grands risques, établir des relations économiques avec les nations capitalistes et socialistes par la raison qu’elle contrôle son économie rigoureusement.
L’insuffisance de ces deux réponses (P.C. – P.N.B.) montre bien qu’indépendance et socialisme sont, dans le cas d’Euzkadi, les deux faces d’une même médaille. Ainsi la lutte pour l’indépendance et la lutte pour le socialisme ne doivent faire qu’un. S’il en est ainsi, il va de soi que c’est à la classe ouvrière, de loin la plus nombreuse, nous l’avons vu, de prendre la direction du combat. Le travailleur manuel, en prenant conscience de la surexploitation, donc de sa nationalité, comprend du même coup sa vocation socialiste. Dirons-nous qu’il y est déjà parvenu ? C’est une tout autre affaire, dont nous reparlerons plus loin. D’autre part la situation d’un pays colonisé fait que, dans les classes moyennes, des groupes importants refusent la dépersonnalisation culturelle sans toujours se rendre compte des conséquences sociales qu’implique ce refus.
Ils sont, en principe, les alliés du prolétariat ; un mouvement révolutionnaire et conscient de sa tâche, dans une colonie, ne doit pas s’inspirer du principe « classe contre classe» qui n’a de sens que dans une métropole, mais, au contraire, accepter le principe de la petite-bourgeoisie et des intellectuels à la condition que les révolutionnaires issus des classes moyennes se rangent sous l’autorité de la classe ouvrière. On voit que le travail à faire, pour commencer, consiste en un éclaircissement progressif et double : le prolétariat doit prendre conscience de sa condition de colonisé et les autres classes, plus aisément nationalistes, doivent comprendre que le socialisme est, pour une nation colonisée, le seul accès possible à la souveraineté.
À ces raisons, qui ont fait évoluer en cent cinquante ans le Parti de l’indépendance et, changeant son recrutement, ont transformé sa réclamation passéiste de recouvrer les fueros au sein d’un État absolutiste en l’exigence, ouverte sur l’avenir, de construire une société souveraine et socialiste, il faut en ajouter une autre, propre à la péninsule ibérique, qui donne un caractère particulier à la lutte des Basques. En effet, l’unification centralisatrice, comme en Italie et en Allemagne, ne s’est achevée qu’au XXe siècle et, par cette raison, elle a pris la forme d’une dictature fasciste, c’est-à-dire d’une réponse par la violence nue et folle aux « séparatistes ». Dans deux de ces trois pays, le fascisme n’est plus au pouvoir ; Franco, lui, est resté le Caudillo de l’Espagne. C’est ce qu’exprimait un Basque qui disait devant moi : « Nous avons l’horrible chance du franquisme. »
Horrible, certes, dira-t-on ; mais pourquoi « chance » ? C’est que, si le régime espagnol était une démocratie bourgeoise, la situation serait plus ambiguë : le pouvoir temporiserait et, de fausses promesses en atermoiements, renverrait les « réformes » aux calendes. Cela suffirait, sans doute, pour créer chez les Basques une importante faction réformiste qui serait l’alliée du gouvernement oppresseur et n’attendrait de lui qu’un statut fédéraliste et octroyé. L’aveugle brutalité du franquisme a, dès 1937, dénoncé la sottise de l’illusion réformiste. À toute revendication exprimée, une seule réponse, aujourd’hui : la répression sanglante. Comment s’en étonner, puisque le régime est fait pour cela ? Mais il faut ajouter que ce régime est la vérité de l’Espagne colonisatrice.
Quelle que puisse être la forme du gouvernement espagnol, on sait que l’Espagne centralisée refuse profondément le « séparatisme » basque et qu’elle est prête, à la limite, à noyer toute révolte d’Euzkadi dans le sang. Les Espagnols, dans la mesure où ils sont eux-mêmes fabriqués par l’idéalisme centralisateur, sont des hommes abstraits et croient qu’il en va de même, à part une poignée d’agitateurs, pour les habitants de toute la péninsule. Le croient-ils de bonne foi ? Certes non : ils savent que l’Euzkadi existe mais veulent se le cacher ; c’est dire qu’ils enragent quand les Basques s’affirment et qu’ils vont jusqu’à les haïr en tant que Basques, c’est-à-dire en tant qu’hommes concrets. Plus profondément, les hommes au pouvoir n’ignorent pas que la fin du régime colonial en Euzkadi entraînerait aussitôt l’accroissement de la misère en Castille et en Andalousie. En sorte que même une République en viendrait en dernier recours à ce par quoi le franquisme a commencé.
La « chance » que représente pour les Basques le gouvernement de Franco, c’est qu’il montre sans fard la vraie nature du colonialisme : celui-ci ne discute pas ; il opprime ou il tue. Puisque la violence répressive est inévitable, il n’y a d’autre issue pour les colonisés que d’opposer la violence à la violence. La tentation réformiste étant hors de question, le peuple basque ne peut que se radicaliser : il sait, à présent, que l’indépendance ne s’obtiendra que par la lutte armée. Le procès de Burgos, sur ce point, est clair ; en affrontant les Espagnols, les « accusés » savaient ce qu’ils risquaient : l’emprisonnement, les tortures, l’exécution capitale. Ils le savaient et ils se battaient non dans l’espoir de jeter dehors tout de suite les oppresseurs mais pour contribuer à la constitution d’une armée clandestine. Si le P. N. B. est à son crépuscule, c’est faute d’avoir compris que, face aux troupes fascistes, les Basques n’ont d’autre issue que la guerre populaire. L’indépendance ou la mort : ces mots qui se disaient hier à Cuba, en Algérie, aujourd’hui c’est en Euzkadi qu’on les répète. La lutte armée pour un Euzkadi indépendant et socialiste, voilà l’exigence complète de la situation actuelle. C’est cela ou la soumission – qui est impossible.
De 1947 à 1959, cette exigence demeure vide et nue : rien, en apparence, ne vient la remplir : en vérité elle travaille la population basque, surtout les jeunes gens et, dès 1953, tout commence. E.K.I.N., fondé cette année-là, est un groupe d’intellectuels, encore peu conscients du véritable problème basque dans sa tragique simplicité mais comprenant la nécessité de recourir à une action nouvelle et radicale. II est bientôt contraint d’entrer au P.N.B., encore puissant bien que paralysé, mais s’y distingue par ses positions extrémistes au point que, peu de temps après, un des siens étant exclu pour « communisme », le groupe entier se solidarise avec lui et quitte le Parti nationaliste, convaincu désormais par expérience que la lutte entreprise par le vieux Parti, payante en 36, était tombée, depuis la fin de la guerre et la trahison des démocraties bourgeoises, au rang d’un pur verbalisme.
En 59, il est le noyau d’un nouveau parti, l’actuel E.T.A. Au départ, avant même d’avoir pris une position théorique, l’E.T.A. prend acte de deux tendances qui écartèlent le pays : la revendication nationaliste et la révolte ouvrière ; dès 60 il comprend, dans la pratique quotidienne, que les deux luttes doivent être associées, éclairées l’une par l’autre et menées conjointement par les mêmes organisations. C’est déchiffrer lentement mais sûrement et pratiquement les exigences de la situation présente. Il a pris les choses par le bon bout comme le prouvent les crises violentes qu’il traverse dans les années 60 : sa droite « humaniste » le quitte ; une gauche « universaliste » est exclue après l’avoir sommé d’abandonner la lutte anticolonialiste pour mener, avec les ouvriers espagnols, la lutte des classes « chimiquement pure ».
Ces départs définissent sa ligne mieux que n’eussent fait cent écrits théoriques. Après ces purges, dès 68, l’E.T.A. entreprend, malgré tout, de se définir théoriquement : à ce niveau, ses principes sont déjà donnés, ils se sont constitués dans la lutte interne du groupe contre sa droite et une certaine gauche centraliste et ne sont rien d’autre, d’ailleurs, que les exigences objectives de la situation, progressivement découvertes. L’E.T.A. organise alors quatre fronts de combat : front ouvrier, front culturel, front politique, front militaire qui fonctionnent en même temps et sous une direction commune mais restent distincts. Sur le front ouvrier, la lutte consiste en 69 dans une approche des travailleurs manuels, souvent réticents, et dans l’organisation d’un noyau d’avant-garde au sein de la classe ouvrière.
Sur le front culturel, l’E.T.A. mène l’attaque contre le « chaînon le plus fragile », qui est l’universalisme déshumanisant du gouvernement d’oppression : dès à présent, il a créé des iskatolas, écoles maternelles et primaires où l’enseignement se fait exclusivement en langue basque et que 15.000 enfants fréquentaient en 68-69 ; il a lancé une campagne d’alphabétisation pour adultes, créé des comités d’étudiants qui revendiquent activement (manifestations, grèves, occupations) la création d’une Université basque, lancé sur le pays des artistes basques (écrivains, chanteurs, peintres et sculpteurs) qui vont jusque dans les villages pour y faire des expositions et y donner des représentations (chansons populaires, théâtre dans la rue, bien connu chez nous sous le nom de théâtre direct) ; depuis 66 il a organisé des écoles sociales où le marxisme-léninisme est enseigné aux travailleurs.
Sur le front politique, qui est en étroite liaison avec le front militaire, l’E.T.A. politise le peuple basque tout entier en lui montrant le scandale de la répression. C’est ce qui explique le sens actuel de la lutte armée qui n’a point encore pour but de chasser l’oppresseur, mais de mobiliser les Basques pour la constitution progressive d’une armée clandestine de libération. La tactique actuelle peut se définir comme une spirale, dont les différents moments sont : action, répression, action, chaque action entraînant une répression plus sauvage qui montre à visage découvert le fascisme centralisateur et qui, ouvrant les yeux à des couches de plus en plus larges de la population, permet, à chaque fois, d’entreprendre une action plus importante. On ne peut donner un meilleur exemple de cette forme de lutte que l’enchaînement dialectique des événements qui trouve son aboutissement provisoire au procès de Burgos.
D’un bout à l’autre du processus l’E.T.A. a imposé son jeu et sort gagnante de l’épreuve : voilà qui démontre la valeur de sa tactique. Au commencement, pourtant, elle n’était pas présente : après les massacres de 36 et la répression de 37, la lourde paix franquiste tombe sur le Pays basque et l’écrase. Contre cette oppression répressive, nous avons vu le P.N.B. organiser une action : la grève de 47. Cette action sans portée réelle entraîne une répression terrible qui a pour résultat de disqualifier le P.N.B. Mais c’est justement à partir de cet échec que la nouvelle génération prend la relève et comprend la nécessité de passer à la lutte armée. L’E.T.A. marque son existence, dès 61, par une première action de type militaire : des bombes rudimentaires explosent un peu partout, on tente le sabotage d’un convoi ferroviaire. Cette dernière entreprise est manquée, faute d’expérience, mais elle entraîne une répression brutale : cent trente militants sont arrêtés. Ainsi le cycle infernal – action, répression, action – est mis en place. Pendant quelques années, pourtant, les « forces de l’ordre » sont gênées : l’E.T.A. est insaisissable, les attentats à la bombe se poursuivent sur tout le territoire.
Ce n’est qu’au printemps 68 que le Chef Supérieur de la Police peut publier un communiqué dans la presse de Bilbao : « La guerre chaude contre l’E.T.A. est déclarée. » De fait la chasse à l’homme commence, ce qui n’empêche pas quelques jours plus tard, une bombe d’éclater sur la grand-route, barrant le passage aux cyclistes du « Tour d’Espagne » (« qu’ils passent par ailleurs, ils n’ont rien à faire chez nous »). Au mois de juin, un garde civil est trouvé mort sur la chaussée. Quelques heures plus tard, d’autres gardes civils, à un barrage de route, tirent sans motif sur un « suspect » et le tuent. C’était Javier Echebarrieta, un des dirigeants de l’E.T.A. Aussitôt la répression s’étend de l’organisation clandestine à la population : partout l’administration interdit de célébrer des messes à la mémoire d’Echebarrieta et réussit le beau coup d’indigner les curés de village et d’indisposer les campagnes. Dès lors, la répression élargie appelle une riposte qui puisse exalter le peuple dans ses profondeurs : trois mois plus tard le policier Manzanas, figure sinistre et bien connue des Basques, qui torturait en Euzkadi depuis trente ans, sera exécuté devant la porte de son appartement.
Cette action déchaîne, comme prévu, une répression abjecte et sauvage ; surtout elle oppose franchement le peuple basque dans son ensemble et le gouvernement d’oppression. Celui-ci ne peut accepter que ses représentants soient liquidés : il est contraint de trouver des coupables, de faire un procès et de réclamer plusieurs condamnations à mort ; mais comme la « victime » était un bourreau, la majeure partie du pays ne peut désapprouver cette liquidation, qui n’est qu’un châtiment. Le pouvoir tombe dans une contradiction dont il ne sortira pas : selon son optique, dont il ne peut changer, il faut intimider par des sanctions. Mais la publicité du procès montre à tous qu’il s’agit d’une parodie de justice ; les accusés ont été choisis parmi les prisonniers au hasard ou, pour décapiter l’E.T.A., entre ceux qu’on croit en être les dirigeants ; dans ces conditions, l’instruction ne pouvait être qu’une farce bouffonne : il n’y avait, comme on verra, aucune preuve contre Izco qui, pourtant, sera condamné à mort.
Le tribunal est militaire alors que plusieurs des « accusés » avaient déjà été condamnés pour les mêmes faits ou des faits semblables par un tribunal civil. Les juges sont des officiers qui ignorent tout de la loi, un seul mis à part, qui doit avoir des connaissances juridiques pour conseiller ces soldats ; les avocats, sans cesse menacés de prison par le président peuvent difficilement se faire entendre. Les « accusés » enchaînés les uns aux autres, calmes et méprisants, ont livré une bataille de tous les instants, non pour se défendre contre les accusations de leurs oppresseurs mais pour révéler, devant les journalistes, les tortures qu’ils avaient subies : à quoi le président, quand il n’avait pu les faire taire, répondait inévitablement par un « No interesa ». Il devint évident pour les représentants de la presse que ces militaires ne s’étaient pas réunis pour juger mais pour tuer – en observant, toutefois, un cérémonial absurde et qu’ils connaissaient mal.
Les « inculpés », pour finir, mirent à nu la violence répressive de l’Espagne, en interdisant à leurs avocats de les défendre. Ils avaient gagné : leur admirable courage et l’obtuse bêtise de leurs « juges » avaient enfin fait de leur procès pour tous les Basques une affaire nationale. Lorsque, dans de grandes entreprises, à Bilbao, les travailleurs se mirent en grève, l’E.T.A. comprit qu’il avait touché de larges couches de la classe ouvrière. De plus, dans le monde entier, l’indignation fut si grande que, pour la première fois, la question basque est posée devant l’opinion internationale : Euzkadi s’est fait connaître partout comme un peuple martyr en lutte pour son indépendance nationale. Ultime action, née de la répression : la colère générale a fait reculer le gouvernement espagnol ; les peines de mort ont été commuées. L’E.T.A., par la réussite inespérée mais nécessaire de sa tactique, s’est affirmé dans son pays, comme l’aile marchande de la classe ouvrière. Il a, dans toute la nation mobilisée, acquis un prestige considérable, celui-là même qu’avait le P. N. B. vingt-cinq ans auparavant. Ses militants savent bien que la lutte sera longue, qu’il faudra, disent-ils, « vingt ou trente ans pour constituer l’armée populaire » ; n’importe, à Burgos, en décembre 70-janvier 71, le coup d’envoi a été donné.
Nous en sommes là : à nous, Français, qui sommes toujours un peu – même si nous ne le voulons pas – les héritiers des Jacobins, un peuple héroïque, conduit par un parti révolutionnaire, nous a fait entrevoir un autre socialisme, décentralisateur et concret : telle est l’universalité singulière des Basques, que l’E.T.A. oppose justement au centralisme abstrait des oppresseurs. Ce socialisme-là peut-il valoir pour tous ? N’est-il qu’une solution provisoire pour les pays colonisés ? En d’autres termes, peut-on envisager qu’il s’agit de la fin ultime ou d’une étape vers le moment où, l’exploitation universelle ayant pris fin, les hommes jouiront tous, au même titre, de l’universalité vraie, par un dépassement commun de toute singularité ? C’est le problème des colons. On peut être sûr que les colonisés, luttant pour leur indépendance, n’en ont aucun souci. Ce qui est certain, aux yeux des militants basques, c’est que le droit des peuples à l’autodétermination, affirmé dans sa plus radicale exigence, implique un peu partout la révision des frontières actuelles, résidus de l’expansion bourgeoise qui ne correspondent nulle part aux besoins populaires, ce qui ne peut se faire que par une révolution culturelle qui crée l’homme socialiste sur la base de sa terre, de sa langue et même de ses mœurs rénovées.
C’est à partir de là seulement que l’homme cessera peu à peu d’être le produit de son produit pour devenir enfin le fils de l’homme. Dirons-nous ces conceptions marxistes ? On note sur ce point quelques hésitations chez les dirigeants de l’E.T.A. puisque certains se disent « néo-marxistes » et d’autres – en majorité, semble-t-il – « marxistes-léninistes ». C’est l’expérience quotidienne de la lutte qui décidera. Guevara me disait un jour : «Nous, marxistes ? Je n’en sais rien. » Et il ajoutait, avec un sourire « Ce n’est pas notre faute si la réalité est marxiste. » Ce que l’E.T.A. nous révèle c’est le besoin qu’ont tous les hommes, même centralisateurs, de réaffirmer leurs particularités contre l’universalité abstraite : écouter les voix des Basques, des Bretons, des Occitaniens et lutter à leurs côtés pour qu’ils puissent affirmer leur singularité concrète, c’est, par voie de conséquence directe, nous battre aussi, nous, Français, pour l’indépendance véritable de la France, qui est la première victime de son centralisme. Car il y a un peuple basque et un peuple breton mais le jacobinisme et l’industrialisation ont liquidé notre peuple : il n’y a plus, aujourd’hui, que des masses françaises.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Nous poursuivrons - et conclurons - notre 'tour d'horizon' européen sur la question État/Nations/Luttes de classe, par l'exemple de notre voisin d'outre-Alpes, cher à notre cœur et, normalement, à celui de tous les révolutionnaires communistes : l'ITALIE ; l'Italie de Gramsci, de l'une des plus glorieuses Guerres partisanes antifascistes d'Europe et des rouges années 1970 avec Lotta Continua, les Brigades rouges et d'autres glorieux combattants rouges encore ; l'Italie de nos camarades du (nouveau) PCI et du PCmI que nous saluons...Il faut reconnaître qu'il n'est pas facile, là-bas, d'aborder avec des camarades du mouvement communiste la question "Italie : État/construction bourgeoise ou nation ?". Le sujet est sensible ; les esprits progressistes et révolutionnaires sont marqués par les sinistres exemples du séparatisme 'padan' fasciste de la Ligue du Nord (dans les années 1990, ralliée depuis au 'fédéralisme') ou du séparatisme sicilien piloté par la Mafia et la CIA à la fin des années 1940. L'Unification reste un mythe culturel progressiste important et le nom de Garibaldi, bien que le fascisme se réclamât lui aussi de son héritage, fut donné aussi bien à la Brigade italienne de la Guerre antifasciste d'Espagne qu'aux forces partisanes communistes (Brigades Garibaldi) qui luttèrent héroïquement contre le fascisme et le nazisme, dans le Nord du pays, entre 1943 et 1945. C'est pourtant, aussi, dans ce pays que la question a commencé à être le plus sérieusement abordée à l'époque de la 3e Internationale, avec le - sans doute - plus brillant intellectuel communiste ouest-européen de cette époque, Antonio Gramsci, lui-même né en Sardaigne. Celui-ci aborda notamment, en profondeur, la fameuse question méridionale, question structurelle dans l'organisation politique, économique et sociale de la péninsule ; prônant pour sa résolution une "République fédérale des ouvriers et des paysans" (il fut malheureusement arrêté à ce moment-là et jeté en prison, laissant son travail inachevé).
Qu'en est-il réellement ? Pour nous faire une idée précise, observons quelques cartes. Sur le plan culturel et linguistique, la carte ci-contre nous fait apparaître nettement :
 - de petites minorités nationales périphériques, qui ne sont globalement pas remises en cause par le mouvement communiste italien (contrairement à ce que peut être la situation en 'France') : dans l'arc alpin avec les Occitans du Piémont, les Arpitans du Piémont et du Val d'Aoste, les dialectes germaniques de quelques vallées des Alpes centrales et bien sûr du Sud-Tyrol, les langues rhéto-romanes (ladin, frioulan) et slaves (slovène) des Alpes orientales ; et puis bien sûr la nation SARDE de Gramsci, dans l'île de Sardaigne.
- de petites minorités nationales périphériques, qui ne sont globalement pas remises en cause par le mouvement communiste italien (contrairement à ce que peut être la situation en 'France') : dans l'arc alpin avec les Occitans du Piémont, les Arpitans du Piémont et du Val d'Aoste, les dialectes germaniques de quelques vallées des Alpes centrales et bien sûr du Sud-Tyrol, les langues rhéto-romanes (ladin, frioulan) et slaves (slovène) des Alpes orientales ; et puis bien sûr la nation SARDE de Gramsci, dans l'île de Sardaigne.- le Midi de la péninsule, véritable carrefour de la Méditerranée, a la particularité d'abriter de très nombreux 'îlots linguistiques' : albanais (ayant fui la domination ottomane) des Abruzzes à la Sicile en passant par la Calabre ; grecs dans les Pouilles et en Calabre ; croates en Molise ; l'on compte en outre (suite à des migrations au Moyen-Âge) quelques villages occitans dans les Pouilles et arpitans en Calabre. En Sardaigne, la ville d'Alghero et ses alentours parlent catalan. Au sud de la Sicile, plus proche d'ailleurs de la Tunisie que de celle-ci, l'île de Pantelleria parle un dialecte de type sicilien mais compte de nombreux noms de lieux arabes, car elle fut longtemps aux mains de ceux-ci. Son propre nom vient de Bent el-Riah, 'fille du vent'.
- mais enfin, dans le reste de l'État italien, l'on voit nettement se dessiner trois grands groupes de dialectes : un groupe au Nord (gallo-italique et vénitien), un groupe central (Toscane d'où vient l'italien littéraire, l'italien 'officiel' d'aujourd'hui, Ombrie, Marches, nord du Latium) et un groupe méridional ; l'on pourrait éventuellement ajouter un quatrième groupe 'extrême-méridional' (Sicile, sud de la Calabre et Salento - le sud des Pouilles).
Ces dialectes forment dans une large mesure un diasystème, c'est-à-dire qu'ils sont largement intercompréhensibles les uns avec les autres. Si une frontière linguistique (d'intercompréhension) doit passer, c'est sur une ligne allant de La Spezia à Rimini (au Nord, c'est la fameuse 'Padanie' de la Ligue du Nord d'Umberto Bossi...). D'une manière générale, depuis l'Unification de 1859-70, l'italien littéraire toscan s'est massivement imposé comme langue de communication à travers toute la péninsule, même si les dialetti restent, 'en famille' ou 'au village' et 'entre amis', largement plus connus et pratiqués (notamment par les jeunes générations) que dans l'entité 'France'.
De toute manière, comme chacun le sait, la communauté de langue et de culture ne 'suffit' pas à définir une nation : c'est un élément mais il en faut d'autres ; il existe des nations différentes parlant une même langue, comme les Anglais et les Américains ou les Brésiliens et les Portugais, et des nations qui sont des réalités subjectives incontestables (Bretagne, Écosse) tout en parlant plusieurs langues. Mais il est néanmoins possible de se demander s'il y a réellement une nation italienne ou si l'Italie ne forme pas, plutôt, un 'groupe' de nations 'sœurs'...
Sur le plan politique, comme nul(le) ne l'ignore, l'Italie fut unifiée une première fois dans l'Antiquité par Rome qui étendit ensuite son Empire (et sa langue, et sa culture) bien au-delà, à tout le pourtour méditerranéen et à une grande partie de l'Europe. Il n'était de toute façon pas possible de parler de nations au sens moderne - marxiste-léniniste - à cette époque. Peut-être qu'avec le haut niveau de forces productives atteint sous l'Empire romain, un début de mutation de l'économie mercantile vers le capitalisme (de marchandise->argent->marchandise vers argent->production/vente->plus d'argent) a pu commencer à développer des réalités approchantes ; mais dans tous les cas, tout cela a été balayé par les grands bouleversements qu'a connus l'humanité euro-méditerranéenne entre le 3e et le 8e siècle de l'ère chrétienne.
 Après la chute de l'Empire, l'Italie resta quelques temps unifiée sous le 'patriciat' des Ostrogoths ; et puis... elle ne forma JAMAIS PLUS une unité politique jusqu'au Risorgimento du 19e siècle. Le Nord fut le royaume des Lombards puis (avec Charlemagne) passa sous l'autorité des Francs, puis du Saint-Empire (royaume d'Italie) avant de se désintégrer (vers 1200) en une mosaïque de petits États princiers et de républiques aristocratiques (comme les 'républiques maritimes' de Gênes, Pise, Venise etc.), dont le royaume de 'France' et l'Empire germanique se disputèrent la tutelle (Guerres d'Italie) ; tandis que le Sud fut sous influence byzantine (6e-9e siècles) puis byzantine et arabe (en Sicile, 830-1091), puis normande (mais maintenant l'héritage politico-culturel arabe et byzantin pendant encore près de deux siècles) puis, après une brève parenthèse "française" (Charles d'Anjou, 1266-1282) se terminant par les "Vêpres siciliennes", arago-catalane et de là 'espagnole' (13e-18e siècles, les ambitions françaises ne se démentant cependant jamais depuis les Capétiens - Guerres d'Italie - jusqu'à la Révolution et Napoléon) ; et qu'au centre la Papauté construisait son État séculier depuis Rome jusqu'à l'embouchure du Pô en passant par l'Ombrie... Nous avons très clairement là la source de deux des grands aspects structurels de l'Italie contemporaine (en laissant de côté les questions nationales 'aux marges' de l'État) : le clivage Nord/Sud et l'influence politique du Vatican. Et il va de soi que cette division politique, avec les guerres et autres 'droits de passage' qu'elle entraînait, n'a pas vraiment facilité la communauté de vie économique productive qui est un autre élément essentiel de la construction nationale. Sur ce plan, l'on pourrait globalement distinguer un ensemble 'padan' bien délimité par les Alpes et l'Apennin (avec les régions 'particulières' que sont la Ligurie et la Vénétie) ; un ensemble 'toscano-romain' qui est l'Italie 'des arts et des lettres', du Quattrocento, l'Italie 'médicéenne' qui a donné sa langue à la construction 'nationale' ; et puis l'ancien royaume de Naples (ou des 'Deux-Siciles') qui est le fameux Mezzogiorno 'à problèmes' (plus la Sardaigne, longtemps 'espagnole' avant de devenir piémontaise au 18e siècle).
Après la chute de l'Empire, l'Italie resta quelques temps unifiée sous le 'patriciat' des Ostrogoths ; et puis... elle ne forma JAMAIS PLUS une unité politique jusqu'au Risorgimento du 19e siècle. Le Nord fut le royaume des Lombards puis (avec Charlemagne) passa sous l'autorité des Francs, puis du Saint-Empire (royaume d'Italie) avant de se désintégrer (vers 1200) en une mosaïque de petits États princiers et de républiques aristocratiques (comme les 'républiques maritimes' de Gênes, Pise, Venise etc.), dont le royaume de 'France' et l'Empire germanique se disputèrent la tutelle (Guerres d'Italie) ; tandis que le Sud fut sous influence byzantine (6e-9e siècles) puis byzantine et arabe (en Sicile, 830-1091), puis normande (mais maintenant l'héritage politico-culturel arabe et byzantin pendant encore près de deux siècles) puis, après une brève parenthèse "française" (Charles d'Anjou, 1266-1282) se terminant par les "Vêpres siciliennes", arago-catalane et de là 'espagnole' (13e-18e siècles, les ambitions françaises ne se démentant cependant jamais depuis les Capétiens - Guerres d'Italie - jusqu'à la Révolution et Napoléon) ; et qu'au centre la Papauté construisait son État séculier depuis Rome jusqu'à l'embouchure du Pô en passant par l'Ombrie... Nous avons très clairement là la source de deux des grands aspects structurels de l'Italie contemporaine (en laissant de côté les questions nationales 'aux marges' de l'État) : le clivage Nord/Sud et l'influence politique du Vatican. Et il va de soi que cette division politique, avec les guerres et autres 'droits de passage' qu'elle entraînait, n'a pas vraiment facilité la communauté de vie économique productive qui est un autre élément essentiel de la construction nationale. Sur ce plan, l'on pourrait globalement distinguer un ensemble 'padan' bien délimité par les Alpes et l'Apennin (avec les régions 'particulières' que sont la Ligurie et la Vénétie) ; un ensemble 'toscano-romain' qui est l'Italie 'des arts et des lettres', du Quattrocento, l'Italie 'médicéenne' qui a donné sa langue à la construction 'nationale' ; et puis l'ancien royaume de Naples (ou des 'Deux-Siciles') qui est le fameux Mezzogiorno 'à problèmes' (plus la Sardaigne, longtemps 'espagnole' avant de devenir piémontaise au 18e siècle).L'Italie ne se constitua pas, ni aux 13e-14e siècles ni plus tard, en grand État moderne (pour les raisons que vous lirez ci-dessous) ; sa construction comme État que nous connaissons actuellement est exclusivement le fruit de l'époque (finale) des révolutions bourgeoises, et encore : même la domination de la Révolution bourgeoise 'française' n'unifia pas la péninsule (il y avait des départements 'français' du Piémont jusqu'à Rome (!), une 'République cisalpine' puis 'Royaume d'Italie' au Nord et le royaume de Naples au Sud). Le Risorgimento, comme le libéralisme 'espagnol' de la même époque, fut typiquement à la fois un produit de l'influence de la Révolution bourgeoise 'française' et de la réaction (nationale) contre celle-ci.
L'INTÉRÊT, dans ce 'cas d'étude' italien, c'est que nous disposons en français (traduit par nos soins) d'un point de vue DIRECTEMENT ISSU du mouvement communiste de l'État en question : le chapitre 2 du Manifeste Programme de nos camarades du (nouveau) PCI. Cette analyse, il faut bien le dire, alors que nous traduisions le Manifeste Programme, a été pour nous FONDAMENTALE dans notre prise de conscience de la manière dont se sont construits, à la fois parallèlement et en contradiction, les grands États européens actuels et les nations qui les peuplent ; et de comment les révolutions bourgeoises dans la plupart de ces grands États européens ont été menées par une fraction dominante et géographiquement basée de la classe bourgeoise qui a (de ce fait) 'plié' à ses intérêts l'organisation sociale territoriale des États ainsi construits (contradiction Centre/Périphéries). Nous avons simplement étendu ensuite cette analyse, par analogie, à la construction de notre État 'France' et à la question nationale qui nous concerne, celle de l'Occitanie.
Nous offrons donc à votre lecture ce précieux document communiste :
2.1.1. La fondation et le contexte du mouvement communiste en Italie
 C’est en Italie qu’a commencé à se développer le mode de production capitaliste actuel, qui au cours des siècles suivants s’est étendu à toute l'Europe, et de celle-ci au monde entier.
C’est en Italie qu’a commencé à se développer le mode de production capitaliste actuel, qui au cours des siècles suivants s’est étendu à toute l'Europe, et de celle-ci au monde entier.Celui-ci se développa à partir de la petite production mercantile qui vivait à la marge et dans les plis du monde féodal, de la richesse monétaire concentrée dans les mains du clergé et des seigneurs féodaux, du luxe et du faste de l'Église et des cours féodales les plus avancées. Déjà, au XIe siècle, Amalfi et d’autres communes de la péninsule avaient développé une économie capitaliste à un niveau relativement élevé. La forme principale du capital était le capital commercial, que nous avons déjà décrit dans le chapitre 1.1.2 de ce Manifeste Programme. À partir de là, le développement du mode de production capitaliste se poursuivit durant quelques siècles dans diverses parties de la péninsule.
 Le développement du capitalisme fut, sur le plan politique, à la base des guerres qui sévirent du XIe au XVIe siècle dans la péninsule, entraînant la ruine de beaucoup de familles nobles et de cours féodales, et portant dans la péninsule un coup irrémédiable au système féodal. Dans le domaine culturel, il fut à la base de la foisonnante culture de l’époque et de l'influence que, pour la deuxième fois dans son histoire, l'Italie eut en Europe et dans le monde (78). La raison à la base des contradictions politiques et culturelles des XIe-XVIe siècles est la lutte entre le mode de production capitaliste naissant et le monde féodal qui opposait une résistance acharnée, d’autant plus qu’il trouvait du soutien et des ressources dans les relations avec le reste de l'Europe alors plus arriérée. Ce n’est qu’à la lumière de cette lutte que les différents épisodes de la vie politique et culturelle de l'époque cessent d'être une succession et une combinaison d'évènements fortuits et arbitraires, et qu’émerge le rapport dialectique qui les unit (79).
Le développement du capitalisme fut, sur le plan politique, à la base des guerres qui sévirent du XIe au XVIe siècle dans la péninsule, entraînant la ruine de beaucoup de familles nobles et de cours féodales, et portant dans la péninsule un coup irrémédiable au système féodal. Dans le domaine culturel, il fut à la base de la foisonnante culture de l’époque et de l'influence que, pour la deuxième fois dans son histoire, l'Italie eut en Europe et dans le monde (78). La raison à la base des contradictions politiques et culturelles des XIe-XVIe siècles est la lutte entre le mode de production capitaliste naissant et le monde féodal qui opposait une résistance acharnée, d’autant plus qu’il trouvait du soutien et des ressources dans les relations avec le reste de l'Europe alors plus arriérée. Ce n’est qu’à la lumière de cette lutte que les différents épisodes de la vie politique et culturelle de l'époque cessent d'être une succession et une combinaison d'évènements fortuits et arbitraires, et qu’émerge le rapport dialectique qui les unit (79).La Papauté a été la principale raison pour laquelle, dans la péninsule, ne s’est pas formée une vaste monarchie absolue, lorsqu’elles se formèrent dans le reste de l'Europe, au cours des XVe et XVIe siècles. Étant donnée la force qu’avait alors la Papauté, il était encore inconcevable qu’une unité étatique de la péninsule se construise en éliminant l'État Pontifical. D'une part, il ne convenait ni aux autres puissances européennes, ni à la Papauté que la péninsule soit unifiée politiquement sous la souveraineté du Pape. Pour les autres États européens, il était intolérable qu’un État combine l'autorité internationale de la cour pontificale avec les moyens politiques et économiques d'un État comprenant la péninsule entière.

D'autre part, pour se mettre à la tête d'un vaste pays, comprenant des régions économiquement et intellectuellement déjà très avancées dans le développement bourgeois, la Papauté aurait dû se transformer à l’image des autres monarchies absolues. Cette transformation l'aurait entraînée dans un destin analogue à celui des autres dynasties européennes. Cela était incompatible avec son rôle international et avec sa nature intrinsèquement féodale (80). Ainsi, les initiatives prises par les Papes pour se mettre à la tête de l’unification de la péninsule furent sporadiques et velléitaires.
Dans la péninsule, la lutte entre le mode de production capitaliste naissant et le vieux monde féodal connut un tournant au XVIe siècle.
Avec la Réforme protestante, la Papauté avait perdu et allait perdre son pouvoir sur de nombreux pays européens. Dans la péninsule, par la Contre-réforme, elle se mit avec décision à la tête des autres forces féodales, sortit victorieuse d'une lutte acharnée et imposa un nouveau système social.
Dans ce système, les institutions et les courants bourgeois étaient étouffés ou brimés, et les résidus féodaux (en premier lieu la Papauté) occupaient le poste de commandement. Il fut toutefois impossible de rayer d’un trait de plume tout ce qui s'était déjà produit. D’autant plus que les éléments, les institutions et les porte-paroles du développement bourgeois dans la péninsule (relations commerciales, économie monétaire, recherche scientifique, libertés individuelles, etc.) trouvaient des ressources dans les relations avec le reste de l'Europe, à présent plus avancé.
La Contre-réforme aspirait à être un mouvement international, elle ne pouvait donc pas couper tous les liens entre la péninsule et le reste de l'Europe. La Papauté elle-même, pour triompher, avait dû favoriser l'intervention des États européens dans la péninsule. Mais dans le reste de l'Europe, l'influence de la Contre-réforme fut soit nulle (dans les pays protestants, hostiles à la Papauté) soit atténuée (par les intérêts des monarchies absolues). Donc, le développement du capitalisme et de la société bourgeoise connexe continua et maintint son influence sur la péninsule entière. Là aussi continua donc, bien que dans des conditions différentes, la décadence des institutions et des relations féodales. Cependant, celles-ci étant à la direction du pays, leur décadence détermina alors la décadence du pays entier, décadence par rapport aux autres pays européens dont l'Italie ne se remit même pas avec le «Risorgimento» au XIXe siècle, et de laquelle elle ne s'est pas encore remise (d’où ce que l’on appelle ‘impérialisme pauvre’, ‘anomalie italienne’, etc.).
La victoire de la Contre-réforme bloqua dans la péninsule le développement des rapports de production capitalistes. Elle réprima et, de diverses manières, réduisit l'activité d'entreprise de la bourgeoisie. Elle la conduisit à renoncer en tout ou partie aux affaires et à se transformer en propriétaire terrienne même en maintenant sa résidence dans les villes. Par la réforme du clergé, et grâce aussi à la disparition du rôle politique propre des propriétaires terriens féodaux, elle renforça l'hégémonie de l'Église sur les paysans (81).
Elle établit le monopole de l'Église dans la direction spirituelle des femmes et dans l'éducation des enfants de toutes les classes. La séparation des activités manufacturières de l'agriculture, mise en œuvre par les capitalistes, fut interrompue. Les industries qui continuèrent à subsister et dans quelques cas même, avec difficulté, à se développer, ne purent avoir comme clients les paysans qui constituaient pourtant l'immense majorité de la population. La séparation économique entre la campagne et les villes fut accentuée.
Dans les grandes lignes, pendant les trois siècles qui suivirent, l'économie de la péninsule fut partout fondée sur une masse de paysans rejetés hors de l'activité mercantile : ils produisaient, de manière primitive et dans le cadre de rapports serviles, tout ce qui leur était nécessaire pour vivre et ce qu’ils devaient fournir aux propriétaires, au clergé et aux Autorités. Les propriétaires terriens, en grande partie citadins, les Autorités et le clergé, soit qu'ils le consommaient directement, soit qu’ils commerçaient dans les villes ou à l'étranger ce qu’ils extorquaient aux paysans, dans tous les cas le dilapidaient parasitairement (82).
Les villes avaient déjà et conservèrent une abondante population. Elle était composée de serviteurs, d'employés, de préposés aux services publics, de policiers, de soldats, de fainéants, de voleurs, de prostituées, d’artisans, d’intellectuels, d’artistes et de professionnels qui satisfaisaient, généralement rétribués en argent, aux besoins et aux vices des propriétaires terriens, des Autorités et du clergé. Les villes, en particulier dans le cas de Rome et de Naples, devinrent donc d’énormes structures parasitaires : elles consommaient ce que le clergé, les propriétaires terriens et les Autorités extorquaient aux paysans et ne leur donnaient rien en échange.
Politiquement, l'Italie resta divisée en plusieurs États. Chacun d'entre eux devint, toujours plus, une version arriérée et sur une moindre échelle des monarchies absolues du reste de l'Europe. Pendant trois siècles, de la première moitié du XVIe siècle à la première moitié du XIXe siècle, la péninsule fut dominée politiquement, successivement par la France, par l'Espagne et par l'Autriche, selon les équilibres qui se formaient ailleurs, entre les puissances européennes.
L'Italie constitue donc un exemple historique de comment, lorsqu’un pays a développé un mode de production supérieur, si la lutte entre les classes porteuses de l’ancien et du nouveau mode de production ne se conclut pas par une transformation révolutionnaire de la société entière, elle se conclut par la commune ruine des deux classes (83).
 L'Italie comme État unique et indépendant a été créée il y a un peu plus de 150 ans, entre 1848 et 1870, lorsque le royaume de la maison de Savoie fut étendu à la péninsule entière. La bourgeoisie qui dirigea l'unification a donné le nom de « Risorgimento » à cette période et à son œuvre. Par cette somptueuse dénomination, elle prétendit représenter dans l’imaginaire collectif la résurrection d'une nation qui n'avait jamais existé, l'œuvre de construction d'une nation (« faire les Italiens », disait réalistement Massimo D'Azeglio) qu'elle ne pouvait en réalité pas accomplir, parce que cela aurait demandé la mobilisation de la masse de la population.
L'Italie comme État unique et indépendant a été créée il y a un peu plus de 150 ans, entre 1848 et 1870, lorsque le royaume de la maison de Savoie fut étendu à la péninsule entière. La bourgeoisie qui dirigea l'unification a donné le nom de « Risorgimento » à cette période et à son œuvre. Par cette somptueuse dénomination, elle prétendit représenter dans l’imaginaire collectif la résurrection d'une nation qui n'avait jamais existé, l'œuvre de construction d'une nation (« faire les Italiens », disait réalistement Massimo D'Azeglio) qu'elle ne pouvait en réalité pas accomplir, parce que cela aurait demandé la mobilisation de la masse de la population.Le mouvement pour l'unité et l'indépendance fut l’effet et le reflet de l'évolution générale de l'Europe, avec laquelle la bourgeoisie de la péninsule et ses intellectuels avaient maintenu un lien étroit, malgré la Contre-réforme. Il fut en particulier un aspect du mouvement mis en marche par la Révolution française de 1789 et culminant dans la Révolution européenne de 1848. Celle-ci conduisit de fait à l'unité et à l'indépendance de l'Italie et de l'Allemagne, les pays sièges des deux institutions politiques les plus typiques du monde féodal européen : la Papauté et le Saint-Empire romain germanique.
Au milieu du XIXe siècle, le mode de production capitaliste s'était déjà pleinement développé en Angleterre, en Belgique, dans de vastes zones de la France et ailleurs. Il avait érigé l'activité industrielle en secteur économique autonome de l'agriculture, et en avait fait le centre de la production et de la reproduction des conditions matérielles d'existence de la société. Il avait conquis dans une certaine mesure aussi l'agriculture, avait déjà clairement développé l'antagonisme de classe entre prolétariat et bourgeoisie et commençait déjà à entrer dans l'époque impérialiste.
 Quelle était, dans la péninsule, la position des différentes classes, par rapport au processus auquel le mouvement européen les poussait ? L'unification politique de la péninsule et le développement capitaliste de son économie comportaient par la force des choses l'abolition de l'État Pontifical et donc, de toute manière, allaient au détriment du clergé et du reste des forces et des institutions féodales. Mais l'entrave n'était plus insurmontable. La Papauté avait touché le fond de sa décadence. Le soutien des puissances européennes s’était largement réduit. Le reste des institutions féodales avait suivi la Papauté dans sa décadence. Nombre de familles nobles restantes étaient déjà assimilées à la bourgeoisie ou subordonnées à elle par des hypothèques et d'autres liens.
Quelle était, dans la péninsule, la position des différentes classes, par rapport au processus auquel le mouvement européen les poussait ? L'unification politique de la péninsule et le développement capitaliste de son économie comportaient par la force des choses l'abolition de l'État Pontifical et donc, de toute manière, allaient au détriment du clergé et du reste des forces et des institutions féodales. Mais l'entrave n'était plus insurmontable. La Papauté avait touché le fond de sa décadence. Le soutien des puissances européennes s’était largement réduit. Le reste des institutions féodales avait suivi la Papauté dans sa décadence. Nombre de familles nobles restantes étaient déjà assimilées à la bourgeoisie ou subordonnées à elle par des hypothèques et d'autres liens.La bourgeoisie italienne ne pouvait rester étrangère au mouvement européen qu'au prix de ses propres intérêts, lésée par la bourgeoisie des pays voisins qui était déjà entrée dans une phase d'expansion au-delà de ses frontières nationales. La bourgeoisie italienne avait donc tout à gagner à l'unification et à l'indépendance, mais le système social fixé par la Contre-réforme opposait directement une grande partie de celle-ci aux paysans. La population bariolée des villes dépendait économiquement du parasitisme des classes dominantes : elle était donc incapable d'un mouvement politique propre. Le prolétariat dans le sens moderne du terme était encore faible numériquement, et plus encore politiquement : il était donc exclu qu'il prenne la direction du mouvement. À Milan, où elle était la plus développée, la classe ouvrière fut la force principale de la révolution du 18 mars 1848, éleva les barricades et paya de sa personne, mais ce fut la bourgeoisie qui récolta les fruits de cette révolution là-aussi.
Pour les paysans qui, au XIXe siècle, constituaient encore la plus grande partie de la population de la péninsule, les problèmes prioritaires étaient la possession de la terre et l'abolition des vexations féodales restantes. Ils étaient cependant dispersés, disposés à se laisser entraîner dans des révoltes chaque fois que d'autres en créaient l'occasion, mais intrinsèquement incapables de développer une direction propre, indépendante du reste de la bourgeoisie et du clergé.
 Le résultat de ces intérêts de classe contradictoires, fut que le mouvement pour l'unification et l'indépendance de la péninsule fut dirigé par l'aile conservatrice de la bourgeoisie, les modérés de la Droite dirigée par Cavour, sous le drapeau de la monarchie de Savoie. Celle-ci réussit à faire travailler à son service l'aile révolutionnaire et populaire de la bourgeoisie, la Gauche dont les représentants les plus illustres furent Mazzini et Garibaldi. Celle-ci, en effet, ne voulut pas se mettre à la tête des paysans. Le mouvement paysan, pour la terre et pour l'abolition révolutionnaire des vexations féodales restantes, chercha à s'imposer au cours de la lutte pour l'unification politique de la péninsule, mais il fut justement écrasé par la bourgeoisie en lutte pour l'unification et l'indépendance de la péninsule.
Le résultat de ces intérêts de classe contradictoires, fut que le mouvement pour l'unification et l'indépendance de la péninsule fut dirigé par l'aile conservatrice de la bourgeoisie, les modérés de la Droite dirigée par Cavour, sous le drapeau de la monarchie de Savoie. Celle-ci réussit à faire travailler à son service l'aile révolutionnaire et populaire de la bourgeoisie, la Gauche dont les représentants les plus illustres furent Mazzini et Garibaldi. Celle-ci, en effet, ne voulut pas se mettre à la tête des paysans. Le mouvement paysan, pour la terre et pour l'abolition révolutionnaire des vexations féodales restantes, chercha à s'imposer au cours de la lutte pour l'unification politique de la péninsule, mais il fut justement écrasé par la bourgeoisie en lutte pour l'unification et l'indépendance de la péninsule. À cause de sa contradiction d'intérêts avec les paysans, la bourgeoisie unitaire dut renoncer à mobiliser la masse de la population de la péninsule pour améliorer ses conditions matérielles, intellectuelles et morales. Elle renonça donc aussi à établir son hégémonie, sa direction morale et intellectuelle sur la masse de la population. Cette réforme morale et intellectuelle de masse était cependant nécessaire pour un développement important du mode de production capitaliste. Mais l'intention de la réaliser se réduisit à des tentatives et efforts velléitaires de groupes bourgeois marginaux. Seule la mobilisation en masse de la population pour améliorer ses conditions pouvait en effet créer une nouvelle morale indépendante de la religion, qui tirait ses principes, ses critères et ses règles des conditions pratiques d'existence des masses mêmes.
L'histoire unitaire de notre pays est marquée dans tous ses aspects par ce développement, dans le Sud et dans les zones de montagne du Centre et du Nord plus qu'ailleurs. Ce fut le mouvement communiste naissant, avec ses ligues, ses mutuelles, ses coopératives, ses cercles, ses syndicats, ses bourses du travail, son Parti qui, dès l'époque du Risorgimento et ensuite, assuma le rôle de promoteur de l'initiative pratique des masses populaires et donc, également, de leur émancipation d'une conception superstitieuse et métaphysique du monde, et de leur émancipation de préceptes moraux qui dérivent de conditions sociales d'autres temps.
Pas à pas se forma une avant-garde de travailleurs. Ceux-ci, au fur et à mesure qu'ils se libéraient de la fange du passé (soutenue par la force et le prestige de l'État, de l'Église et des autres Autorités et organisations parallèles de la classe dominante), avec des limites, des erreurs et des hésitations mais aussi avec ténacité, héroïsme et continuité, plutôt que d’utiliser la libération en termes d'émancipation et de carrières personnelles, s’organisèrent pour multiplier leurs forces, et répandre plus largement encore la réforme intellectuelle et morale nécessaire
 pour mettre fin à la décadence inaugurée par la Contre-réforme. Une telle réforme est en fait, encore aujourd’hui, nécessaire pour sortir du marasme dans lequel la domination de la bourgeoisie impérialiste a mené notre pays, pour construire une Italie communiste.
pour mettre fin à la décadence inaugurée par la Contre-réforme. Une telle réforme est en fait, encore aujourd’hui, nécessaire pour sortir du marasme dans lequel la domination de la bourgeoisie impérialiste a mené notre pays, pour construire une Italie communiste. En devant réaffirmer l'asservissement et l'exploitation de la masse des paysans, la bourgeoisie unitaire dut s'appuyer sur l'Église qui depuis longtemps assurait les conditions morales et intellectuelles de cet asservissement, et évitait donc qu'il soit nécessaire de recourir en permanence à la contrainte des armes et aux autres moyens coercitifs de l'Etat.
La bourgeoisie réduisit au minimum indispensable les transformations qu’elle imposa à l'Église. Elle assuma la défense d'une grande partie des intérêts et des privilèges du clergé et paya, sous diverses formes, un rachat pour ceux que par la force de choses elle dut abolir. Elle assura en outre aux fonctionnaires, aux notables et aux dignitaires des anciens États le maintien des apanages, des privilèges et dans beaucoup de cas, même, des fonctions dont les anciens gouvernements les avaient dotés. Elle endossa pour le nouvel État les dettes contractées par les États supprimés. Enfin là où, avec le concours de l'Église et avec les forces ordinaires de son État, elle ne pouvait pas assurer la répression des paysans, elle la délégua à des Forces Armées locales (mafia sicilienne et organisations semblables), sous la haute protection et la supervision de son État (84).
En résumé, à cause de sa contradiction d'intérêts avec les paysans, la bourgeoisie unitaire ne pouvait pas balayer les forces féodales restantes: la Papauté, son Église, la monarchie, les grands propriétaires fonciers agraires et les autres institutions, sectes, ordres, congrégations et sociétés secrètes du monde féodal. Elle opta pour leur intégration graduelle dans la nouvelle société bourgeoise. C’est effectivement ce qui advint. Mais celles-ci, en s’intégrant, ont à leur tour marqué et pollué à perpétuité les principaux aspects politiques, économiques et culturels de la formation socio-économique bourgeoise italienne. Les bourgeois italiens sont restés au milieu de la route, entre leur rôle de « fonctionnaires du capital », voués à investir le profit extorqué aux travailleurs pour augmenter ultérieurement la production, et les habitudes du clergé et des autres classes dominantes féodales,
 vouées à employer pour leur luxe et leur faste ce qu’elles extorquent aux travailleurs. Telle est la base de l'’anomalie italienne’, de la spécificité que la bourgeoisie italienne présente par rapport à la bourgeoisie des autres pays européens : sa - tant déplorée - insuffisante propension à l'investissement productif, à la recherche, au risque, etc. (82)
vouées à employer pour leur luxe et leur faste ce qu’elles extorquent aux travailleurs. Telle est la base de l'’anomalie italienne’, de la spécificité que la bourgeoisie italienne présente par rapport à la bourgeoisie des autres pays européens : sa - tant déplorée - insuffisante propension à l'investissement productif, à la recherche, au risque, etc. (82)Le Risorgimento fut donc un mouvement anti-paysan. Les paysans, c'est-à-dire l'immense majorité des travailleurs de la péninsule, n'eurent non seulement ni la terre ni l'abolition des vexations féodales restantes, mais ils durent supporter, en plus des obligations envers les anciens propriétaires, les nouvelles charges établies par le nouvel État : impôts et service militaire. Par conséquent, le Risorgimento provoqua parmi les paysans un état endémique de rébellion. Pendant des années, ils formèrent partout une masse de manœuvre pour ceux qui, dans les rangs de la noblesse et du clergé, s'opposaient à l'unification de la péninsule ou, plus concrètement, faisaient chanter les Autorités du nouvel État par la menace de mobiliser les paysans contre elles (85). Ce rôle des paysans ne diminua que lorsque, et dans la mesure où, la classe ouvrière établit sa direction sur leur mouvement de rébellion contre les conditions intolérables auxquelles la bourgeoisie unitaire les avait réduits, et les intégra dans le mouvement communiste.
 Le Risorgimento ne fut pas directement une révolution dans les rapports sociaux. Il instaura cependant dans la péninsule une organisation politique différente (l'unification politique) et détermina une insertion différente de celle-ci dans le contexte politique et économique européen. La bourgeoisie unitaire ouvrit la voie à une série de transformations et d'œuvres (réseau de communication routier et ferroviaire, système scolaire national, Forces Armées et de police, développement industriel et scientifique, système hospitalier et d’hygiène publique, travaux publics, appareil et frais de représentation de l'État, etc.) qui modifièrent les rapports de production que la Contre-réforme avait fixés. Avec le renforcement général des relations commerciales et capitalistes et avec l'expansion des travaux publics, le marché des terres reçut une grande impulsion. La terre devint un capital, et son rendement fut confronté avec celui des capitaux investis dans les autres secteurs (86). Ceci et le développement des échanges internes et internationaux transformèrent toujours plus les rapports, dans les campagnes, entre propriétaires et paysans en rapports mercantiles et capitalistes. L'expulsion massive des paysans du travail agricole qui s’ensuivit, le recrutement de paysans pour les travaux publics, l'émigration à l'étranger, le développement industriel dans les villes du Nord et les migrations internes changèrent la composition de classe du pays.
Le Risorgimento ne fut pas directement une révolution dans les rapports sociaux. Il instaura cependant dans la péninsule une organisation politique différente (l'unification politique) et détermina une insertion différente de celle-ci dans le contexte politique et économique européen. La bourgeoisie unitaire ouvrit la voie à une série de transformations et d'œuvres (réseau de communication routier et ferroviaire, système scolaire national, Forces Armées et de police, développement industriel et scientifique, système hospitalier et d’hygiène publique, travaux publics, appareil et frais de représentation de l'État, etc.) qui modifièrent les rapports de production que la Contre-réforme avait fixés. Avec le renforcement général des relations commerciales et capitalistes et avec l'expansion des travaux publics, le marché des terres reçut une grande impulsion. La terre devint un capital, et son rendement fut confronté avec celui des capitaux investis dans les autres secteurs (86). Ceci et le développement des échanges internes et internationaux transformèrent toujours plus les rapports, dans les campagnes, entre propriétaires et paysans en rapports mercantiles et capitalistes. L'expulsion massive des paysans du travail agricole qui s’ensuivit, le recrutement de paysans pour les travaux publics, l'émigration à l'étranger, le développement industriel dans les villes du Nord et les migrations internes changèrent la composition de classe du pays.Non seulement, donc, les masses paysannes ne furent pas mobilisées pour transformer leur condition, mais elles subirent, à travers des péripéties et des souffrances inénarrables, la transformation que la bourgeoisie leur imposait par la force de ses rapports économiques et de son État. L'Italie devint
 malgré tout un pays impérialiste. Dès lors, parler de « terminer la révolution bourgeoise » en Italie, dans un sens différent de celui valant pour tout autre pays européen, et aller pêcher les « résidus féodaux » pour soutenir une telle ligne, est devenu le drapeau de l'opportunisme renonçant à l'unique transformation ultérieure que le mouvement communiste pouvait et devait accomplir dans notre pays : la révolution socialiste (87).
malgré tout un pays impérialiste. Dès lors, parler de « terminer la révolution bourgeoise » en Italie, dans un sens différent de celui valant pour tout autre pays européen, et aller pêcher les « résidus féodaux » pour soutenir une telle ligne, est devenu le drapeau de l'opportunisme renonçant à l'unique transformation ultérieure que le mouvement communiste pouvait et devait accomplir dans notre pays : la révolution socialiste (87).La révolution bourgeoise anti-paysanne est à l’origine de la naissance de la « question paysanne ». Celle-ci ne fut résolue que dans les vingt années suivant la Seconde Guerre mondiale, par l'élimination des paysans. Mais elle est également à l’origine de la « question méridionale », de la « question vaticane », du rôle politique et social d'organisations armées territoriales semi-autonomes de l'État central comme la mafia sicilienne, et d'autres caractéristiques spécifiques de la bourgeoisie italienne qui persistent encore aujourd’hui.
2.1.1.1. La révolution bourgeoise inachevée
Avec l'unification, la bourgeoisie maintint en vie beaucoup des vieilles institutions, relations et habitudes féodales avec leur localisme, en se contentant de leur superposer les organismes du nouvel État. Elles ne furent que progressivement absorbées dans la nouvelle société bourgeoise.
Ainsi fut longtemps conservée la diversité sociale des différentes régions et, en partie, celle-ci demeure toujours, bien que dans les vingt années suivant la Seconde Guerre Mondiale, la masse des paysans ait été expulsée des campagnes et que des millions de personnes aient été forcées à migrer du Sud au
 Nord et du Nord-Est au Nord-Ouest. Là est la raison pour laquelle en Italie, les contradictions entre classes et les contradictions entre secteurs productifs sont régulièrement devenues des contradictions territoriales et ont mis en danger l'unité de l'État (mouvements fédéralistes et sécessionnistes). La question de la grande industrie a été, pendant des décennies, principalement la question de la Lombardie, du Piémont et de la Ligurie ; la question de la petite et moyenne entreprise a été principalement la question de la Vénétie et de l'Emilie-Romagne ; la question du latifundium, de la petite production avec son monde bariolé de petits patrons, de travailleurs autonomes et salariés, de semi-prolétariat et d’emploi public, a été principalement la question des régions méridionales (88). Les caractères spécifiques des différentes régions et zones demeurent en partie et le mouvement communiste doit en tenir compte, aujourd'hui dans la lutte pour instaurer le socialisme et demain dans le système que la révolution socialiste instaurera. En particulier, nous devons appuyer et favoriser par principe les mouvements nationaux (Sardaigne, Sud-Tyrol, etc.) : indépendamment de la capacité des petites nations à s'élever effectivement à la vie autonome, leur mouvement est aujourd'hui un aspect important de la lutte des masses populaires contre la bourgeoisie impérialiste, pour la défense et l'élargissement de leurs droits démocratiques.
Nord et du Nord-Est au Nord-Ouest. Là est la raison pour laquelle en Italie, les contradictions entre classes et les contradictions entre secteurs productifs sont régulièrement devenues des contradictions territoriales et ont mis en danger l'unité de l'État (mouvements fédéralistes et sécessionnistes). La question de la grande industrie a été, pendant des décennies, principalement la question de la Lombardie, du Piémont et de la Ligurie ; la question de la petite et moyenne entreprise a été principalement la question de la Vénétie et de l'Emilie-Romagne ; la question du latifundium, de la petite production avec son monde bariolé de petits patrons, de travailleurs autonomes et salariés, de semi-prolétariat et d’emploi public, a été principalement la question des régions méridionales (88). Les caractères spécifiques des différentes régions et zones demeurent en partie et le mouvement communiste doit en tenir compte, aujourd'hui dans la lutte pour instaurer le socialisme et demain dans le système que la révolution socialiste instaurera. En particulier, nous devons appuyer et favoriser par principe les mouvements nationaux (Sardaigne, Sud-Tyrol, etc.) : indépendamment de la capacité des petites nations à s'élever effectivement à la vie autonome, leur mouvement est aujourd'hui un aspect important de la lutte des masses populaires contre la bourgeoisie impérialiste, pour la défense et l'élargissement de leurs droits démocratiques.  L'Église fut la principale bénéficiaire du caractère anti-paysan du Risorgimento. La bourgeoisie ne mena pas avec énergie et, par sa nature même, ne pouvait pas mener avec succès, une action pour éliminer ou au moins réduire l'hégémonie morale et intellectuelle que l'Église avait sur les paysans, sur les femmes et sur une partie de la population urbaine. Son initiative fut presque nulle sur le plan moral, sur le plan du comportement individuel et social, pour promouvoir une morale adaptée aux conditions de la société moderne. La bourgeoisie renonça à formuler et à promouvoir en termes de morale (c’est à dire de principes et de règles régissant le comportement individuel) le système de relations sociales (de la société civile) que son État défendait par la violence et exprimait en termes juridiques dans sa législation.
L'Église fut la principale bénéficiaire du caractère anti-paysan du Risorgimento. La bourgeoisie ne mena pas avec énergie et, par sa nature même, ne pouvait pas mener avec succès, une action pour éliminer ou au moins réduire l'hégémonie morale et intellectuelle que l'Église avait sur les paysans, sur les femmes et sur une partie de la population urbaine. Son initiative fut presque nulle sur le plan moral, sur le plan du comportement individuel et social, pour promouvoir une morale adaptée aux conditions de la société moderne. La bourgeoisie renonça à formuler et à promouvoir en termes de morale (c’est à dire de principes et de règles régissant le comportement individuel) le système de relations sociales (de la société civile) que son État défendait par la violence et exprimait en termes juridiques dans sa législation.Le peu que la bourgeoisie fit, avec l'école publique, eut des effets limités car ne concerna que l'école fréquentée par une minorité des nouvelles générations. L'analphabétisme, l'influence de l'Église dans les écoles inférieures, spécialement dans les campagnes, et la permanence d’un vaste système de collèges et d’écoles gérées par le clergé prolongèrent l'hégémonie de l'Église dans la formation intellectuelle et morale des nouvelles générations. L'État se limita à former les candidats à la couche supérieure de la classe dominante : celle-ci, par la force des choses, pour être un tant soit peu à la hauteur de ses tâches, devait avoir une formation intellectuelle et morale différente de celle qu’à travers l'Église, la bourgeoisie imposait aux classes populaires et aux femmes en général.
 Non seulement manquèrent totalement, dans le Risorgimento et dans les décennies suivantes, la mobilisation en masse de la population pour améliorer ses conditions économiques, l’instruction, les conditions hygiéniques et sanitaires etc., et pour promouvoir tous les autres aspects de l'initiative de masse, que seule une révolution paysanne et la confiance en soi confortée par les résultats auraient développé chez des millions d'individus ; mais il y eut même un effort conjoint de l'Église, de l'État et d'une grande partie de la classe dominante pour mortifier, réprimer et décourager l'initiative pratique et, par-dessus, l'émancipation morale et intellectuelle de la masse des hommes et des femmes. L'émigration de la campagne vers les villes fut systématiquement utilisée pour renforcer l'hégémonie ecclésiastique également dans les villes : les paroisses exploitèrent leur rôle d'agences pour l’emploi afin d’étendre le contrôle ecclésiastique sur les ouvriers et les autres travailleurs des ville.
Non seulement manquèrent totalement, dans le Risorgimento et dans les décennies suivantes, la mobilisation en masse de la population pour améliorer ses conditions économiques, l’instruction, les conditions hygiéniques et sanitaires etc., et pour promouvoir tous les autres aspects de l'initiative de masse, que seule une révolution paysanne et la confiance en soi confortée par les résultats auraient développé chez des millions d'individus ; mais il y eut même un effort conjoint de l'Église, de l'État et d'une grande partie de la classe dominante pour mortifier, réprimer et décourager l'initiative pratique et, par-dessus, l'émancipation morale et intellectuelle de la masse des hommes et des femmes. L'émigration de la campagne vers les villes fut systématiquement utilisée pour renforcer l'hégémonie ecclésiastique également dans les villes : les paroisses exploitèrent leur rôle d'agences pour l’emploi afin d’étendre le contrôle ecclésiastique sur les ouvriers et les autres travailleurs des ville.La lutte de la bourgeoisie pour un renouvellement moral et intellectuel général du pays se réduisit à des initiatives privées non-coordonnées et en grande partie sectaires et élitistes, idéalistes parce qu'elles comptaient sans le mouvement pratique qui seul aurait pu les transformer en initiatives de masse (89). Dans la société bourgeoise, il est possible de construire un parti sur une conception du monde et un programme politique, tandis qu’il n’est possible de mobiliser et d’unir les masses populaires que dans un mouvement pratique, pour un objectif pratique, qui en l’occurrence aurait été l'amélioration de leur condition par la conquête de la terre et l'élimination révolutionnaire des vexations féodales restantes, objectif que l'aile gauche de la bourgeoisie unitaire ne sut pas vraiment assumer (90).
 S’ajoutèrent, à tout cela, la durable opposition qui s'instaura alors et se maintint ensuite entre la masse de la population et les Autorités du nouvel État, qui se présentaient uniquement ou principalement dans les habits du carabinier, du percepteur d'impôts ou de l'huissier, le service militaire obligatoire au service d'un État ennemi imposé après l'Unité, l'incitation à la rébellion et le boycottage promus pendant longtemps par l’Église et d'autres groupes anti-unitaires dont la bourgeoisie avait intégralement respecté le pouvoir social (richesse, prestige et souvent même, charges publiques). En particulier, l'Église obtint d'une part des richesses, des privilèges et du pouvoir du nouvel État, et de l'autre se donna des airs de protectrice et de porte-parole des masses populaires face aux Autorités du nouvel État, dans une position systématique de chantage.
S’ajoutèrent, à tout cela, la durable opposition qui s'instaura alors et se maintint ensuite entre la masse de la population et les Autorités du nouvel État, qui se présentaient uniquement ou principalement dans les habits du carabinier, du percepteur d'impôts ou de l'huissier, le service militaire obligatoire au service d'un État ennemi imposé après l'Unité, l'incitation à la rébellion et le boycottage promus pendant longtemps par l’Église et d'autres groupes anti-unitaires dont la bourgeoisie avait intégralement respecté le pouvoir social (richesse, prestige et souvent même, charges publiques). En particulier, l'Église obtint d'une part des richesses, des privilèges et du pouvoir du nouvel État, et de l'autre se donna des airs de protectrice et de porte-parole des masses populaires face aux Autorités du nouvel État, dans une position systématique de chantage.La législation du nouvel État et, encore plus, son application et l’activité pratique des Autorités du nouvel État et de son Administration Publique, défendirent les intérêts de l'Église et soutinrent son intégration dans les nouvelles conditions de la richesse du pays. L'Église et son « aristocratie noire » romaine transformèrent, aux conditions dictées par elles-mêmes, leurs propriétés terriennes et immobilières traditionnelles en nouvelle richesse financière.
L'insuffisante disponibilité de capitaux pour investissements a été une lamentation qui a accompagné toute l'histoire de notre pays après l'Unité et que les historiens bourgeois, cléricaux ou non, ont versé, complaisants, dans leurs traités d'histoire en justification de la misère persistante d’une grande partie de la population et de la subordination économique et politique de l'Italie à la bourgeoisie allemande, française et anglaise. En effet, les capitalistes entrepreneurs et même l'État durent largement recourir à des banques de prêt et d'investissement étrangères et aux Bourses étrangères pour financer les investissements et la Dépense Publique. En réalité, lorsque débuta le Risorgimento, l'économie
 monétaire était déjà très développée en Italie et la richesse monétaire du pays était abondante et concentrée. Mais elle ne fut employée que dans une mesure minimale pour les investissements capitalistes. Le caractère anti-paysan du Risorgimento empêcha précisément que se créent les conditions de classe et politiques nécessaires, pour que la richesse monétaire du pays se canalise vers le développement économique et civil du pays, et pour que l'imposition fiscale soit transparente, équitablement répartie et à la hauteur des frais de l’Administration Publique.
monétaire était déjà très développée en Italie et la richesse monétaire du pays était abondante et concentrée. Mais elle ne fut employée que dans une mesure minimale pour les investissements capitalistes. Le caractère anti-paysan du Risorgimento empêcha précisément que se créent les conditions de classe et politiques nécessaires, pour que la richesse monétaire du pays se canalise vers le développement économique et civil du pays, et pour que l'imposition fiscale soit transparente, équitablement répartie et à la hauteur des frais de l’Administration Publique.Les propriétaires terriens continuèrent jusqu'au deuxième après-guerre à extorquer aux paysans les rentes et les prestations personnelles qu’ils leurs avaient extorqué avant l'Unité. Mais à quelle fin utilisaient-ils ces rentes ? Pour la plus grande partie, et l'Église en était l'exemple le plus macroscopique, les propriétaires terriens n’étaient pas des capitalistes qui investissaient dans des entreprises industrielles ce qu’ils extorquaient aux paysans. Ils étaient des parasites qui continuaient à dilapider comme ils le faisaient avant l'Unité, dans les villes ou à l'étranger. La spéculation financière, l'usure, la spéculation foncière et immobilière, les investissements financiers à l'étranger, la thésaurisation, les frais pour la consommation, le luxe et le faste des riches et la magnificence de l'Église et des Autorités publiques, leurs frais de représentation et de prestige continuèrent à absorber une large part de la richesse monétaire et des forces laborieuses du pays, exactement comme, parallèlement, la rhétorique, la théologie et l'art de la chicane continuèrent à absorber une large part de ses énergies intellectuelles.
L'Église resta le centre initiateur et la source principale du parasitisme de la classe dominante qui, à travers mille canaux et capillaires, a pollué durant les 150 ans d'histoire unitaire et pollue encore aujourd'hui tout le pays, absorbe une grande partie de ses forces productives, occupe une grande partie de sa force de travail, impose son ombre et son empreinte maléfiques et dicte sa loi partout dans notre pays. Ce n’est pas par hasard qu’en Italie la bienfaisance, les faveurs et les aumônes ont toujours été et sont en proportion inverse aux droits des masses populaires et aux salaires. C’est le "conservatisme charitable" : les travailleurs sont à la merci du bon cœur des riches, les riches ne doivent pas exagérer ; la culture féodale à laquelle l'Église a mis ses vêtements de fête : la doctrine sociale de l'Église ! Le pizzo (racket contre
 ‘protection’) que la mafia et autres organisations criminelles exigent, n'est autre que leur forme spécifique de cet état général d'exploitation parasitaire, qui a désormais conflué dans le parasitisme général de la bourgeoisie impérialiste (91).
‘protection’) que la mafia et autres organisations criminelles exigent, n'est autre que leur forme spécifique de cet état général d'exploitation parasitaire, qui a désormais conflué dans le parasitisme général de la bourgeoisie impérialiste (91).Plutôt que de trouver les ressources financières pour le développement économique en puisant dans les sacs de parasitisme qu’elle avait trouvé, jusqu'à les assécher, la bourgeoisie unitaire étendit la Dépense Publique pour financer et élargir le vieux parasitisme qui devint une nouvelle plaie. Ces frais s’ajoutèrent à ceux auxquels le nouvel État dût faire face pour créer les conditions d'un État moderne, indépendant et avec un minimum d'autorité dans le concert européen, et les augmentèrent : il suffit de considérer la pléthore d'officiers de grade supérieur et de fonctionnaires publics dès les premières années du Royaume, vu que celui-ci absorba une grande partie de la bureaucratie et des Forces Armées des États supprimés.
Ensemble, les charges héritées – des anciens États – et les nouvelles gonflèrent énormément la Dépense Publique. Dans les premières décennies de l’Unité les impôts furent proportionnellement élevés et frappaient principalement les paysans. Ces impôts et le service militaire obligatoire augmentèrent encore plus leur hostilité envers le nouvel État. Ils créèrent un terrain favorable aux manœuvres et aux chantages des forces antiunitaires, en premier lieu du Pape et de l'Église qui étaient aussi les plus grands bénéficiaires de la politique de la bourgeoisie unitaire. L’hostilité des paysans, fruit des conditions objectives et aggravées par les incitations à la révolte des vieilles Autorités et en particulier de l'Église, rendit nécessaires de nouveaux frais pour l'ordre public (il suffit de penser au coût de la guerre contre le "brigandage") et la sûreté nationale.
 Une autre lamentation qui a accompagné toute l'histoire de notre pays après l'Unité et que les historiens bourgeois, cléricaux ou non, ont versée complaisamment dans leurs traités d'histoire, est l’étroitesse du marché intérieur. Mais quelle fut la source d’une telle étroitesse ?
Une autre lamentation qui a accompagné toute l'histoire de notre pays après l'Unité et que les historiens bourgeois, cléricaux ou non, ont versée complaisamment dans leurs traités d'histoire, est l’étroitesse du marché intérieur. Mais quelle fut la source d’une telle étroitesse ?Les paysans furent encore, pendant plusieurs décennies après l'Unité, jusqu'à l'après-guerre, la majorité de la population. Ils furent accablés au-delà de toute limite imaginable par les vieilles rentes et les nouveaux impôts. La charge globale doubla – environ - avec l'Unité, selon des évaluations crédibles (92). La situation des paysans fut aggravée par le fait qu’à un certain point, l'État, pour encaisser cet argent qu’il n'avait pas la force de prendre aux riches comme impôts, mit en vente aux enchères et en liquidation les terres domaniales et des couvents, supprimant sans la moindre indemnité les ‘usages civiques’ (pâture, ramassage de bois, etc.) dont les paysans jouissaient depuis des temps immémoriaux sur ces terrains. Les usages civiques, avec les cantines des couvents, avaient été des sources dont la masse des paysans, en particulier les plus pauvres et encore plus dans les années difficiles, avaient alors tiré de quoi survivre.
Il est donc évident que dans ces conditions, les paysans n'achetaient ni équipement agricole et outillages pour améliorer la productivité de leur travail, ni biens de consommation. Ils se contentaient de peu et ce peu, ils cherchaient à le produire directement eux-mêmes (économie naturelle). De là, la cause première de l’étroitesse du marché intérieur.
En effet, le marché intérieur était constitué 1. de la demande des capitalistes en investissements et de la Dépense Publique pour l’achat de marchandises, 2. de la demande des capitalistes et des classes parasitaires pour leur consommation propre, 3. de la demande de biens de consommation et d'outils de la part des familles et des travailleurs urbains, 4. de la demande de biens de consommation et d'outils de la part des familles paysannes. Le capital se crée une partie de son propre marché en incorporant les activités manufacturières auxiliaires et complémentaire de l'agriculture (filature, tissage, production d'outils, industrie du bâtiment, travail des produits agricoles, etc.) que dans le domaine d'une économie naturelle, les familles paysannes exercent pour elles-mêmes et pour leurs seigneurs ; et en les érigeant en secteurs productifs de l'économie mercantile et capitaliste, qui vendent leurs produits l'un à l'autre et aux familles paysannes (division sociale du travail). Cette dernière partie du marché intérieur était particulièrement importante pour le capitalisme italien post-unitaire, parce que les deux premières parties, par leur nature et par longue tradition, étaient dans une large mesure satisfaites par l’offre des pays plus avancés d'Europe. De plus, le rôle du marché intérieur fut accru par le fait que rapidement, après l'accomplissement de l'Unité de l'Italie, commença la Grande Dépression (1873-1895) avec la stagnation voire la réduction du marché étranger.
2.1.1.2. L'État à souveraineté limitée
 Le nouvel État n'affirma jamais pleinement sa souveraineté unique sur toute la population vivant à l’intérieur de ses frontières, bien que celle-ci ne jouisse que de peu ou d’aucune autonomie locale. Il n’eut jamais la volonté d'instaurer sa souveraineté unique, ni n’eut la confiance d'avoir la force pour le faire. Dans le Centre et dans le Nord du pays, le nouvel État assuma en propre l'exercice de la violence, la répression et la tutelle de l'ordre public et compta sur l'Église qui contrôlait les paysans et les femmes sur lesquelles elle exerçait une efficace direction intellectuelle et morale. Dans le Sud, la direction intellectuelle et morale de l'Église sur les paysans était moins forte. Là, l'État soutint secteur par secteur la force sociale capable de tenir en respect, par ses propres moyens, les paysans, de dicter la loi et les règles et de les faire observer. Évidemment, il dut consentir à ce que chacune d'entre elles dicte sa propre loi et ses propres règles et les fasse respecter à sa manière, bien que dans le cadre d'une certaine reconnaissance d'une certaine suprématie de l'État (93).
Le nouvel État n'affirma jamais pleinement sa souveraineté unique sur toute la population vivant à l’intérieur de ses frontières, bien que celle-ci ne jouisse que de peu ou d’aucune autonomie locale. Il n’eut jamais la volonté d'instaurer sa souveraineté unique, ni n’eut la confiance d'avoir la force pour le faire. Dans le Centre et dans le Nord du pays, le nouvel État assuma en propre l'exercice de la violence, la répression et la tutelle de l'ordre public et compta sur l'Église qui contrôlait les paysans et les femmes sur lesquelles elle exerçait une efficace direction intellectuelle et morale. Dans le Sud, la direction intellectuelle et morale de l'Église sur les paysans était moins forte. Là, l'État soutint secteur par secteur la force sociale capable de tenir en respect, par ses propres moyens, les paysans, de dicter la loi et les règles et de les faire observer. Évidemment, il dut consentir à ce que chacune d'entre elles dicte sa propre loi et ses propres règles et les fasse respecter à sa manière, bien que dans le cadre d'une certaine reconnaissance d'une certaine suprématie de l'État (93).L'Église a été la cause principale et la principale bénéficiaire de la limitation de la souveraineté du nouvel État. Déjà, lors de l'accomplissement de l'Unité, la bourgeoisie reconnut à l'Église et s’engagea publiquement et par la loi à respecter des exemptions, l’immunité et l'extraterritorialité. Avec la loi des Garanties (en 1871), le nouvel État laissa au Pape et s’engagea à n’exercer en aucun cas et d’aucune manière son autorité (judiciaire, de police, douanière, militaire, fiscale, etc.) sur une partie de la ville de Rome et sur les rapports que le Pape et sa Cour entretenaient avec le clergé italien et avec l'étranger. Il mit en outre, à disposition irrévocable du Pape, 50 millions de lires par an, en plus des impôts que le Pape tirait de l'État Pontifical (94).
 De fait l'Église, avec le Pape à sa tête, continua à fonctionner dans tout le pays comme un pouvoir souverain, un État dans l'État, avec son réseau de fonctionnaires (substantiellement soustraits à l'autorité de l'État) qui depuis le Centre couvrait tout le pays, jusqu'au village le plus reculé. Elle eut en outre l'avantage que c’était désormais la police, la magistrature, l'administration pénitentiaire du nouvel État, opérant sur toute la péninsule, qui faisaient respecter son intérêt, son pouvoir, ses spéculations et son prestige et en assumaient la responsabilité auprès des masses populaires. Les fonctionnaires de l'Église étaient sélectionnés, formés, nommés et résignés sur décision irrévocable du Pape ou des fonctionnaires supérieurs (évêques) délégués par lui dans ce but. Ils jouissaient cependant des rentes des biens diocésains et paroissiaux, des édifices publics et autres prérogatives et pouvoirs sur la population (baptêmes, mariages, enterrements, etc.). Le nouvel État se contenta d'établir que pour jouir des bénéfices, pouvoirs et immunités, des garanties, des protections et des exemptions sous la tutelle des Autorités du nouvel État, les fonctionnaires supérieurs (les évêques) nommés par le Pape devaient aussi avoir le consentement de l'État : chose que de fait, par tacite accord, l'État ne fit jamais manquer.
De fait l'Église, avec le Pape à sa tête, continua à fonctionner dans tout le pays comme un pouvoir souverain, un État dans l'État, avec son réseau de fonctionnaires (substantiellement soustraits à l'autorité de l'État) qui depuis le Centre couvrait tout le pays, jusqu'au village le plus reculé. Elle eut en outre l'avantage que c’était désormais la police, la magistrature, l'administration pénitentiaire du nouvel État, opérant sur toute la péninsule, qui faisaient respecter son intérêt, son pouvoir, ses spéculations et son prestige et en assumaient la responsabilité auprès des masses populaires. Les fonctionnaires de l'Église étaient sélectionnés, formés, nommés et résignés sur décision irrévocable du Pape ou des fonctionnaires supérieurs (évêques) délégués par lui dans ce but. Ils jouissaient cependant des rentes des biens diocésains et paroissiaux, des édifices publics et autres prérogatives et pouvoirs sur la population (baptêmes, mariages, enterrements, etc.). Le nouvel État se contenta d'établir que pour jouir des bénéfices, pouvoirs et immunités, des garanties, des protections et des exemptions sous la tutelle des Autorités du nouvel État, les fonctionnaires supérieurs (les évêques) nommés par le Pape devaient aussi avoir le consentement de l'État : chose que de fait, par tacite accord, l'État ne fit jamais manquer.Si d'un côté, l'Église menait la fronde, de l'autre elle exigeait toujours plus de l'État, en menaçant de faire pire (dans ses intrigues internationales et dans l’incitation à la révolte des paysans et des femmes), s’appuyant sur la timidité morale et la peur qu'elle inspirait à la Cour et à la plupart des plus hauts représentants de la classe dirigeante. Celle-ci était, en effet, composée dans une large mesure de pieuses personnes sur lesquelles la menace de l’excommunication, des peines de l'Enfer demain dans l'au-delà et des malédictions de Dieu ici et maintenant sur terre, avaient un grand effet. Forts de cette situation, l'Église, l'"aristocratie noire" romaine, parents et hommes de confiance du Pape et des
 autres représentants de la Curie romaine participèrent, pour leur propre compte et pour le compte de l'Église, au « sac de Rome » (la spéculation sur les terrains et sur les immeubles) qui eut lieu dans les décennies après l'Unité, et à la spéculation financière dont les scandales ont dès lors bouleversé à répétition le système financier et bancaire du pays entier, jusqu'aux récentes affaires Sindona (Banque Privée Italienne), Calvi (Banco Ambrosiano), Parmalat, Fazio.
autres représentants de la Curie romaine participèrent, pour leur propre compte et pour le compte de l'Église, au « sac de Rome » (la spéculation sur les terrains et sur les immeubles) qui eut lieu dans les décennies après l'Unité, et à la spéculation financière dont les scandales ont dès lors bouleversé à répétition le système financier et bancaire du pays entier, jusqu'aux récentes affaires Sindona (Banque Privée Italienne), Calvi (Banco Ambrosiano), Parmalat, Fazio.Ces activités de l'Église n'eurent pas et n'ont toujours pas que des effets financiers. Elles paralysèrent le système judiciaire de l'État, qui doit reculer chaque fois qu'il va s’abattre sur des représentants ou des mandataires de l'Église. Elles limitèrent le pouvoir législatif de l'État, qui doit se contenir chaque fois que des dispositions touchent les intérêts de l'Église - qui sont présents dans tous les domaines. Elles conditionnèrent les appareils d’investigation et policiers de l'État. Elles accrurent encore le secret dont la bourgeoisie, déjà pour elle-même, entoure l'activité de son État et de son Administration publique. Elles jetèrent une ombre sur la fiabilité des systèmes financier et étatique italien entiers et en amoindrirent le rôle dans le système capitaliste international. Choses dont ont évidemment profité et profitent encore tous les aventuriers nationaux et étrangers qui ont intérêt à le faire.
La situation de double souveraineté (ou de souveraineté limitée), déterminée par la survie de l'Église, a contribué à conserver et à créer d’autres pouvoirs souverains dans le pays. Le plus connu parmi ceux de longue date, mis à part l'Église, est la mafia sicilienne. Au moment de l’unification de la péninsule elle resta un pouvoir, de fait reconnu et délégué de l'État italien, dans la zone occidentale de la Sicile. Par la suite elle élargit son terrain d'action aux USA, en Italie et dans d’autres pays.
De la situation de souveraineté limitée où se trouve l'État italien depuis sa naissance, tire son origine la situation actuelle. Sous l’apparente souveraineté officielle de l'État italien, existent en Italie des zones territoriales et des relations sociales dans lesquelles ne prévaut pas sa loi. Une série de pouvoirs souverains agissent, indépendants de l'État italien. Chacun d'entre eux dicte ses règles, dispose de moyens propres pour imposer sa volonté et exerce une influence extralégale sur les Autorités de l'État et sur l’Administration publique. Celle-ci est largement infiltrée par chacun de ces pouvoirs souverains. Chacun d'eux dispose d'hommes qui lui doivent leur carrière et leur rôle dans l’Administration publique. Ceux-ci agissent donc dans l’Administration publique et pour le compte de celle-ci, mais selon les directives d'un pouvoir qui ne porte officiellement aucune responsabilité des actions et des comportements qu'il commande. Le Vatican est le principal de ces pouvoirs. Dans notre pays, il n'y a aujourd'hui aucun endroit ou aucun domaine dans lequel il ne puisse recueillir des informations et exercer son influence. Il a dans le pays une influence bien plus large, efficace et centralisée que celle de l'État officiel. De plus, il peut se servir d'une grande partie de la structure de l'État et de l’Administration publique. Après le Vatican viennent les impérialistes US (directement et via l'OTAN), les groupes sionistes, la mafia, la camorra, la n'drangheta et d’autres groupes de la criminalité organisée, et tous les autres ayant la volonté et les moyens de profiter de la situation. Les événements de la Loge P2 ont montré une des modalités pour le faire.
 La double souveraineté État/Église sur la péninsule a toutefois un caractère particulier. Elle a créé un régime unique en son genre. Sa particularité consiste en le fait qu’en Italie, l'Église n'est pas une religion. La religion est seulement le prétexte et le revêtement idéologique d'une structure politique monarchique féodale. Celle-ci a à Rome et dans chaque coin du pays des dirigeants nommés par le monarque. Ils sont sélectionnés pour leur fidélité au chef, lui jurent fidélité, les fortunes et le rôle de chacun d'eux dépendent de l'irrévocable volonté du monarque dont le pouvoir est absolu et se prétend d'origine divine. À ses fidèles, l'Église demande fidélité et obéissance. Leurs opinions et leur expérience ne décident pas de l'orientation de l'activité de l'Église : au contraire ce sont eux qui doivent s'adapter aux décisions de l'Église. Ses directives sont irrévocables et prétendent même jouir d'une autorité divine. L’Eglise et son chef absolu, le Pape, forment le gouvernement suprême de dernière instance de l'Italie. Elle n'annonce ni programmes ni orientations ni ne présente aucun bilan de ses actes, car elle ne reconnaît sur ses actes, au peuple italien, aucun droit de vote ni même d'opinion. Ce gouvernement, occulte et irresponsable, dirige pourtant le pays à travers une structure étatique qui prétend être, comme dans toute république bourgeoise constitutionnelle, légitimée par la volonté populaire et avoir à sa tête un Parlement et un gouvernement qui doivent être sanctionnés par le suffrage populaire. Officiellement, cette structure est l'unique État. Contrairement à toute autre monarchie constitutionnelle, les frontières de compétences entre l'État constitutionnel et l'Église sont arbitrairement, irrévocablement et secrètement décidées par l'Église au cas par cas. Ceci confère précisément à l’ensemble du régime une certaine dose de précarité, mais aussi cette flexibilité qui permet des rapports d'unité et de lutte avec tous les autres pouvoirs autonomes qui ont pied dans le pays. Un pareil régime n'est décrit dans aucun manuel de doctrines politiques mais, pour autant, il n'en est pas moins réel et est celui avec lequel le mouvement communiste doit compter dans notre pays. L'histoire de sa formation a traversé cinq phases différentes.
La double souveraineté État/Église sur la péninsule a toutefois un caractère particulier. Elle a créé un régime unique en son genre. Sa particularité consiste en le fait qu’en Italie, l'Église n'est pas une religion. La religion est seulement le prétexte et le revêtement idéologique d'une structure politique monarchique féodale. Celle-ci a à Rome et dans chaque coin du pays des dirigeants nommés par le monarque. Ils sont sélectionnés pour leur fidélité au chef, lui jurent fidélité, les fortunes et le rôle de chacun d'eux dépendent de l'irrévocable volonté du monarque dont le pouvoir est absolu et se prétend d'origine divine. À ses fidèles, l'Église demande fidélité et obéissance. Leurs opinions et leur expérience ne décident pas de l'orientation de l'activité de l'Église : au contraire ce sont eux qui doivent s'adapter aux décisions de l'Église. Ses directives sont irrévocables et prétendent même jouir d'une autorité divine. L’Eglise et son chef absolu, le Pape, forment le gouvernement suprême de dernière instance de l'Italie. Elle n'annonce ni programmes ni orientations ni ne présente aucun bilan de ses actes, car elle ne reconnaît sur ses actes, au peuple italien, aucun droit de vote ni même d'opinion. Ce gouvernement, occulte et irresponsable, dirige pourtant le pays à travers une structure étatique qui prétend être, comme dans toute république bourgeoise constitutionnelle, légitimée par la volonté populaire et avoir à sa tête un Parlement et un gouvernement qui doivent être sanctionnés par le suffrage populaire. Officiellement, cette structure est l'unique État. Contrairement à toute autre monarchie constitutionnelle, les frontières de compétences entre l'État constitutionnel et l'Église sont arbitrairement, irrévocablement et secrètement décidées par l'Église au cas par cas. Ceci confère précisément à l’ensemble du régime une certaine dose de précarité, mais aussi cette flexibilité qui permet des rapports d'unité et de lutte avec tous les autres pouvoirs autonomes qui ont pied dans le pays. Un pareil régime n'est décrit dans aucun manuel de doctrines politiques mais, pour autant, il n'en est pas moins réel et est celui avec lequel le mouvement communiste doit compter dans notre pays. L'histoire de sa formation a traversé cinq phases différentes.Phase 1
La bourgeoisie a mené le Risorgimento avec l'intention de créer son État, mais en reconnaissant que pour gouverner elle avait besoin de la collaboration de l'Église, étant donné l’hostilité des paysans. L’objet du contentieux était la délimitation des pouvoirs entre les deux institutions. Il y eut alors une phase de guerre sans combats, d'armistice État/Église, reprise en ce qui concerne l'État dans la Loi des Garanties et en ce qui concerne l'Église dans la ligne du « non expedit » (95). Cette phase va environ de 1848 à 1898. Dans la bourgeoisie, ont encore un certain poids les courants qui voudraient promouvoir leur hégémonie directe sur les masses populaires et se défaire de l'Église. La distinction entre l'aile gauche de la bourgeoisie unitaire et le mouvement communiste italien naissant n'est pas encore nette. La bourgeoisie laisse le temps et les conditions à l'Église pour réorganiser ses forces en Italie et dans le monde. Dans la seconde partie du XIXe siècle, la bourgeoisie passe au niveau international à l’époque de l'impérialisme, de la contre-révolution préventive, de la mobilisation des forces féodales restantes dans une nouvelle « sainte alliance » pour arrêter l'avancée du mouvement communiste. C’est la transformation déjà décrite dans le chapitre 1.3 de ce MP. L'Église Catholique, dirigée entre 1878 et 1903 par le Pape Léon XIII, exploite cette situation internationale pour sortir des difficultés dans lesquelles l'a mise l'unification de la péninsule. Elle devient le principal appui de la bourgeoisie impérialiste au niveau international et, à partir de cette nouvelle condition, affronte la définition de son nouveau rôle en Italie.
Phase 2
 La bourgeoisie et l'Église reconnaissent, par des accords comme le Pacte Gentiloni (1913), qu'elles doivent collaborer dans l'intérêt commun contre le mouvement communiste, en se partageant les tâches. Le mouvement communiste a maintenant atteint une discrète autonomie idéologique et politique vis-à-vis de la bourgeoisie. Pour le tenir en respect et limiter la liaison naissante ouvriers-paysans, la bourgeoisie demande à l'Église de restaurer et de renforcer son hégémonie sur les paysans et sur les femmes, hégémonie affaiblie par les progrès du mouvement communiste, et de prendre des initiatives pour établir son hégémonie sur au moins une partie des ouvriers. L'Église accepte le défi, mais exige l'aide de la bourgeoisie pour réaliser cette œuvre à l’issue incertaine. Cette phase va grosso modo des mouvements paysans et ouvriers de 1893-1898 jusqu'en 1928. Les catholiques participent aux élections parlementaires et à l'activité parlementaire en soutien au gouvernement. L'Église crée des organisations de masse dans toutes les classes et couches sociales, en particulier parmi les travailleurs, pour bloquer l'avancée du mouvement communiste, empêcher l'unité des ouvriers et entraver l'unité ouvriers-paysans. Par celles-ci l'Église appuie l'action du gouvernement, de l'entreprise libyenne (1911) à la participation de l'Italie à la Première Guerre Mondiale (1915-1918). Lorsque la guerre commence à engendrer une révolte générale des masses populaires, dont le pic le plus haut est la Révolution d'Octobre, elle assume la direction du mouvement pour la conclusion d'un armistice. Face à la rébellion diffuse des masses populaires qui suit la conclusion de la guerre, l'Église accepte le fascisme, la dictature terroriste de la bourgeoisie impérialiste, comme solution nécessaire de gouvernement pour rétablir l’ordre. Elle appuie sa venue au pouvoir et la consolidation du régime.
La bourgeoisie et l'Église reconnaissent, par des accords comme le Pacte Gentiloni (1913), qu'elles doivent collaborer dans l'intérêt commun contre le mouvement communiste, en se partageant les tâches. Le mouvement communiste a maintenant atteint une discrète autonomie idéologique et politique vis-à-vis de la bourgeoisie. Pour le tenir en respect et limiter la liaison naissante ouvriers-paysans, la bourgeoisie demande à l'Église de restaurer et de renforcer son hégémonie sur les paysans et sur les femmes, hégémonie affaiblie par les progrès du mouvement communiste, et de prendre des initiatives pour établir son hégémonie sur au moins une partie des ouvriers. L'Église accepte le défi, mais exige l'aide de la bourgeoisie pour réaliser cette œuvre à l’issue incertaine. Cette phase va grosso modo des mouvements paysans et ouvriers de 1893-1898 jusqu'en 1928. Les catholiques participent aux élections parlementaires et à l'activité parlementaire en soutien au gouvernement. L'Église crée des organisations de masse dans toutes les classes et couches sociales, en particulier parmi les travailleurs, pour bloquer l'avancée du mouvement communiste, empêcher l'unité des ouvriers et entraver l'unité ouvriers-paysans. Par celles-ci l'Église appuie l'action du gouvernement, de l'entreprise libyenne (1911) à la participation de l'Italie à la Première Guerre Mondiale (1915-1918). Lorsque la guerre commence à engendrer une révolte générale des masses populaires, dont le pic le plus haut est la Révolution d'Octobre, elle assume la direction du mouvement pour la conclusion d'un armistice. Face à la rébellion diffuse des masses populaires qui suit la conclusion de la guerre, l'Église accepte le fascisme, la dictature terroriste de la bourgeoisie impérialiste, comme solution nécessaire de gouvernement pour rétablir l’ordre. Elle appuie sa venue au pouvoir et la consolidation du régime.Phase 3
 La bourgeoisie, par la bouche de Benito Mussolini (1883-1945), reconnaît formellement la souveraineté particulière de l'Église en échange de son engagement officiel et public de fidélité aux Autorités de l'État - sur la base d'un serment fait à Dieu dont l'Église peut délier ses fonctionnaires quand elle veut, tandis que les délits contre l'État dont ceux-ci se rendent responsables sont protégés par des immunités et dans tous les cas vont en prescription. Le Traité du Latran, le Concordat et la Convention financière, signés le 11 février 1929, inaugurent cette phase qui durera jusqu'en 1943. L'Église renonce officiellement à la prétention de restaurer le vieil État Pontifical et reçoit en compensation des impôts perdus 750 millions de lires comptant, 1 milliard en Bons du Trésor à 5% au porteur et une série interminable de privilèges, propriété, droits, exemptions et immunités. Mais le fascisme était aussi l'ultime tentative de la bourgeoisie pour se rendre pleinement maître du pays et donc également politiquement autonome de l'Église. L'Église négocia soigneusement et encaissa tout ce que le fascisme lui donnait, mais
La bourgeoisie, par la bouche de Benito Mussolini (1883-1945), reconnaît formellement la souveraineté particulière de l'Église en échange de son engagement officiel et public de fidélité aux Autorités de l'État - sur la base d'un serment fait à Dieu dont l'Église peut délier ses fonctionnaires quand elle veut, tandis que les délits contre l'État dont ceux-ci se rendent responsables sont protégés par des immunités et dans tous les cas vont en prescription. Le Traité du Latran, le Concordat et la Convention financière, signés le 11 février 1929, inaugurent cette phase qui durera jusqu'en 1943. L'Église renonce officiellement à la prétention de restaurer le vieil État Pontifical et reçoit en compensation des impôts perdus 750 millions de lires comptant, 1 milliard en Bons du Trésor à 5% au porteur et une série interminable de privilèges, propriété, droits, exemptions et immunités. Mais le fascisme était aussi l'ultime tentative de la bourgeoisie pour se rendre pleinement maître du pays et donc également politiquement autonome de l'Église. L'Église négocia soigneusement et encaissa tout ce que le fascisme lui donnait, mais  s’opposa fermement à la tentative de la bourgeoisie, à travers le fascisme, de bâtir son hégémonie directe sur les masses populaires. À cet aspect du fascisme correspondent un effort et un dynamisme exceptionnels de la bourgeoisie pour renforcer la structure économique et politique du pays. Pendant le fascisme, elle a cherché à étendre le pouvoir de l'État italien en Méditerranée et a introduit une grande partie des innovations sur le plan structurel dont a vécu aussi le régime DC : banque centrale, industrie d'État, grands travaux publics, structures pour la recherche, consortiums agricoles, organismes de prévoyance, etc. En somme, les innovations et les institutions dont le résultat est la création d'un système de capitalisme monopoliste d'État. La tentative de la bourgeoisie se conclût cependant de manière désastreuse pour elle. Le fascisme fut renversé par l’issue de la guerre et par l'avancée du mouvement communiste. Le risque qu’en Italie, la classe ouvrière conduise les masses populaires à instaurer le socialisme, n'avait jamais été aussi grand. Pour conjurer le risque, la bourgeoisie s’en remit complètement à l'Église et à l'impérialisme américain. Ses velléités de gouverner politiquement le pays cessèrent définitivement.
s’opposa fermement à la tentative de la bourgeoisie, à travers le fascisme, de bâtir son hégémonie directe sur les masses populaires. À cet aspect du fascisme correspondent un effort et un dynamisme exceptionnels de la bourgeoisie pour renforcer la structure économique et politique du pays. Pendant le fascisme, elle a cherché à étendre le pouvoir de l'État italien en Méditerranée et a introduit une grande partie des innovations sur le plan structurel dont a vécu aussi le régime DC : banque centrale, industrie d'État, grands travaux publics, structures pour la recherche, consortiums agricoles, organismes de prévoyance, etc. En somme, les innovations et les institutions dont le résultat est la création d'un système de capitalisme monopoliste d'État. La tentative de la bourgeoisie se conclût cependant de manière désastreuse pour elle. Le fascisme fut renversé par l’issue de la guerre et par l'avancée du mouvement communiste. Le risque qu’en Italie, la classe ouvrière conduise les masses populaires à instaurer le socialisme, n'avait jamais été aussi grand. Pour conjurer le risque, la bourgeoisie s’en remit complètement à l'Église et à l'impérialisme américain. Ses velléités de gouverner politiquement le pays cessèrent définitivement.Phase 4
 C’est la phase de direction de l'Église sur l'État légal par la Démocratie Chrétienne : une phase qui va environ de 1947 à 1992. Avec l'accord de l'impérialisme américain, l'Italie devient un nouveau type d'État Pontifical élargi. L'Église est la plus haute autorité morale du régime, une sorte de monarchie constitutionnelle, sans cependant de constitution. L'État légal œuvre sous sa haute et incontestable direction. L'Église dirige l'État officiel et gouverne le pays indirectement, par son parti, la DC. L'Église maintient intacte et même renforce sa structure territoriale (curie, paroisses, associations, congrégations et ordres religieux, écoles, structures hospitaliers et œuvres pieuses, institutions financières, etc.) indépendante de celle de l'État et de plus, elle scelle une solide alliance avec l'impérialisme américain pour mener ensemble, au niveau international, la lutte contre le mouvement communiste. L'impérialisme américain dans tous les cas s'installe aussi en Italie directement, avec ses propres forces. L'État officiel fait valoir l'autorité papale, dans les limites imposées par les nécessités de l'Église et dans les limites permises par l'effective composition de classe du pays et les rapports de force internes et internationaux résultant de la défaite du nazifascisme, œuvre du mouvement communiste. La Constitution de l'État officiel est une fiction : toute institution républicaine doit feindre de la prendre au sérieux (et donc duper les masses), tandis qu'en réalité elle sert seulement à mettre de l’ordre dans l'activité subordonnée des organismes de l'État légal,
C’est la phase de direction de l'Église sur l'État légal par la Démocratie Chrétienne : une phase qui va environ de 1947 à 1992. Avec l'accord de l'impérialisme américain, l'Italie devient un nouveau type d'État Pontifical élargi. L'Église est la plus haute autorité morale du régime, une sorte de monarchie constitutionnelle, sans cependant de constitution. L'État légal œuvre sous sa haute et incontestable direction. L'Église dirige l'État officiel et gouverne le pays indirectement, par son parti, la DC. L'Église maintient intacte et même renforce sa structure territoriale (curie, paroisses, associations, congrégations et ordres religieux, écoles, structures hospitaliers et œuvres pieuses, institutions financières, etc.) indépendante de celle de l'État et de plus, elle scelle une solide alliance avec l'impérialisme américain pour mener ensemble, au niveau international, la lutte contre le mouvement communiste. L'impérialisme américain dans tous les cas s'installe aussi en Italie directement, avec ses propres forces. L'État officiel fait valoir l'autorité papale, dans les limites imposées par les nécessités de l'Église et dans les limites permises par l'effective composition de classe du pays et les rapports de force internes et internationaux résultant de la défaite du nazifascisme, œuvre du mouvement communiste. La Constitution de l'État officiel est une fiction : toute institution républicaine doit feindre de la prendre au sérieux (et donc duper les masses), tandis qu'en réalité elle sert seulement à mettre de l’ordre dans l'activité subordonnée des organismes de l'État légal,  à faire taire par des promesses à réaliser dans un futur indéfini les exigences des "amis du peuple", et à étendre un voile de bel aspect sur les relations réelles. En contrepartie, le Vatican ne porte pas la moindre responsabilité pour les conséquences de son gouvernement. Il est en somme un pouvoir irresponsable et de dernière instance, tacitement accepté par tous les signataires du « pacte constitutionnel » et leurs héritiers.
à faire taire par des promesses à réaliser dans un futur indéfini les exigences des "amis du peuple", et à étendre un voile de bel aspect sur les relations réelles. En contrepartie, le Vatican ne porte pas la moindre responsabilité pour les conséquences de son gouvernement. Il est en somme un pouvoir irresponsable et de dernière instance, tacitement accepté par tous les signataires du « pacte constitutionnel » et leurs héritiers.Phase 5
C’est la phase actuelle, caractérisée par une intervention plus directe de l'Église dans le gouvernement du pays. La crise politique, aspect de la crise générale du capitalisme, renverse en 1992 le régime DC constitué à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. L'Église est forcée par les circonstances à s'engager plus directement dans le gouvernement du pays. Les contradictions entre les groupes impérialistes et les contradictions entre la bourgeoisie impérialiste et les masses populaires ont atteint un niveau tel que les représentants politiques de la bourgeoisie ne réussissent plus à former une structure stable et fiable, qui gouverne le pays tacitement pour le compte du Vatican en lui donnant ce dont lui et son Église ont besoin, et qui en même temps réussisse à être l’expression d'une majorité électorale, pour autant que l'opinion publique soit
 manipulée et intoxiquée. Nous sommes dans la phase actuelle : phase de putréfaction du régime DC dont les poisons empestent notre pays, et de la renaissance du mouvement communiste dans le cadre de la seconde vague de la révolution prolétarienne qui avance dans le monde entier.
manipulée et intoxiquée. Nous sommes dans la phase actuelle : phase de putréfaction du régime DC dont les poisons empestent notre pays, et de la renaissance du mouvement communiste dans le cadre de la seconde vague de la révolution prolétarienne qui avance dans le monde entier.L'objectif du mouvement communiste est l'instauration d'un nouvel ordre social : l'adaptation des rapports de production au caractère déjà collectif des forces productives et l'adaptation correspondante du reste des rapports sociaux et des idées et sentiments afférents. La révolution politique, la conquête du pouvoir politique de la part de la classe ouvrière à la tête du reste des masses populaires, est la prémisse indispensable à la révolution sociale. Conquérir le pouvoir politique en Italie signifie in concreto surtout éliminer l'Église : les autres étais de l'actuel régime politique (l'impérialisme américain, les organisations criminelles, les partis et les autres organisations politiques de la bourgeoisie, les sionistes, la Confindustria, etc.) ont en effet des rôles auxiliaires. Le Vatican et son Église sont le principal pilier du régime politique qui impose et maintient la domination de la bourgeoisie impérialiste dans notre pays, en tutelle de son système social. Il n'est pas possible pour la classe ouvrière de mener les masses à instaurer la dictature du prolétariat, sans éliminer le Vatican et son Église. En Italie, il n'est pas possible accomplir une quelconque révolution sociale sans éliminer cette entrave. Il est donc pour nous, communistes, essentiel de conduire, d’une part, la classe ouvrière et les masses populaires dans cette tâche et de l'autre, de distinguer nettement la lutte pour accomplir la tâche politique d'éliminer le Vatican et son Église, et avec eux le régime politique dont ils sont l'axe principal, de la lutte pour réaliser la réforme morale et intellectuelle dont les masses populaires ont besoin pour assumer ce rôle dirigeant, sans lequel n'est pas possible un nouveau système social à la hauteur des forces productives, matérielles et intellectuelles dont dispose aujourd'hui l'humanité.
 La première lutte est entre des classes antagoniques et, en définitive, les masses populaires devront la résoudre par la force.
La première lutte est entre des classes antagoniques et, en définitive, les masses populaires devront la résoudre par la force.La deuxième est une transformation interne aux masses populaires. Elle concerne des contradictions non antagoniques et ne peut être menée et résolue qu’à travers un mouvement des masses populaires elles-mêmes. Elle concerne des contradictions au sein peuple.
Évidemment, les deux luttes sont par beaucoup d’aspects reliées. L'Église et la bourgeoisie ont besoin de la religion et la religiosité des masses populaires trouve dans l'Église un facile assouvissement.
La bourgeoisie et l'Église ont tout intérêt à confondre les deux luttes, à défendre leur pouvoir à l'ombre de la religion. Il est par contre dans l'intérêt des masses populaires, de la classe ouvrière et dans le nôtre de les distinguer le plus nettement possible.
L'élimination de l'Église et du Vatican est une question qui concerne tout le mouvement communiste international, étant donné le rôle contre-révolutionnaire que le Vatican et son Église jouent au niveau planétaire, parallèle au rôle de gendarme mondial que joue l'impérialisme américain. Dans l'accomplissement de cette tâche internationale, le mouvement communiste italien a un rôle particulier, analogue à celui qu’a le mouvement communiste américain dans l'accomplissement de la tâche internationale d'éliminer l'impérialisme américain.
Notes importantes pour notre propos (les autres sont disponibles dans le Manifeste, en lien dans la colonne de droite) :
80. (p. 108) Le Pape et sa cour ne se concevaient pas comme responsables des conditions du pays qu’ils gouvernaient et du sort de la population qui l'habitait. Au contraire, ils ne concevaient l'État Pontifical que comme une condition et un instrument nécessaires pour exercer leur "mission divine sur terre", et sa population comme des sujets tenus de fournir les ressources nécessaires à la splendeur de l'Église et de vivre de façon à créer les conditions les plus favorables à sa "mission divine sur terre." C’est le motif pour lequel l'État Pontifical était, au XIXe siècle, le plus arriéré de la péninsule ; et la rébellion contre le Pape et son gouvernement grandissait à vue d'œil.
84. (p. 113) ‘’Pour comprendre la nature du rapport entre la mafia sicilienne (et les organisations semblables) et l'État central, il faut penser à la relation qui s'instaura dans les colonies entre les Forces Armées des seigneurs locaux et les puissances dominantes, à celui qui s’instaura entre les Forces Armées de la République Sociale Italienne (République de Salò) et l'Allemagne nazie. C’est un rapport dans lequel la puissance dominante délègue à la force locale des tâches déterminées, la force locale cherche à élargir son activité, la puissance dominante fait valoir ses droits : en somme la division des tâches, un rapport de complémentarité qui n'exclut pas des contradictions et des frictions.’’ Réflexions sur la question de la mafia, dans Rapports Sociaux n°28 (2001).
 85. (p. 114) De 1860 aux années 1880, le nouvel État dut mener une véritable guerre en Italie méridionale contre les bandes de paysans insurgés. L'histoire officielle a appelé ‘’guerre contre le brigandage’’ cette guerre, comme la publicité bourgeoise appelle aujourd'hui ‘’guerre contre le terrorisme’’ la guerre que mène la bourgeoisie impérialiste contre la révolution démocratique des peuples arabes et musulmans. Les Forces Armées de l'État eurent plus de tués dans cette guerre contre les paysans, que dans les trois guerres d'indépendance. Les morts dans les rangs des paysans ne furent jamais recensées. Pour de plus amples informations, voir Adriana Chiaia, Le prolétariat ne s'est pas repenti (1984), Éditions Rapports Sociaux ; ou Renzo de la Carria, Prolétaires sans révolution, Éditions Orient et Savelli. Le Pape et les autres maisons régnantes dépossédées continuèrent, pendant des années, à agiter la menace de se mettre à la tête de révoltes paysannes, comme l’avaient fait les Bourbons en 1799 contre la République Parthénopéenne (NdT : république sur le modèle français, qui avait remplacé le royaume de Naples). C’était en réalité des menaces en l’air, comme celles que le Tsar agitait contre les nobles polonais ou que l'Empereur d'Autriche avait agitées contre les aristocrates lombards : ils avaient plus à perdre qu'à gagner d'un soulèvement des paysans. Agiter la menace était par contre utile, pour faire chanter qui était disposé à marchander.
85. (p. 114) De 1860 aux années 1880, le nouvel État dut mener une véritable guerre en Italie méridionale contre les bandes de paysans insurgés. L'histoire officielle a appelé ‘’guerre contre le brigandage’’ cette guerre, comme la publicité bourgeoise appelle aujourd'hui ‘’guerre contre le terrorisme’’ la guerre que mène la bourgeoisie impérialiste contre la révolution démocratique des peuples arabes et musulmans. Les Forces Armées de l'État eurent plus de tués dans cette guerre contre les paysans, que dans les trois guerres d'indépendance. Les morts dans les rangs des paysans ne furent jamais recensées. Pour de plus amples informations, voir Adriana Chiaia, Le prolétariat ne s'est pas repenti (1984), Éditions Rapports Sociaux ; ou Renzo de la Carria, Prolétaires sans révolution, Éditions Orient et Savelli. Le Pape et les autres maisons régnantes dépossédées continuèrent, pendant des années, à agiter la menace de se mettre à la tête de révoltes paysannes, comme l’avaient fait les Bourbons en 1799 contre la République Parthénopéenne (NdT : république sur le modèle français, qui avait remplacé le royaume de Naples). C’était en réalité des menaces en l’air, comme celles que le Tsar agitait contre les nobles polonais ou que l'Empereur d'Autriche avait agitées contre les aristocrates lombards : ils avaient plus à perdre qu'à gagner d'un soulèvement des paysans. Agiter la menace était par contre utile, pour faire chanter qui était disposé à marchander.87. (p. 115) La quatrième des Thèses de Lyon, approuvées par le troisième congrès de vieux PCI (janvier 1926) et rédigées sous la direction d’A. Gramsci, affirme : « Le capitalisme est l'élément prédominant dans la société italienne et la force qui prévaut dans la détermination de son développement. De cette donnée fondamentale dérive la conséquence qu’il n'existe pas, en Italie, de possibilité d'une révolution qui ne soit pas la révolution socialiste ». Les révisionnistes menés par Togliatti (1893-1964) rangèrent dans un tiroir cette thèse pendant et après la Résistance. Non par hasard, les partisans de l'’’achèvement de la révolution bourgeoise’’ ont, systématiquement, oublié de mettre à l'ordre du jour la principale mesure de l'achèvement effectif de la révolution bourgeoise, qui restait à faire en Italie : l'abolition de la Papauté.
88. (p. 116) ‘’Les rapports entre industrie et agriculture… ont en Italie une base territoriale. Dans le Nord prévalent la production et la population industrielle, dans le Sud et dans les îles la production et la population agricole. Suite à cela, toutes les contradictions inhérentes à la structure sociale du pays, contiennent en elles-mêmes un élément qui touche à l'unité de l'État et la met en danger’’. Thèses de Lyon (1926), chap. 4, thèse 8.
96. (p. 132) Pendant une longue période après l'unification de la péninsule, les mouvements des masses paysannes, bien qu’étant par leur contenu social démocratiques et progressistes (leurs objectifs étaient la possession de la terre et l'élimination des vexations féodales résiduelles), étaient dirigés par les forces réactionnaires antiunitaires. Chose qui aujourd'hui nous rend facile, à nous communistes italiens, de comprendre comment la révolution démocratique des peuples arabes et musulmans et d'autres peuples coloniaux peut être dirigée par des forces de nature féodale. Les
 mouvements de 1893-98 (des Faisceaux siciliens à la révolte de Milan) furent en revanche des mouvements ouvriers-paysans. Les forces féodales restantes étaient réduites, comme la bourgeoisie, à la défensive et s'allièrent avec la bourgeoisie : la crise de 1893-98 marque de fait la fin de la ‘paix armée’ entre le Royaume d'Italie et l'Église Catholique, la fin du non expedit et le début de la collaboration programmatique et systématique contre le mouvement communiste. La crise de 1943-1947 constitue une phase encore supérieure par rapport aux précédentes. L'unité ouvrier-paysans n'était plus seulement une unité dans les faits et dans les idéaux. Elle était assumée, promue et dirigée par un mouvement communiste conscient et organisé, le premier PCI. Celui-ci ne fut pas à la hauteur de sa tâche, et ne sut pas guider les masses populaires à la victoire, à l'instauration du socialisme. Mais ce qu’il réussit à faire, il le fit en maintenant fermement l'unité ouvriers-paysans. À propos du rapport entre le mouvement communiste conscient et organisé et les mouvements paysans, voir Gramsci, Notes sur la question méridionale, disponible sur le site Internet du (n) PCI, section Classiques du mouvement communiste.
mouvements de 1893-98 (des Faisceaux siciliens à la révolte de Milan) furent en revanche des mouvements ouvriers-paysans. Les forces féodales restantes étaient réduites, comme la bourgeoisie, à la défensive et s'allièrent avec la bourgeoisie : la crise de 1893-98 marque de fait la fin de la ‘paix armée’ entre le Royaume d'Italie et l'Église Catholique, la fin du non expedit et le début de la collaboration programmatique et systématique contre le mouvement communiste. La crise de 1943-1947 constitue une phase encore supérieure par rapport aux précédentes. L'unité ouvrier-paysans n'était plus seulement une unité dans les faits et dans les idéaux. Elle était assumée, promue et dirigée par un mouvement communiste conscient et organisé, le premier PCI. Celui-ci ne fut pas à la hauteur de sa tâche, et ne sut pas guider les masses populaires à la victoire, à l'instauration du socialisme. Mais ce qu’il réussit à faire, il le fit en maintenant fermement l'unité ouvriers-paysans. À propos du rapport entre le mouvement communiste conscient et organisé et les mouvements paysans, voir Gramsci, Notes sur la question méridionale, disponible sur le site Internet du (n) PCI, section Classiques du mouvement communiste.******************************
Nous voyons donc clairement comment l'État italien contemporain a été construit par une révolution bourgeoise, mais, en raison de la faiblesse des bourgeoisies qui l'ont conduite, y compris de la bourgeoisie 'centrale' du triangle Turin-Gênes-Milan, une révolution bourgeoise inachevée ; qui a laissé subsister de profondes séquelles du passé féodal : latifundia agraire (dans le Sud mais aussi dans la Plaine du Pô, en réalité partout, au moins jusqu'aux années 1950-60), Mafia et autres organisations criminelles qui sont, historiquement, les héritières des 'hommes de main' des propriétaires fonciers et autres potentats locaux (et ont muté, depuis, en 'multinationales' de l'économie illégale), mentalités parasitaires des élites urbaines, et bien sûr, l'Église qui 'noyaute' littéralement toute la vie politique du pays, 'contrôle' (bien que moins depuis les années 1950) 'les cœurs et les esprits', en plus d'être - aussi - une puissance financière avec ses banques, ses fonds d'investissement etc. Ceci est le premier aspect, qui rapproche le 'cas italien' de l'autre grand État méditerranéen, l''Espagne', en toutefois plus avancé.
 Le deuxième aspect c'est que l'Unité, si elle a été une aspiration de toutes les bourgeoisies des différents États qui constituaient la péninsule, n'en a pas moins été (finalement) réalisée PAR ET POUR les bourgeoisies du triangle Turin-Gênes-Milan, qui ont par conséquent PLIÉ l'organisation sociale et le développement capitaliste (jusque-là entravé par le morcellement politique) du nouvel État à leurs intérêts. Pour cela (et non seulement en raison de leur faiblesse), elles ont laissé subsister les résidus féodaux comme instruments de domination ; et même, parfois, elles ont orchestré une véritable régression dans des territoires qui avaient atteint, avant l'unification, un degré de développement susceptible de leur 'faire de l'ombre'. En effet, si le royaume bourbon de Naples était profondément arriéré sur la majeure partie de son territoire, il n'en allait pas de même pour sa capitale : Naples était une ville florissante, un port majeur de la Méditerranée, la ville la plus peuplée du nouvel État loin devant Turin, Milan ou Rome (elle le restera... jusqu'au Ventennio fasciste), la première de la péninsule dotée d'un éclairage urbain public ou encore d'un chemin de fer (1839), etc. etc. Lorsque l'on voit Naples aujourd'hui, véritable 'Tiers-Monde en Europe' avec ses monceaux d'ordures non ramassées, ses rues et ses immeubles insalubres, sa misère et sa corruption, sa jeunesse livrée à la drogue et à la délinquance supervisée par la sinistre Camorra, l'on mesure toute l'ampleur du génocide social perpétré par la bourgeoisie du Nord, pour faire du Sud non seulement un grand 'marché unifié' mais aussi ce qu'il faut bien appeler une semi-colonie... Les conditions de la construction de cet État ont pu notamment se refléter dans la discipline aux armées, bon révélateur de la faiblesse du sentiment 'patriotique' à son égard : avec 2.800 soldats fusillés pour mutinerie, abandon de poste, mutilation volontaire ou désertion, et des pratiques allant jusqu'à la décimation (exécution sommaire de soldats au hasard dans une unité s'étant "mal battue" !) sous le commandement du sinistre Cadorna, l'Italie détient le record du nombre d'exécutions durant la Première Guerre mondiale loin devant tous les autres belligérants.
Le deuxième aspect c'est que l'Unité, si elle a été une aspiration de toutes les bourgeoisies des différents États qui constituaient la péninsule, n'en a pas moins été (finalement) réalisée PAR ET POUR les bourgeoisies du triangle Turin-Gênes-Milan, qui ont par conséquent PLIÉ l'organisation sociale et le développement capitaliste (jusque-là entravé par le morcellement politique) du nouvel État à leurs intérêts. Pour cela (et non seulement en raison de leur faiblesse), elles ont laissé subsister les résidus féodaux comme instruments de domination ; et même, parfois, elles ont orchestré une véritable régression dans des territoires qui avaient atteint, avant l'unification, un degré de développement susceptible de leur 'faire de l'ombre'. En effet, si le royaume bourbon de Naples était profondément arriéré sur la majeure partie de son territoire, il n'en allait pas de même pour sa capitale : Naples était une ville florissante, un port majeur de la Méditerranée, la ville la plus peuplée du nouvel État loin devant Turin, Milan ou Rome (elle le restera... jusqu'au Ventennio fasciste), la première de la péninsule dotée d'un éclairage urbain public ou encore d'un chemin de fer (1839), etc. etc. Lorsque l'on voit Naples aujourd'hui, véritable 'Tiers-Monde en Europe' avec ses monceaux d'ordures non ramassées, ses rues et ses immeubles insalubres, sa misère et sa corruption, sa jeunesse livrée à la drogue et à la délinquance supervisée par la sinistre Camorra, l'on mesure toute l'ampleur du génocide social perpétré par la bourgeoisie du Nord, pour faire du Sud non seulement un grand 'marché unifié' mais aussi ce qu'il faut bien appeler une semi-colonie... Les conditions de la construction de cet État ont pu notamment se refléter dans la discipline aux armées, bon révélateur de la faiblesse du sentiment 'patriotique' à son égard : avec 2.800 soldats fusillés pour mutinerie, abandon de poste, mutilation volontaire ou désertion, et des pratiques allant jusqu'à la décimation (exécution sommaire de soldats au hasard dans une unité s'étant "mal battue" !) sous le commandement du sinistre Cadorna, l'Italie détient le record du nombre d'exécutions durant la Première Guerre mondiale loin devant tous les autres belligérants.C'est là que l'on mesure tout le grotesque et le pathétique de la Ligue du Nord du bouffon Bossi, avec ses appels à la séparation ou, en tout cas, à une large autonomie du Nord, fustigeant le parasitisme de 'Rome la voleuse' et l'arriération du Sud terrone ('cul-terreux') ; alors que celui et celle-ci, s'ils plongent - certes - leurs racines dans l'époque pontificale et bourbonienne, sont d'abord et avant tout un pur produit... de la manière dont la bourgeoisie du Nord, autrement dit ses ancêtres, a unifié et construit l'organisation politico-sociale 'Italie' selon ses intérêts ! Le fait historique est que la capitalisme italien n'aurait pas pu connaître le développement qu'il a connu (principalement sous le fascisme, puis sous le régime DC) sans le formidable réservoir de force de travail constitué par le
 Sud déshérité. L'attitude de la Ligue du Nord vis-à-vis des méridionaux (et, aujourd'hui, des immigré-e-s extra-européens ou est-européens) n'est finalement rien d'autre que celle des réacs-fascistoïdes 'français' (ceux qui se croient tels, comme dirait la chanson) vis-à-vis des immigré-e-s de l'Empire ex-/néo-colonial BBR, venu-e-s reconstruire leur État bourgeois d'incapables, qui n'a pas gagné une guerre tout seul depuis Napoléon...
Sud déshérité. L'attitude de la Ligue du Nord vis-à-vis des méridionaux (et, aujourd'hui, des immigré-e-s extra-européens ou est-européens) n'est finalement rien d'autre que celle des réacs-fascistoïdes 'français' (ceux qui se croient tels, comme dirait la chanson) vis-à-vis des immigré-e-s de l'Empire ex-/néo-colonial BBR, venu-e-s reconstruire leur État bourgeois d'incapables, qui n'a pas gagné une guerre tout seul depuis Napoléon...Le troisième et dernier aspect, enfin, c'est que cet État tard construit par une bourgeoisie faible est largement arrivé 'après la bataille' pour le partage impérialiste de la planète : l'Italie n'a jamais obtenu qu'une poignée de colonies peu productives (Somalie, Érythrée, Libye, Dodécanèse, brièvement l'Éthiopie sous Mussolini, après que ce pays africain féodal lui ait infligé une déculottée en 1896), un relatif protectorat sur l'Albanie (devenue indépendante des Ottomans en 1912), une certaine influence en Tunisie et dans les Balkans, tout ceci étant perdu au terme de la Deuxième Guerre mondiale impérialiste. Depuis, l'État italien est un État impérialiste (au stade des monopoles, comme cela est clairement exposé dans les Thèses de Lyon du PCI en 1926) mais un impérialisme faible, vassal, voué à se placer en 'poisson pilote' d'un plus gros requin et à se nourrir des miettes tombant de la gueule de ce dernier. C'est ce que fit Mussolini, d'abord agent du MI6 anglais pour faire entrer l'Italie dans la Première Guerre mondiale impérialiste aux côtés des Alliés, en s'alliant avec l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler à partir de 1936 ; puis l'Italie du régime DC s'intégra fermement dans
 le dispositif 'atlantique' du 'monde libre' pendant la Guerre froide et aujourd'hui, l'impérialisme italien oscille entre allégeance 'atlantiste' au bloc anglo-saxon (comme en Irak) et allégeance 'européiste' à l'axe franco-allemand, ces deux tendances traversant les deux grands partis bourgeois de 'centre-gauche' (PD) et de 'centre-droit' (Berlusconi) qui se partagent le pouvoir depuis plus de 20 ans.
le dispositif 'atlantique' du 'monde libre' pendant la Guerre froide et aujourd'hui, l'impérialisme italien oscille entre allégeance 'atlantiste' au bloc anglo-saxon (comme en Irak) et allégeance 'européiste' à l'axe franco-allemand, ces deux tendances traversant les deux grands partis bourgeois de 'centre-gauche' (PD) et de 'centre-droit' (Berlusconi) qui se partagent le pouvoir depuis plus de 20 ans.MAIS VOILÀ, il y a aussi, et enfin, un quatrième et dernier aspect en Italie et cet aspect, c'est un MOUVEMENT COMMUNISTE HISTORIQUEMENT PUISSANT, de TRÈS HAUT NIVEAU IDÉOLOGIQUE, même si trahi - et les masses populaires avec lui - par des révisionnistes après la Victoire antifasciste de 1945 et livré en pâture à la bourgeoisie monopoliste et à ses chaperons US et vaticans. Un mouvement qui a plus d'une fois fait ses preuves et illuminé l'histoire prolétarienne de l'Europe comme au lendemain de la Première Guerre mondiale (1919-22), dans la Résistance au fascisme (en particulier en 1943-45) ou encore dans la formidable Guerre populaire de basse intensité entre la fin des années 1960 et le début des années 1980 ; et qui n’en doutons pas illuminera encore nos rouges combats révolutionnaires de demain jusqu’à l’avènement d’un monde communiste !
Comme le dit la chanson : Il Popolo è forte e vincerà ! (le Peuple est fort et il vaincra !)
*************************************************************************************Samir Amin (Samir-Amin-developpement-inegal-et-question-nationale.pdf) :
Le cas italien.
Le cas italien est exemplaire pour deux raisons. D'abord parce qu'il est particulièrement marqué. Ensuite, parce qu'il a occasionné, beaucoup plus que les autres, un débat d'une haute tenue scientifique. La figure de Gramsci (La question méridionale) domine sans doute ce débat ; mais il faut signaler que sa grande thèse a été l'objet de remises en cause ou de compléments importants de la part d'auteurs comme E. Sereni, Rosario Roméo, Sergio Romano, Benedetto Croce, Nicola Zitara, Capacelatro et Antonio Carlo.
Première thèse : L'Italie, menacée globalement de périphérisation à l'aube du XIXème siècle, du fait de son blocage aux époques antérieures (elle perd son avance sur le reste de l'Europe dès les XIIIème et XIVème siècles et accumule les retards durant toute la période mercantiliste), échappe à ce sort par l'initiative de la bourgeoisie agraire du Nord et particulièrement du Piémont.
Le Risorgimento et l'Unité, jusqu'à l'établissement du tarif protectionniste de 1887, sont l’œuvre de cette bourgeoisie agraire nordiste. Il ne suffit pas de caractériser cette unité, comme on le fait souvent, par le compromis qui scelle l'alliance de classe entre la bourgeoisie du Nord et les féodaux du Sud, excluant la composante paysanne (du Sud notamment) de la révolution bourgeoise.
Encore faut-il rappeler que ce qu'on appelle la bourgeoisie du Nord, c'est encore, à l'époque de Cavour, principalement une bourgeoisie agraire. Elle est issue d'un double processus : de transformation interne de l'ancienne féodalité en gentlemen farmers capitalistes, et de différenciation-koulakisation au sein de la paysannerie, libérée en partie par la révolution française. La bourgeoisie de l'époque n'est pas encore industrielle. Et même sa dimension marchande est affaiblie par le long recul de Gênes et de Venise, cette dernière intégrée dans le système féodal autrichien.
La bourgeoisie agraire craint un mouvement paysan antiféodal qui, par son radicalisme, risquerait de remettre en cause son pouvoir bien établi au Piémont. C'est pourquoi elle préfère l'alliance molle des féodaux du Sud.
Elle est libre-échangiste. Non seulement parce que c'est la liberté du commerce qui lui a permis d'émerger en tant que telle, en niant les rapports féodaux ou en les contraignant à se moderniser ; mais aussi et surtout parce qu'elle envisage son insertion dans le système européen (capitaliste jeune) comme bourgeoisie agraire. Eût-elle persévéré dans cette voie, l'Italie dans son ensemble eût été périphérisée comme le fût la Hongrie.
Il est intéressant de comparer cette histoire avec celle de la Prusse et de la Russie. Ici aussi, c'est la bourgeoisie agraire latifundiaire qui prédomine. En Prusse, à l'Est de l'Elbe, elle s'appelle junker et monopolise le pouvoir d'État. Mais l'annexion de la Rhénanie par la Prusse, sans modifier le contenu de classe de l'État, lui donne une base économique industrielle naissante qui contribuera à orienter l'État allemand bismarckien dans la voie d'une industrialisation accélérée et autonome. En Russie, si le pouvoir d'État est également intégralement aristocratique (latifundiaires en voie d'insertion dans le système capitaliste, notamment après 1861), l'industrie sera favorisée par l'État pour renforcer celui-ci ; d'où le caractère mixte de l'évolution russe ultérieure : ni périphérisée totalement (comme exportateur de blé), ni évoluant franchement vers la prédominance d'une industrialisation autocentrée.
En contraste, ce que l'on peut appeler la bourgeoisie agraire des Balkans et de l'Empire ottoman s'inscrira dans le système mondial comme classe exploiteuse périphérisée. Le cas le plus typique est sans doute celui de la grande propriété égyptienne, qui se convertit d'elle-même en producteurs de coton pour l'Angleterre, après l'échec de l'industrialisation autocentrée de Mohamed Ali, sous le khédive Ismaïl, pendant la guerre de Sécession.
Les bourgeoisies agraires grecque et turque réagissent de la même manière, autour du tabac notamment. La combinaison grande propriété latifundiaire capitaliste (ou, en Grèce, petite propriété capitaliste) - bourgeoisie commerçante et financière, qui deviendra compradore, est typique de l'évolution de ces formations dont l'Italie fut menacée.
Deuxième thèse : l'industrialisation autocentrée de l'Italie a été amorcée par l'État italien, et financée par un prélèvement opéré sur la rente foncière au Nord et surtout au Sud du pays. Quatre questions se posent ici : a) le tarif protectionniste de 1887, maintenu jusqu'à l'adhésion à la perspective européenne et à son marché commun à partir de 1950-58, a-t-il été favorable ou non à cette évolution ? b) la ponction exercée sur le Sud est-elle à l'origine du développement inégal nouveau et grandissant entre le Nord et le Sud ? c) cette forme d'industrialisation a-t-elle été plus ou moins rapide que ne l'eût été une autre forme possible, fondée sur une révolution paysanne dans le Sud ? et d) l'intégration européenne contemporaine modifie-t-elle les perspectives ?
Les historiens italiens sont unanimes à convenir que l'industrialisation de l'Italie a été amorcée par le soutien systématique de l'État, suscitant la formation d'un capital financier. La prise en charge par l'État de la construction rapide d'un réseau ferroviaire et routier, la mise en place d'un système monétaire et d'un réseau de crédit, la création d'une marine marchande importante subventionnée par l'État, ont donné au capitalisme italien des structures de concentration relativement plus poussées dès le départ, un peu comme en Russie, l'Italie faisant son entrée dans l'étape monopoliste sans avoir véritablement connu l'étape antérieure. L'accentuation de ce caractère à la suite de la crise de 1930 (la création de l'IRI et de ses filiales) a donné au capitalisme italien contemporain une forte marque étatique.
Le protectionnisme a été un moyen essentiel, une condition de ce processus d'industrialisation, qui n'aurait pas été capable par lui-même de s'imposer à la concurrence des pays plus avancés sur son propre marché national.
Le discours libéral des idéologies de l'impérialisme contemporain, qui prétendent que le protectionnisme a freiné le développement par les coûts qu'il imposait et les distorsions défavorables à l'optimalité qu'il suscitait, manque totalement de dimension historique.
L'industrie italienne a-t-elle été financée par une ponction sur le Sud ? L'analyse de Gramsci ne l'exclut pas, contrairement à certaines déductions peut-être trop rapides. Gramsci se contente de constater que la bourgeoisie du Nord (agraire, puis industrielle) a fait l'Unité sans en appeler aux paysans du Sud, mais en concluant une alliance avec ses propriétaires fonciers, de style féodal. Que ces propriétaires fussent féodaux ou non est l'objet d'une question récente à ma connaissance. Mais là n'est pas la question essentielle de Gramsci. Sa thèse est seulement qu'une révolution agraire dans le Sud eût 1) accéléré le développement capitaliste et 2) rendu moins inégal ce développement entre le Nord et le Sud. Il n'y a aucun doute à avoir, en ce qui concerne la seconde conclusion, mais nous avons quelque hésitation à suivre Gramsci pour la première.
Il appartenait aux historiens méridionalistes contemporains de démontrer que l'industrialisation avait été largement financée par une ponction sur le Sud, grâce à l’État, que la bourgeoisie du Nord monopolise, en unifiant le système fiscal et celui de la dépense publique. Nicola Zitara, Capecelatro et Carlo ont, pour l'établir, comparé la charge fiscale subie respectivement par le Nord et le Sud et la distribution de la dépense publique, étudié les effets de la liquidation du Banco di Napoli au profit du système centralisé du crédit, etc.
La question du protectionnisme se greffe de nouveau sur celle de la ponction. Sereni prolonge-t-il ce qui serait seulement implicite chez Gramsci en prétendant que le protectionnisme traduisait la convergence des intérêts industriels du Nord et agrariens du Sud, puisqu'il aurait permis une augmentation du taux de la rente foncière ? C'est très discutable, parce que les intérêts agrariens protégés en l'occurrence sont ceux du Nord plutôt que ceux du Sud. Zitara, Capecelatro et Carlo ont en effet montré que l'Unité détruit l'agriculture céréalière auto-suffisante du Sud, qui ne résiste pas à la concurrence de l'agriculture céréalière et animale moderne du Nord, et impose au Sud de se spécialiser dans l'agriculture d'exportation (vin et huile).
Peut-on alors parler de véritable conquête/colonisation du Sud par le Nord ? La colonisation, à l'époque contemporaine (impérialiste), remplit une fonction précise : favoriser l'accélération de l'accumulation dans les centres dominants par la ponction d'un volume considérable de surtravail, arraché le plus souvent par le maintien/reproduction de formes d'exploitation précapitalistes d'origine mais désormais soumises. La distorsion extravertie du développement dépendant qui en résulte conditionne la reproduction de cette surexploitation.
Une telle analyse, qui est la nôtre, n'est pas incompatible avec la thèse de Gramsci. Mais elle la prolonge d'une manière que Gramsci ne pouvait faire, dans l'ignorance qu'il était de la problématique de la domination formelle par laquelle le surtravail des modes précapitalistes est transformé en plus-value et profit du capital dominant. Dans ce sens, l'Italie du Sud remplissant exactement cette fonction, la thèse des méridionalistes nous paraît correcte.
Le cas italien n'est d'ailleurs pas unique en son genre. La Nouvelle-Angleterre n'a-t-elle pas disposé d'une colonie interne analogue, le Sud esclavagiste, spécialisé dans le coton d'exportation, grâce à la surexploitation du travail des esclaves ?
Revenant à Gramsci, peut-on affirmer qu'une révolution agraire au Sud eût accéléré le développement du capitalisme italien ?
Rosario Romeo soutient le contraire. Sa thèse, qui est celle de Hobsbawn, est que la survivance des rapports féodaux a permis le maintien d'une pression sur le revenu des paysans et que le surproduit, passant par le canal de la rente, a été affecté à une accumulation rapide par le biais de la fiscalité. Une révolution agraire aurait ruiné ce modèle d'accumulation accélérée.
On a déjà dit que la révolution agraire peut donner un coup de fouet au développement capitaliste, parce que la différenciation au sein de la paysannerie soumise aux échanges marchands peut être très rapide, et que si, en France, l'industrialisation a été freinée, c'est pour une autre raison : l'alliance anti-ouvrière bourgeoisie/paysans.
Rendons justice à Gramsci : celui-ci ne se préoccupe pas du rythme de la croissance du capitalisme (qui est la préoccupation des bourgeois), mais du style de ce développement, en ce qu'il intéresse la lutte anticapitaliste.
Or, sur ce plan, il a parfaitement raison : la voie empruntée par l'Unité italienne a entraîné un développement inégal Nord-Sud, tandis que la révolution agraire eût créé les conditions d'un autre développement, homogène, donc réellement unificateur. Mais, en cela, la thèse de Gramsci n'est nullement en contradiction avec celle des méridionalistes. Gramsci constate que le développement inégal handicape la lutte anticapitaliste, parce qu'il maintient les masses rurales du Sud hors de la bataille prolétarienne. Comment lui donner tort quand on sait le soutien dont le fascisme a bénéficié en Italie méridionale ?
Les méridionalistes aujourd'hui vont seulement un peu plus loin dans le même raisonnement. Pourquoi les masses du Sud soutiennent-elles la droite ? N'est-ce pas parce que ce que leur offre la gauche à base nordique ne répond pas à leurs aspirations ? En transposant aux relations Nord-Sud la problématique centre/colonie, et en rappelant dans cette dernière la nature de l'alliance sociale-démocrate et la complicité du prolétariat nordiste, solidaire de sa bourgeoisie dans la surexploitation du «prolétariat externe» sudiste, un prolétariat de petits producteurs soumis à la domination formelle du capital, les méridionalistes ne trahissent pas Gramsci ; mais ils gênent certains...
"Histoire ancienne"... : l'immaturité du prolétariat du Nord social-démocrate (et/ou en réaction d'impuissance diront certains, anarcho-syndicaliste !), son échec en 1920-22 sont dépassés depuis 1945. De surcroît, le choix européen de l'Italie, désormais irréversible, a mis un terme aux vieux protectionnismes.
Enfin, l'émigration massive du Sud vers les usines du Nord, l'implantation de l'industrie dans le Sud, amorcée à une large échelle avec la modernisation rapide du dernier quart de siècle, ont bouleversé les données du problème ; la vieille alliance risorgimentiste est vidée de son contenu, les conditions de l'unité prolétarienne panitalienne sont créées.
Hésitons devant tant d'optimisme. Zitara a-t-il tort lorsqu'il analyse le discours ouvrier pour en faire ressortir le caractère bourgeois : l'apologie du développement des forces productives (capitalistes en l'occurrence) ? Hier, nous rappelle-t-il, la classe ouvrière n'a rien fait (sauf au plan verbal) pour soutenir une révolution agraire dans le Sud ; on suggère que c'est parce que l'on craignait, comme Roméo, un recul des forces productives. Aujourd'hui, elle voit dans l'implantation industrielle au Sud le moyen de la création d'une classe ouvrière sudiste. Zitara y décèle une appropriation de l'espace sudiste par le Grand Capital, opérant dans des conditions analogues à celles de l'exportation impérialiste des capitaux. Ajoutons que le discours européen (et l'eurocommunisme s'y soumet-il ?) inquiète toujours. Car, encore une fois, au nom du développement des forces productives, qui est l'affaire de la bourgeoisie, que ne va-t-on pas accepter ? Et comment sortir des griffes de l'Europe "germano-américaine" si l'on nourrit ce discours ?
Troisième thèse : L'Italie du Sud n'était pas plus arriérée que celle du Nord en 1860. Son retard est tout entier le résultat de sa colonisation.
Il faudrait étudier très profondément l'histoire de l'Italie pour juger de cette thèse de Capecelatro et Carlo. Mais les dévastations de l'historiographie occidentalo-centrique ailleurs incitent à prendre leurs arguments au sérieux.
Ces auteurs prétendent que l'agriculture de la Sicile, dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, avait cessé d'être féodale. Sous l'effet de l'afflux d'argent d'Amérique, via l'Espagne, la grande propriété s'était modernisée pour produire du blé marchand à grande échelle, la rente était payée en argent ; la prolétarisation rurale avancée avait permis une urbanisation et l'établissement de manufactures dont témoignent les exportations de Palerme.
L'abolition de la féodalité par Murat à Palerme répondant à des forces internes, les Bourbons à leur retour furent contraints de ne pas revenir en arrière. L'Italie du Sud s'intégrait néanmoins dans le système mondial comme périphérie, dans le sillage de l'Angleterre : les importations de ce pays avaient tué l'industrie de la soie, mais favorisé les exportations de blé. Il en était de même d'ailleurs à l'époque du Nord, dont la bourgeoisie était encore exclusivement agraire. Le Sud réagissait néanmoins pour éviter de devenir une colonie anglaise. Tel est le sens de la révolution de 1820-21, suivie de la politique d'amorce de l'industrialisation des Bourbons : protectionnisme et appel aux capitaux étrangers. L'effondrement des Bourbons est dû à l'attitude de la bourgeoisie agraire, libre-échangiste, qui abandonna son roi contre le soutien de celui de Savoie. Ainsi, ce furent les forces réactionnaires du Sud qui ont accueilli favorablement l'Unité.
Ces thèses, si elles sont fondées, contredisent-elles Gramsci ? Nous ne le pensons pas. En fait, Gramsci n'a nullement confondu capitalisme et industrie ni cru que la bourgeoisie du Nord était déjà industrielle quand elle a fait l'Unité. Mais elle allait le devenir. Certes, Gramsci sous-estimait la contribution que la surexploitation du Sud allait apporter à l'accumulation industrielle, puisqu'il ignorait la problématique de la domination formelle.
Mais ce développement prolonge Gramsci plus qu'il ne le contredit. En tout état de cause, que l'Italie du Sud ait été aussi avancée que celle du Nord en 1860 ou pas, les effets dévastateurs de l'Unité telle qu'elle a opéré ne peuvent guère être discutés. Chine ou Congo, les conséquences de l'impérialisme ont été ailleurs identiques.
Le développement inégal de l'Italie capitaliste rejoint donc par certains aspects la problématique plus générale du développement inégal centres/périphéries à l'époque impérialiste. Nous n'appliquerons pas pour autant cette conclusion à toutes les formes du développement inégal à l'intérieur des centres. Il faudrait auparavant examiner plus en détail des exemples comme ceux du régionalisme en France (Bretagne, Occitanie), comme ceux de l'Irlande et du Sud des États-Unis et se poser la question de savoir si les Noirs constituent ou non une nation...
 votre commentaire
votre commentaire
-
Nous poursuivrons notre étude européenne des processus de construction politico-militaire État moderne/État contemporain, des questions nationales et des luttes de classe, à travers l’exemple de notre grand voisin insulaire du Nord, séparé par la Manche, mais désormais – depuis 1992 – relié à nous par le formidablissime Eurostar…[Sur la construction politico-militaire 'France' : (1 – 2 – 3 et 4) ; sur l'État espagnol : ici et ici]
1. Les processus de formation nationale La Nation centrale : la Nation anglaise. C’est une nation qui, en Europe, se caractérise par l’accumulation précoce des caractéristiques pré-nationales, qui, en rencontrant aux premiers siècles du 2e millénaire les premières lueurs de l’aube capitaliste, lui donneront naissance. Romanisée superficiellement, l’île de Bretagne (Britannia), peuplée de Celtes brittons, est abandonnée précipitamment par les légions romaines au début du 5e siècle. Elle est alors envahie par des peuples germaniques du Nord de l’Allemagne actuelle (et, en partie, du Danemark) : les Angles (qui donneront leur nom à l’Angleterre), les Saxons et les Jutes. Contrairement aux invasions du continent, où les ‘barbares’ se contentent de se ‘superposer’ à la population gallo-romaine, italienne, hispano-romaine etc., cette invasion a la réputation d’avoir été particulièrement brutale, exterminatrice ; mais il s’agit peut-être d’une construction historique a posteriori : ‘légende nationale’ celtique (propagée sur le continent depuis la ‘Petite Bretagne’ armoricaine), ou réécriture de l’histoire par les nouveaux maîtres normands de l’île (à partir du 11e siècle), qui s’opposent à la noblesse ‘saxonne’, sans oublier bien sûr les constructions idéologiques germanophobes de l'époque des deux guerres mondiales... En tout cas, la langue des envahisseurs s’impose ; elle deviendra, à travers de longues évolutions, l’anglais que nous connaissons actuellement. Ils fondent sept royaumes : Northumbrie, Est-Anglie et Mercie (Angles), Essex, Wessex et Sussex (Saxons, à l’ouest, à l’est et au sud de Londres, comme leur nom l’indique), et les Jutes dans le Kent. Aux 9e-10e siècles, ces royaumes sont unifiés par les rois du Wessex : Alfred le Grand, Édouard l’Ancien, Athelstan. Mais à la même époque, les Vikings danois s’installent dans une bonne moitié (nord et est) de l’actuelle Angleterre (Danelaw, autour des ‘Cinq Bourgs’), et soumettent le reste à un tribut (Danegeld). L’île est même soumise directement à l’Empire scandinave de Knut le Grand (1016-1042) ; elle ne retrouve son indépendance qu’au milieu du 11e siècle. Une crise de succession, après Édouard le Confesseur, amène alors le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, à franchir la Manche et à s’emparer du royaume, tuant son rival Harold et soumettant la noblesse saxonne à la noblesse normande qu’il emmène avec lui. Le gallo-roman (proto-français) du Nord-Ouest de l’Hexagone (Normandie, Maine-Anjou) restera pendant longtemps (au moins jusqu’aux Tudor) la langue officielle de la Cour, de la haute aristocratie et des institutions (et parler français restera une ‘obligation’ aristocratique et grande-bourgeoise jusqu’au 19e voire 20e siècle), ce qui apportera un très important vocabulaire roman à la langue nationale. En tout cas, le royaume d’Angleterre est alors unifié et le restera ; ce qui fait de la nation anglaise l'une des plus anciennes à être politiquement unifiée en Europe. Avec toutes ces caractéristiques ‘pré-positionnées’, il va de soi que, lorsque le capitalisme commence timidement à émerger dans les bourgs et les ports, à travers le commerce de la laine avec la Flandre etc., la nation anglaise est historiquement constituée. Sous les dynasties continentales (Normands 1066-1135, Blois 1135-54, Plantagenêt 1154-1399) qui la dirigent, elle tourne – initialement – ses principaux efforts d’expansion vers le continent – le trône de France en ligne de mire ; néanmoins, elle débute aussi dès cette époque une politique de soumission des nations celtiques à son autorité.
La Nation centrale : la Nation anglaise. C’est une nation qui, en Europe, se caractérise par l’accumulation précoce des caractéristiques pré-nationales, qui, en rencontrant aux premiers siècles du 2e millénaire les premières lueurs de l’aube capitaliste, lui donneront naissance. Romanisée superficiellement, l’île de Bretagne (Britannia), peuplée de Celtes brittons, est abandonnée précipitamment par les légions romaines au début du 5e siècle. Elle est alors envahie par des peuples germaniques du Nord de l’Allemagne actuelle (et, en partie, du Danemark) : les Angles (qui donneront leur nom à l’Angleterre), les Saxons et les Jutes. Contrairement aux invasions du continent, où les ‘barbares’ se contentent de se ‘superposer’ à la population gallo-romaine, italienne, hispano-romaine etc., cette invasion a la réputation d’avoir été particulièrement brutale, exterminatrice ; mais il s’agit peut-être d’une construction historique a posteriori : ‘légende nationale’ celtique (propagée sur le continent depuis la ‘Petite Bretagne’ armoricaine), ou réécriture de l’histoire par les nouveaux maîtres normands de l’île (à partir du 11e siècle), qui s’opposent à la noblesse ‘saxonne’, sans oublier bien sûr les constructions idéologiques germanophobes de l'époque des deux guerres mondiales... En tout cas, la langue des envahisseurs s’impose ; elle deviendra, à travers de longues évolutions, l’anglais que nous connaissons actuellement. Ils fondent sept royaumes : Northumbrie, Est-Anglie et Mercie (Angles), Essex, Wessex et Sussex (Saxons, à l’ouest, à l’est et au sud de Londres, comme leur nom l’indique), et les Jutes dans le Kent. Aux 9e-10e siècles, ces royaumes sont unifiés par les rois du Wessex : Alfred le Grand, Édouard l’Ancien, Athelstan. Mais à la même époque, les Vikings danois s’installent dans une bonne moitié (nord et est) de l’actuelle Angleterre (Danelaw, autour des ‘Cinq Bourgs’), et soumettent le reste à un tribut (Danegeld). L’île est même soumise directement à l’Empire scandinave de Knut le Grand (1016-1042) ; elle ne retrouve son indépendance qu’au milieu du 11e siècle. Une crise de succession, après Édouard le Confesseur, amène alors le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, à franchir la Manche et à s’emparer du royaume, tuant son rival Harold et soumettant la noblesse saxonne à la noblesse normande qu’il emmène avec lui. Le gallo-roman (proto-français) du Nord-Ouest de l’Hexagone (Normandie, Maine-Anjou) restera pendant longtemps (au moins jusqu’aux Tudor) la langue officielle de la Cour, de la haute aristocratie et des institutions (et parler français restera une ‘obligation’ aristocratique et grande-bourgeoise jusqu’au 19e voire 20e siècle), ce qui apportera un très important vocabulaire roman à la langue nationale. En tout cas, le royaume d’Angleterre est alors unifié et le restera ; ce qui fait de la nation anglaise l'une des plus anciennes à être politiquement unifiée en Europe. Avec toutes ces caractéristiques ‘pré-positionnées’, il va de soi que, lorsque le capitalisme commence timidement à émerger dans les bourgs et les ports, à travers le commerce de la laine avec la Flandre etc., la nation anglaise est historiquement constituée. Sous les dynasties continentales (Normands 1066-1135, Blois 1135-54, Plantagenêt 1154-1399) qui la dirigent, elle tourne – initialement – ses principaux efforts d’expansion vers le continent – le trône de France en ligne de mire ; néanmoins, elle débute aussi dès cette époque une politique de soumission des nations celtiques à son autorité.  La Nation irlandaise. L’île d’Irlande (Erin pour ses habitants gaéliques, Hibernia en latin), qui n’a jamais été soumise à l’Empire romain, est en revanche convertie au christianisme dès le 5e siècle, par le fameux Saint Patrick. Dès lors, et pour près de 1000 ans, ses monastères deviennent le centre d’une brillante civilisation celtique médiévale, point de départ de la christianisation de l’Écosse, de l’Armorique (‘Petite Bretagne’, notre Breizh actuelle) et du Pays de Galles. Le catholicisme romain, celtisé (Règle de Saint Colomban etc.), deviendra une composante essentielle de l’identité nationale ; notamment lorsque la soumission à l’Angleterre se mettra réellement en place sous Henri VIII (qui a rompu avec Rome et fondé l’anglicanisme) et s’accélérera sous les révolutions anglaises (protestantes) du 17e siècle. Aux 9e-10e siècles, des Norvégiens et des Danois s’implantent sur la côte orientale, et y fondent notamment la capitale actuelle, Dublin.
La Nation irlandaise. L’île d’Irlande (Erin pour ses habitants gaéliques, Hibernia en latin), qui n’a jamais été soumise à l’Empire romain, est en revanche convertie au christianisme dès le 5e siècle, par le fameux Saint Patrick. Dès lors, et pour près de 1000 ans, ses monastères deviennent le centre d’une brillante civilisation celtique médiévale, point de départ de la christianisation de l’Écosse, de l’Armorique (‘Petite Bretagne’, notre Breizh actuelle) et du Pays de Galles. Le catholicisme romain, celtisé (Règle de Saint Colomban etc.), deviendra une composante essentielle de l’identité nationale ; notamment lorsque la soumission à l’Angleterre se mettra réellement en place sous Henri VIII (qui a rompu avec Rome et fondé l’anglicanisme) et s’accélérera sous les révolutions anglaises (protestantes) du 17e siècle. Aux 9e-10e siècles, des Norvégiens et des Danois s’implantent sur la côte orientale, et y fondent notamment la capitale actuelle, Dublin.À partir de 1166, des seigneurs anglo-normands arrivent dans les ‘bagages’ du roi ‘traître’ de Leinster, Diarmait MacMurrough, qui s’est soulevé contre le ‘roi suprême’ (Ard rí, suzerain – souvent purement symbolique – de la multitude de petits royaumes que compte l’île), allant chercher l’appui d’Henri II Plantagenêt. Ils s’y taillent des fiefs, mais ne reconnaissent pas vraiment l’autorité de leurs ‘cousins’ de Londres, et finissent par fusionner avec la population gaélique pour devenir, selon l’adage populaire, ‘plus irlandais que les Irlandais eux-mêmes’. Si le roi d’Angleterre est reconnu ‘seigneur d’Irlande’ par le Pape dès cette époque, son autorité, jusqu’au début du 16e siècle, ne s’exerce réellement que sur une petite région de quelques dizaines de kilomètres autour de Dublin :
 le ‘Pale’, qui tire son nom du fait… qu’il est carrément entouré d’une palissade, pour se protéger contre les attaques des clans gaéliques et des seigneurs irlando-normands (il correspond approximativement à la zone d’implantation scandinave du 9e siècle). Il faut dire que les ambitions anglaises, à cette époque, sont plutôt tournées vers le continent… C’est donc, on l’a dit, sous Henri VIII (qui se proclame ‘roi d’Irlande’ en 1541) que va commencer la réelle annexion et domination anglaise de l’île. Ce processus brutal, passant par la confiscation des terres (aux clans gaéliques et aux seigneurs irlando-normands) et l’établissement de nobliaux anglais ou gallois dans un système de plantations (exactement le même que, plus tard, dans les colonies d’Amérique !), dure plus de 60 ans ; malgré la résistance menée par quelques figures comme Hugh O'Neill, comte de Tyrone, il s’achève en 1607 par la "Fuite des comtes" (remplacés, là encore, par des aristocrates anglais). Dans le Nord-Est de l’île (Ulster) se développe aussi une colonisation de peuplement par des paysans anglais, gallois ou écossais protestants : il s’agit de briser le pouvoir de l’Église catholique irlandaise, dernière institution nationale encore debout – cette œuvre sera évidemment poursuivie et renforcée sous la Révolution parlementaire de 1640-60, puis après la ‘Glorieuse Révolution’ de 1688, toutes deux portées par le ‘parti protestant’ britannique. Dans la résistance à cette domination de type COLONIAL se forgera encore plus la conscience nationale irlandaise, qui débouchera sur les soulèvements nationaux de Wolfe Tone (1798), puis de Pâques 1916.
le ‘Pale’, qui tire son nom du fait… qu’il est carrément entouré d’une palissade, pour se protéger contre les attaques des clans gaéliques et des seigneurs irlando-normands (il correspond approximativement à la zone d’implantation scandinave du 9e siècle). Il faut dire que les ambitions anglaises, à cette époque, sont plutôt tournées vers le continent… C’est donc, on l’a dit, sous Henri VIII (qui se proclame ‘roi d’Irlande’ en 1541) que va commencer la réelle annexion et domination anglaise de l’île. Ce processus brutal, passant par la confiscation des terres (aux clans gaéliques et aux seigneurs irlando-normands) et l’établissement de nobliaux anglais ou gallois dans un système de plantations (exactement le même que, plus tard, dans les colonies d’Amérique !), dure plus de 60 ans ; malgré la résistance menée par quelques figures comme Hugh O'Neill, comte de Tyrone, il s’achève en 1607 par la "Fuite des comtes" (remplacés, là encore, par des aristocrates anglais). Dans le Nord-Est de l’île (Ulster) se développe aussi une colonisation de peuplement par des paysans anglais, gallois ou écossais protestants : il s’agit de briser le pouvoir de l’Église catholique irlandaise, dernière institution nationale encore debout – cette œuvre sera évidemment poursuivie et renforcée sous la Révolution parlementaire de 1640-60, puis après la ‘Glorieuse Révolution’ de 1688, toutes deux portées par le ‘parti protestant’ britannique. Dans la résistance à cette domination de type COLONIAL se forgera encore plus la conscience nationale irlandaise, qui débouchera sur les soulèvements nationaux de Wolfe Tone (1798), puis de Pâques 1916. La Nation écossaise. Elle se forme, elle aussi, sur des terres (Caledonia) qui n’ont jamais été soumises à la Britannia romaine, et même séparées d’elle par le célèbre mur d’Hadrien. Christianisée à partir des monastères irlandais, elle reste à cette époque, comme l’Irlande, une société gentilice (guerrière clanique), avec des ‘pyramides’ de clans (groupes prétendant descendre d’un même ancêtre mythique) coiffées par un ‘roi’, qui ne sert généralement que pour la guerre (en temps normal, les clans ‘font leur vie’ sur leur petit territoire). Les Romains appelaient ces peuples les Pictes (ils combattaient le corps peint, généralement de couleur bleue) ; après la chute de l’Empire viendront d’Irlande les Scots, qui donneront leur nom au pays. Les Vikings y font évidemment des incursions (et y installent des colonies) aux 9e-10e siècles. Cependant, au 11e siècle, commence à se mettre en place une monarchie unifiée (royaume d’Alba), avec la dynastie des Malcolm. Mais les appétits de l’Angleterre voisine s’éveillent dès l’époque de Guillaume le Conquérant : elle profite des divisions claniques de l’élite écossaise pour imposer sa suzeraineté au pays. La famille ‘traître’ type (pro-anglaise) de l’Écosse à cette époque sont par exemple les Balliol, qui deviennent rois inféodés à l’Angleterre à la fin du 13e siècle, sous le règne d’Édouard Ier, le ‘Philippe le Bel anglais’. Néanmoins, les clans anti-anglais résistent, sous la conduite du clan Bruce et du légendaire William Wallace : ce sont les évènements historiques racontés dans le célèbre
La Nation écossaise. Elle se forme, elle aussi, sur des terres (Caledonia) qui n’ont jamais été soumises à la Britannia romaine, et même séparées d’elle par le célèbre mur d’Hadrien. Christianisée à partir des monastères irlandais, elle reste à cette époque, comme l’Irlande, une société gentilice (guerrière clanique), avec des ‘pyramides’ de clans (groupes prétendant descendre d’un même ancêtre mythique) coiffées par un ‘roi’, qui ne sert généralement que pour la guerre (en temps normal, les clans ‘font leur vie’ sur leur petit territoire). Les Romains appelaient ces peuples les Pictes (ils combattaient le corps peint, généralement de couleur bleue) ; après la chute de l’Empire viendront d’Irlande les Scots, qui donneront leur nom au pays. Les Vikings y font évidemment des incursions (et y installent des colonies) aux 9e-10e siècles. Cependant, au 11e siècle, commence à se mettre en place une monarchie unifiée (royaume d’Alba), avec la dynastie des Malcolm. Mais les appétits de l’Angleterre voisine s’éveillent dès l’époque de Guillaume le Conquérant : elle profite des divisions claniques de l’élite écossaise pour imposer sa suzeraineté au pays. La famille ‘traître’ type (pro-anglaise) de l’Écosse à cette époque sont par exemple les Balliol, qui deviennent rois inféodés à l’Angleterre à la fin du 13e siècle, sous le règne d’Édouard Ier, le ‘Philippe le Bel anglais’. Néanmoins, les clans anti-anglais résistent, sous la conduite du clan Bruce et du légendaire William Wallace : ce sont les évènements historiques racontés dans le célèbre  film Braveheart. Finalement, Robert Bruce bat les Anglais en 1314 à la bataille de Bannockburn : à l’exception d’une nouvelle (brève) tentative anglo-Balliol au milieu du 14e siècle, l’Écosse devient alors un royaume indépendant pour près de 300 ans. Cette lutte de plusieurs siècles aura achevé de forger la conscience nationale écossaise. Dans sa lutte contre les Plantagenêt, l’aristocratie nationale anti-anglaise a recherché l’alliance ‘évidente’ pour l’époque, celle... des Capétiens : c’est l’Auld Alliance entres les royaumes de ‘France’ et d’Écosse, à l’origine d’une certaine francophilie culturelle dans cette nation. Ce n’est pas non plus un hasard si la dynastie Stuart, qui succède aux Bruce en 1371 et finira par accéder en 1603... au trône d’Angleterre, aura alors (au 17e siècle) une géopolitique clairement pro-française. Au 16e siècle (prédication de John Knox), la nation écossaise sera traversée par un clivage religieux sur une base géographique : le protestantisme presbytérien (branche du calvinisme) s’installe dans les Lowlands (Basse-Écosse) et les grandes villes (c’est la religion de la bourgeoisie en développement), tandis que le catholicisme celtisé (à l’irlandaise) se maintient dans la société clanique des Highlands et des îles (il y a pratiquement disparu depuis, notamment sous l’influence d’églises presbytériennes ‘dissidentes’ plus ‘sensibles’ à la tradition celtique : les catholiques d’Écosse sont aujourd’hui essentiellement des Irlandais d’origine). Les Stuart tenteront de ‘marier’ les deux (dans une démarche absolutiste) en mettant en avant l’épiscopalisme : une Église séparée de Rome, mais avec une hiérarchie, des évêques etc. (dont le roi, bien évidemment, est le chef suprême), sur le modèle de l’Église d’Angleterre ; cette tentative échouera. À la suite de la Glorieuse Révolution anglaise de 1688-89, l’Écosse perdra ses institutions politiques propres par l’Acte d’Union de 1707. Elle ne les retrouvera qu’en... 1997.
film Braveheart. Finalement, Robert Bruce bat les Anglais en 1314 à la bataille de Bannockburn : à l’exception d’une nouvelle (brève) tentative anglo-Balliol au milieu du 14e siècle, l’Écosse devient alors un royaume indépendant pour près de 300 ans. Cette lutte de plusieurs siècles aura achevé de forger la conscience nationale écossaise. Dans sa lutte contre les Plantagenêt, l’aristocratie nationale anti-anglaise a recherché l’alliance ‘évidente’ pour l’époque, celle... des Capétiens : c’est l’Auld Alliance entres les royaumes de ‘France’ et d’Écosse, à l’origine d’une certaine francophilie culturelle dans cette nation. Ce n’est pas non plus un hasard si la dynastie Stuart, qui succède aux Bruce en 1371 et finira par accéder en 1603... au trône d’Angleterre, aura alors (au 17e siècle) une géopolitique clairement pro-française. Au 16e siècle (prédication de John Knox), la nation écossaise sera traversée par un clivage religieux sur une base géographique : le protestantisme presbytérien (branche du calvinisme) s’installe dans les Lowlands (Basse-Écosse) et les grandes villes (c’est la religion de la bourgeoisie en développement), tandis que le catholicisme celtisé (à l’irlandaise) se maintient dans la société clanique des Highlands et des îles (il y a pratiquement disparu depuis, notamment sous l’influence d’églises presbytériennes ‘dissidentes’ plus ‘sensibles’ à la tradition celtique : les catholiques d’Écosse sont aujourd’hui essentiellement des Irlandais d’origine). Les Stuart tenteront de ‘marier’ les deux (dans une démarche absolutiste) en mettant en avant l’épiscopalisme : une Église séparée de Rome, mais avec une hiérarchie, des évêques etc. (dont le roi, bien évidemment, est le chef suprême), sur le modèle de l’Église d’Angleterre ; cette tentative échouera. À la suite de la Glorieuse Révolution anglaise de 1688-89, l’Écosse perdra ses institutions politiques propres par l’Acte d’Union de 1707. Elle ne les retrouvera qu’en... 1997. La Nation galloise. Le Pays de Galles (Cambria en latin, Cymru (prononcer ‘Keumri’) en gallois), péninsule montagneuse (sommets de plus de 1000 mètres) à l’ouest de l’île de Grande-Bretagne, n’a connu que de maigres implantations romaines. Après la chute de l’Empire, il devient un ‘refuge’ des populations celtiques face à l’invasion anglo-saxonne, à l’abri derrière… un autre mur (de terre), long de 200 kilomètres, le Offa’s Dyke. Il compte, à cette époque, une demi-douzaine de royaumes indépendants. L’un de ces royaumes, le Gwynedd (nord), unifie progressivement les autres dans la résistance aux menées anglo-normandes (à partir de 1066), processus achevé en 1258 (son souverain Llywelyn devient ‘prince des Gallois’) ; mais il est hélas trop tard : Édouard Ier d’Angleterre soumet le pays en 1282. Son fils et héritier recevra le titre de prince de Galles en 1301, tradition qui se perpétuera pour l’héritier du trône jusqu’à nos jours (équivalent du ‘dauphin’ - Dauphiné - en 'France’, du 'prince des Asturies’ en 'Espagne’ etc.). Les Galles conservent cependant une certaine autonomie, leurs institutions et coutumes, etc., jusqu’en 1536, lorsque celles-ci sont supprimées par l’Acte d’Union d’Henri VIII : une Assemblée nationale et un gouvernement gallois ne seront rétablis qu’en 1999.
La Nation galloise. Le Pays de Galles (Cambria en latin, Cymru (prononcer ‘Keumri’) en gallois), péninsule montagneuse (sommets de plus de 1000 mètres) à l’ouest de l’île de Grande-Bretagne, n’a connu que de maigres implantations romaines. Après la chute de l’Empire, il devient un ‘refuge’ des populations celtiques face à l’invasion anglo-saxonne, à l’abri derrière… un autre mur (de terre), long de 200 kilomètres, le Offa’s Dyke. Il compte, à cette époque, une demi-douzaine de royaumes indépendants. L’un de ces royaumes, le Gwynedd (nord), unifie progressivement les autres dans la résistance aux menées anglo-normandes (à partir de 1066), processus achevé en 1258 (son souverain Llywelyn devient ‘prince des Gallois’) ; mais il est hélas trop tard : Édouard Ier d’Angleterre soumet le pays en 1282. Son fils et héritier recevra le titre de prince de Galles en 1301, tradition qui se perpétuera pour l’héritier du trône jusqu’à nos jours (équivalent du ‘dauphin’ - Dauphiné - en 'France’, du 'prince des Asturies’ en 'Espagne’ etc.). Les Galles conservent cependant une certaine autonomie, leurs institutions et coutumes, etc., jusqu’en 1536, lorsque celles-ci sont supprimées par l’Acte d’Union d’Henri VIII : une Assemblée nationale et un gouvernement gallois ne seront rétablis qu’en 1999. Enfin, à la pointe de la péninsule sud-ouest de la Grande-Bretagne, dans le comté de Cornouailles, vit la Nation cornique ; là aussi, issue d’un ‘réduit’ celte face aux invasions anglo-saxonnes. Elle passe assez fréquemment sous la domination du Wessex (9e-10e siècles), et elle est rapidement soumise après l’invasion normande. Sa langue est le cornique, langue celte la plus proche du brezhoneg continental - cette langue n’a plus que quelques milliers de locuteurs. Elle est reconnue comme ‘groupe ethnique’ et ‘langue minoritaire’ par le Royaume-Uni ; selon une enquête de 2004, environ un tiers de la population du comté se reconnaît comme telle. Le comté/duché de Cornouailles est également connu pour abriter un grand domaine de 52.000 hectares qui fournit ses revenus au prince de Galles, l’héritier de la Couronne, qui ne dispose pas de ‘liste civile’ (revenus fournis par l’État).
Enfin, à la pointe de la péninsule sud-ouest de la Grande-Bretagne, dans le comté de Cornouailles, vit la Nation cornique ; là aussi, issue d’un ‘réduit’ celte face aux invasions anglo-saxonnes. Elle passe assez fréquemment sous la domination du Wessex (9e-10e siècles), et elle est rapidement soumise après l’invasion normande. Sa langue est le cornique, langue celte la plus proche du brezhoneg continental - cette langue n’a plus que quelques milliers de locuteurs. Elle est reconnue comme ‘groupe ethnique’ et ‘langue minoritaire’ par le Royaume-Uni ; selon une enquête de 2004, environ un tiers de la population du comté se reconnaît comme telle. Le comté/duché de Cornouailles est également connu pour abriter un grand domaine de 52.000 hectares qui fournit ses revenus au prince de Galles, l’héritier de la Couronne, qui ne dispose pas de ‘liste civile’ (revenus fournis par l’État).On peut également citer l’île de Man, ancienne ‘base’ viking entre l’Écosse et l’Irlande, avec la langue mannoise (celte) ; et les îles ‘anglo-normandes’, résidu insulaire du duché de Normandie après sa conquête par Philippe Auguste en 1204, avec des dialectes d’oïl proches du normand (jersiais, guernesiais, auregnais - aujourd’hui éteint - et sercquiais - 15 locuteurs) ; mais cette ‘seigneurie’ et ces ‘baillages de la Couronne’ ne font juridiquement pas partie du Royaume-Uni. Ils jouent dans l’archipel britannique un rôle de ‘paradis fiscaux’...
2. La construction étatique L’Angleterre est donc une nation politiquement unifiée lorsqu’elle entre dans la première crise générale de la féodalité, l’époque des ‘deux Guerres de Cent Ans’ (12e-15e siècles) ; crise qui voit voler en éclat le modèle de l’‘apogée féodal’, des grands duchés (ou émirats/califats musulmans) indépendants ‘coiffés’ de très loin par l’autorité de tel ou tel roi, de l’Empereur germanique ou du Pape, avec leurs campagnes produisant les bases de la reproduction des conditions d’existence, leurs villes où émerge la bourgeoisie capitaliste et leurs facultés où se développent la pensée et la connaissance ; et qui va donner naissance aux États modernes de quelques grandes lignée dans lesquels va se développer le capitalisme qui en aura finalement raison – la féodalité engendrant ses propres fossoyeurs, comme le capitalisme, plus tard, avec la révolution industrielle et l’ère des monopoles. Mais son histoire, pendant cette période, sera essentiellement tournée vers le continent, d’où sont d’ailleurs originaires les souverains (Normands puis Plantagenêt angevins) ; dans une tentative, sans doute, de rebâtir l'un de ces ‘Empires gaulois’ du Bas-Empire romain, qui régnaient à la fois sur la Gaule continentale et l’île de Bretagne [la poursuite de ces ‘rêves impériaux’ de l’Empire romain tardif sera un grand leitmotiv de toute l’époque féodale et même ‘moderne’, que ce soit avec Charlemagne, les empereurs germaniques, les ducs de Bourgogne, Charles Quint, et
L’Angleterre est donc une nation politiquement unifiée lorsqu’elle entre dans la première crise générale de la féodalité, l’époque des ‘deux Guerres de Cent Ans’ (12e-15e siècles) ; crise qui voit voler en éclat le modèle de l’‘apogée féodal’, des grands duchés (ou émirats/califats musulmans) indépendants ‘coiffés’ de très loin par l’autorité de tel ou tel roi, de l’Empereur germanique ou du Pape, avec leurs campagnes produisant les bases de la reproduction des conditions d’existence, leurs villes où émerge la bourgeoisie capitaliste et leurs facultés où se développent la pensée et la connaissance ; et qui va donner naissance aux États modernes de quelques grandes lignée dans lesquels va se développer le capitalisme qui en aura finalement raison – la féodalité engendrant ses propres fossoyeurs, comme le capitalisme, plus tard, avec la révolution industrielle et l’ère des monopoles. Mais son histoire, pendant cette période, sera essentiellement tournée vers le continent, d’où sont d’ailleurs originaires les souverains (Normands puis Plantagenêt angevins) ; dans une tentative, sans doute, de rebâtir l'un de ces ‘Empires gaulois’ du Bas-Empire romain, qui régnaient à la fois sur la Gaule continentale et l’île de Bretagne [la poursuite de ces ‘rêves impériaux’ de l’Empire romain tardif sera un grand leitmotiv de toute l’époque féodale et même ‘moderne’, que ce soit avec Charlemagne, les empereurs germaniques, les ducs de Bourgogne, Charles Quint, et  même Louis XIV voire Napoléon… Mais ils se briseront systématiquement devant la nouvelle réalité nationale qui émerge alors]. Cependant, elle commence aussi dès cette époque à se lancer à la conquête des terres celtiques (Galles, Écosse, Irlande, Cornouailles), sociétés féodales arriérées, frappées par la loi du développement inégal du fait de n’avoir jamais connu, même superficiellement, l’Empire romain. C’est ce que nous avons vu ci-dessus.
même Louis XIV voire Napoléon… Mais ils se briseront systématiquement devant la nouvelle réalité nationale qui émerge alors]. Cependant, elle commence aussi dès cette époque à se lancer à la conquête des terres celtiques (Galles, Écosse, Irlande, Cornouailles), sociétés féodales arriérées, frappées par la loi du développement inégal du fait de n’avoir jamais connu, même superficiellement, l’Empire romain. C’est ce que nous avons vu ci-dessus.La deuxième Guerre de Cent Ans (1337-1453) s’achève, donc, avec l’enterrement historique du ‘rêve continental’ (l’Angleterre ne conserve que Calais, qu’elle rendra au 16e siècle) ; et, dans les îles, la crise générale de la féodalité se prolonge par la Guerre des Deux-Roses entre les héritiers proclamés des Plantagenêt. Au terme de cette guerre civile aristocratique, où s’étripent les maisons de Lancastre et d'York – et toute la ‘fine fleur’ de la noblesse chevaleresque derrière eux, émerge une famille d’origine… galloise, les Tudor. Leur règne (1485-1603) va voir la consolidation définitive du royaume moderne d’Angleterre-Galles ; leurs principales figures seront Henri VIII (1509-1547) et Elizabeth Ière (1558-1603).
 Henri VIII, monarque autoritaire et brutal, fut réellement ce qu’il convient d’appeler un tyran, d’ailleurs considéré comme tel par ses contemporains, tant protestants (qui se développent) que catholiques (qui forment encore la grande masse de la population). Certaines sources estiment à 72.000 le nombre de personnes exécutées durant ses 38 années de règne, parfois par les moyens les plus atroces. Il n'en mourra pas moins dans son lit (obèse) à une époque où la thèse du tyrannicide se développe pourtant, tant dans les milieux catholiques papistes que dans les milieux protestants radicaux (mouvement monarchomaque), et coûtera la vie à deux rois de France consécutifs (Henri III et Henri IV). C’est lui qui, on l’a dit, lance la colonisation de l’Irlande au-delà du Pale. Par l’Acte d’Union de 1536, il met fin aux institutions particulières du Pays de Galles – son pays d’origine – qui relève dès lors directement de Londres.
Henri VIII, monarque autoritaire et brutal, fut réellement ce qu’il convient d’appeler un tyran, d’ailleurs considéré comme tel par ses contemporains, tant protestants (qui se développent) que catholiques (qui forment encore la grande masse de la population). Certaines sources estiment à 72.000 le nombre de personnes exécutées durant ses 38 années de règne, parfois par les moyens les plus atroces. Il n'en mourra pas moins dans son lit (obèse) à une époque où la thèse du tyrannicide se développe pourtant, tant dans les milieux catholiques papistes que dans les milieux protestants radicaux (mouvement monarchomaque), et coûtera la vie à deux rois de France consécutifs (Henri III et Henri IV). C’est lui qui, on l’a dit, lance la colonisation de l’Irlande au-delà du Pale. Par l’Acte d’Union de 1536, il met fin aux institutions particulières du Pays de Galles – son pays d’origine – qui relève dès lors directement de Londres.Il fonde aussi – surtout – l'un des piliers de l’État anglais/britannique, son Église : l’Église anglicane (1534), qui n’est pas (contrairement à l’idée largement répandue) une Église protestante (luthérienne ou calviniste), mais une Église ‘catholique autocéphale’, avec des évêques, des archevêques (Cantorbéry), des diacres et autres abbés, mais séparée de Rome, et dont le ‘pape’ est le roi, qui nomme les évêques. Ceci, officiellement, pour permettre les divorces de ce grand ‘sex addict’ de son époque (l’épouse répudiée finissant généralement la tête sur le billot…), mais en réalité, ce ne fut là qu'un prétexte, le conflit entre la monarchie londonienne (comme toutes les autres grandes monarchies construisant l’État moderne) et la papauté (la grande ‘superpuissance’ géopolitique du Moyen-Âge révolu) étant latent depuis des générations (seule l’’Espagne’, en fin de compte, fondera son idéologie d’État moderne sur le rôle de bras séculier universel du catholicisme romain et de l’autorité papale). Par la suite, s’alterneront des rois et des reines d’inclinaison pro-catholique ou pro-protestante, ce qui est souvent simplifié par les historiens en ‘roi/reine catholique’ ou ‘roi/reine protestant(e)’ ; mais en réalité le/la souverain(e) sera toujours chef de l’Église d’Angleterre. Le catholicisme romain deviendra un élément de conscience nationale en Irlande et dans les Highlands écossais, le calvinisme plus ou moins puritain un élément ‘identitaire’ de la bourgeoisie révolutionnaire anglaise du 17e siècle, et son pendant presbytérien un élément de conscience nationale en Basse-Écosse ; mais en Angleterre et au Pays de Galles, les larges masses du peuple ‘suivront’ le mouvement et se rallieront à l’Église d’Angleterre (elle compte encore 25 millions de baptisé-e-s aujourd’hui dans ces deux nations).
Si Henri VIII peut asseoir ce pouvoir, y compris – donc – théocratique (puisqu’il est aussi le chef suprême de l’Église), face à la bourgeoisie calviniste et aux grandes masses du peuple (dans toutes les nations) encore largement catholiques, c’est qu’il a l’appui d’une classe qui deviendra essentielle dans la Grande-Bretagne moderne et contemporaine bourgeoise : l’aristocratie terrienne, qui commence à ‘muter’ en grande propriété capitaliste agraire. C'est-à-dire que cette noblesse de landlords ne se contente plus d’exercer une propriété éminente (prélèvement d’impôts, taxes, péages en tout genre) sur ses domaines, mais s’approprie la propriété utile de la terre comme moyen de production, y
 compris des ‘terres du commun’ (pâturages, forêts) qui assuraient une part primordiale de la subsistance des petits paysans yeomen. À ceci s’ajoutent les attaques contre l’Église et ses propriétés, qui jouaient un rôle d’amortisseur social de premier ordre dans les périodes difficiles. C’est le phénomène des enclosures, qui se poursuivra jusqu’au milieu du 18e siècle. Cette appropriation brutale des terres d’usage collectif, et les innombrables expulsions pour dettes, jettent sur les routes des milliers de pauvres hères qu’une loi de 1531 (Beggars Act) punit de… marquage au fer rouge, mutilations, travaux forcés ou carrément de pendaison ( !) pour 'vagabondage'*. Ces populations errantes, ‘sans feu ni lieu’, seront progressivement prises en charges sous Elizabeth Ière par les Poor Laws, qui mettent en place dans les paroisses civiles anglicanes un système d’assistance alimentaire minimale (par taxation des plus aisés) et de… travail obligatoire, dans des ateliers paroissiaux concentrationnaires (workhouses) : la paysannerie sans terre se transformera ainsi, progressivement, en classe ouvrière qui deviendra au 18e siècle la plus importante du monde. Les workhouses seront abolies en… 1930.
compris des ‘terres du commun’ (pâturages, forêts) qui assuraient une part primordiale de la subsistance des petits paysans yeomen. À ceci s’ajoutent les attaques contre l’Église et ses propriétés, qui jouaient un rôle d’amortisseur social de premier ordre dans les périodes difficiles. C’est le phénomène des enclosures, qui se poursuivra jusqu’au milieu du 18e siècle. Cette appropriation brutale des terres d’usage collectif, et les innombrables expulsions pour dettes, jettent sur les routes des milliers de pauvres hères qu’une loi de 1531 (Beggars Act) punit de… marquage au fer rouge, mutilations, travaux forcés ou carrément de pendaison ( !) pour 'vagabondage'*. Ces populations errantes, ‘sans feu ni lieu’, seront progressivement prises en charges sous Elizabeth Ière par les Poor Laws, qui mettent en place dans les paroisses civiles anglicanes un système d’assistance alimentaire minimale (par taxation des plus aisés) et de… travail obligatoire, dans des ateliers paroissiaux concentrationnaires (workhouses) : la paysannerie sans terre se transformera ainsi, progressivement, en classe ouvrière qui deviendra au 18e siècle la plus importante du monde. Les workhouses seront abolies en… 1930. L’aristocratie ‘mutée’ en classe agro-capitaliste, elle, deviendra un pilier de la révolution industrielle britannique qui commencera dès le 18e siècle : non seulement elle produit l’alimentation de la population (donc les moyens de reproduction de la force de travail), mais elle fournit aussi la laine pour l’industrie textile (que l’Angleterre développe en propre, dès lors que les Pays-Bas sont ‘espagnols’, puis autrichiens), le bois de construction, et elle exploite sur ses terres les mines de charbon et de métaux qui seront les matières premières essentielles de l’industrie du royaume.
L’aristocratie ‘mutée’ en classe agro-capitaliste, elle, deviendra un pilier de la révolution industrielle britannique qui commencera dès le 18e siècle : non seulement elle produit l’alimentation de la population (donc les moyens de reproduction de la force de travail), mais elle fournit aussi la laine pour l’industrie textile (que l’Angleterre développe en propre, dès lors que les Pays-Bas sont ‘espagnols’, puis autrichiens), le bois de construction, et elle exploite sur ses terres les mines de charbon et de métaux qui seront les matières premières essentielles de l’industrie du royaume.Le règne d’Elizabeth Ière (1558-1603), après le ‘coup de barre’ catholicisant de Marie la Sanglante (1553-58), voit une politique ultra-favorable à la bourgeoisie protestante, et un petit ‘Demi-Siècle d’Or’ britannique qui forge profondément la culture nationale dominante : c’est l’époque de Shakespeare, de l’architecture et de toute la culture ‘élisabéthaine’, premier ‘âge d’or’ avant l’époque victorienne du 19e siècle. Amie de la Réforme
 protestante (notamment aux Pays-Bas, dont les provinces du Nord luttent pour l’indépendance, et en ‘France’ pendant les Guerres de Religion), l’Angleterre se dresse alors contre l’imperium mundi espagnol, dans une guerre – peut-être l'une des premières à pouvoir être qualifiée de mondiale – qui verra notamment l’Invincible Armada de Philippe II, envoyée pour envahir le royaume, être anéantie au large de Gravelines ; les exploits du corsaire Francis Drake qui réalise le tour du monde en 1577-80 et malmène les colonies espagnoles d’Amérique ; ou encore la prise de possession de Terre-Neuve en 1583 (déjà reconnue par Jean Cabot, au service du roi d’Angleterre, en 1497), et de la Virginie et de la Caroline du Nord en 1584 par sir Walter Raleigh, la reine concédant à celui-ci ‘’tous les pays lointains païens et barbares non actuellement possédés par prince ou peuple chrétien’’ : ce sera là le point de départ de la colonisation outre-Atlantique (à partir de 1607), qui donnera naissance au premier empire colonial britannique (que l’on peut faire aller jusqu’à l’indépendance US), et dont tout(e) un(e) chacun(e) connaît la postérité historique…
protestante (notamment aux Pays-Bas, dont les provinces du Nord luttent pour l’indépendance, et en ‘France’ pendant les Guerres de Religion), l’Angleterre se dresse alors contre l’imperium mundi espagnol, dans une guerre – peut-être l'une des premières à pouvoir être qualifiée de mondiale – qui verra notamment l’Invincible Armada de Philippe II, envoyée pour envahir le royaume, être anéantie au large de Gravelines ; les exploits du corsaire Francis Drake qui réalise le tour du monde en 1577-80 et malmène les colonies espagnoles d’Amérique ; ou encore la prise de possession de Terre-Neuve en 1583 (déjà reconnue par Jean Cabot, au service du roi d’Angleterre, en 1497), et de la Virginie et de la Caroline du Nord en 1584 par sir Walter Raleigh, la reine concédant à celui-ci ‘’tous les pays lointains païens et barbares non actuellement possédés par prince ou peuple chrétien’’ : ce sera là le point de départ de la colonisation outre-Atlantique (à partir de 1607), qui donnera naissance au premier empire colonial britannique (que l’on peut faire aller jusqu’à l’indépendance US), et dont tout(e) un(e) chacun(e) connaît la postérité historique…
À sa mort, célibataire et sans héritier légitime, lui succède le fils de sa cousine (qu’elle fît exécuter pour trahison en 1587…), le roi… d’Écosse Jacques VI Stuart, qui réunit de fait ce pays (après trois siècles d’indépendance) au royaume d’Angleterre-Galles-Irlande. L’Angleterre (avec le Pays de Galles et l’Irlande) a donc alors pour souverain le monarque de cette Écosse qu’elle aura cherché à soumettre pendant tout le Bas Moyen-Âge. Pour ce dernier, quelle aubaine que de mettre la main sur l’appareil politico-militaire anglais : théoricien de l’absolutisme, il est en effet contesté depuis le début de son règne (effectif en 1583) par ses sujets écossais, aussi bien presbytériens des Lowlands que catholiques papistes des Highlands et des îles. Il s’installe à Londres, où il est couronné, et ne retournera qu’une seule fois à Édimbourg.
Mais son intronisation marque en fait le début (latent jusqu’à la fin des années 1630, ouvert ensuite) de ce que les historiens britanniques appellent les Guerres des Trois Royaumes (Angleterre, Irlande et Écosse), d’où surgira la révolution bourgeoise anglaise : une explosion de toutes les contradictions contenues dans les Îles Britanniques, dans un dernier râle d’agonie de la féodalité médiévale ; contradictions nationales et contradictions de classe (entre monarchie, aristocratie moderniste ou traditionaliste, bourgeoisies et paysanneries des différentes nations, et même
 prolétariat naissant), sous les bannières religieuses de l’anglicanisme, du catholicisme romain, du calvinisme plus ou moins ‘radical’ et de sa déclinaison presbytérienne écossaise, ou de courants communistes chrétiens de type messianique (Diggers).
prolétariat naissant), sous les bannières religieuses de l’anglicanisme, du catholicisme romain, du calvinisme plus ou moins ‘radical’ et de sa déclinaison presbytérienne écossaise, ou de courants communistes chrétiens de type messianique (Diggers).Jacques Ier (numérotation anglaise, il reste ‘VI’ d’Écosse) achève, on l’a dit, la soumission de l’Irlande (‘fuite des comtes’) et développe l’implantation permanente en Amérique du Nord (Terre-Neuve, Virginie, Nouvelle-Angleterre avec les ‘Pères pèlerins’) et aux Caraïbes – profitant de cela pour ‘éloigner’, au passage, des communautés politico-religieuses trop remuantes ; idéologue absolutiste sur le modèle ‘français’ d'Henri III et Henri IV, il parvient, non sans contestations, à maintenir un certain équilibre (de classes, religieux et national). Mais son successeur Charles Ier épouse, à peine devenu roi, la fille d’Henri IV (et sœur de Louis XIII), et son contrat de mariage révèle des clauses (au départ secrètes) pro-catholiques et pro-françaises : cela – et ses conceptions absolutistes, dans la lignée paternelle – soulève l’opposition farouche du Parlement anglais, qui ne cessera de dégénérer jusqu’au conflit ouvert à partir de 1640.
Le Parlement : l’institution anglaise par excellence, qu’aucun monarque n’aura jamais réussi à soumettre, et qui deviendra le centre d’agrégation de la révolution bourgeoise contre les prétentions absolutistes des Stuart. Prenant racine dans la culture politique celte et germano-scandinave de l’assemblée des guerriers, il est né officiellement en 1215 (Grande Charte) comme représentation nationale des classes supérieures (aristocratie, clergé, bourgeoisie, paysannerie aisée), réparties entre une Chambre des Lords (aristocratie et clergé) et une Chambre des Communes (équivalente du ‘Tiers-État’ continental, plus les ‘chevaliers’ de petite noblesse) ; mais il se distingue des États généraux
 ‘français’ par son caractère quasi-permanent (alors que les États étaient réunis ‘au bon vouloir’ du roi). Depuis le 14e siècle, sa langue de délibération est l’anglais, et non le roman proto-français de la monarchie (d’origine normande puis angevine), ce qui renforce encore son caractère national ; expression (à travers les couches les plus aisées) d’une formation nationale précoce et culturellement rétive au pouvoir arbitraire et sans limite d’un souverain.
‘français’ par son caractère quasi-permanent (alors que les États étaient réunis ‘au bon vouloir’ du roi). Depuis le 14e siècle, sa langue de délibération est l’anglais, et non le roman proto-français de la monarchie (d’origine normande puis angevine), ce qui renforce encore son caractère national ; expression (à travers les couches les plus aisées) d’une formation nationale précoce et culturellement rétive au pouvoir arbitraire et sans limite d’un souverain.C'est qu’il faut bien comprendre que l'Angleterre, superficiellement romanisée et abandonnée précipitamment par les légions en l’an 410, ne comptant guère qu'un million d'habitants en l'An 1000... contre 5 à 7 millions en 1300 et 8,3 millions en 1801 (premier recensement depuis le Domesday Book de 1086), s'est fondamentalement construite comme une nation de 'défricheurs' (yeomen)[1], partant ensuite (à partir du 13e siècle) à la conquête des terres celtiques (Galles, Écosse, Irlande) encore moins peuplées et plus sauvages ; donnant ainsi naissance à une conscience nationale de 'pionniers' et à une culture politique des 'libertés anglaises' qui se transporteront ensuite (avec les colons) en Amérique, en Australie etc. (si les colonies d'Amérique avaient eu leur propre Parlement pour voter leurs propres lois, ou en tout cas, avaient été représentées à Westminster, la Guerre d'Indépendance américaine n'aurait probablement jamais eu lieu et les actuels USA auraient suivi l'évolution politique du Canada ou de l'Australie, où Londres ne répéta pas les mêmes erreurs) ; culture politique où la 'volonté générale' (des classes dominantes et des éléments non-conscients des classes subalternes, qui leurs sont politiquement soumis) s'exprime – donc – dans le Parlement, héritier de l''assemblée des guerriers' celtes, anglo-saxons ou scandinaves, et non dans le Léviathan monarchique héritier de l’Empereur romain. Du règne des Normands (1066-1135) puis des Plantagenêts (1154-1399) jusqu'aux Stuarts amis de Louis XIII et Louis XIV (1603-1649 et 1660-1688), l'idée d'un pouvoir monarchique fort, absolu, a toujours été considérée outre-Manche comme une idée française.
 D'ailleurs, un fait notable est qu'en plus du 1000 ans, du 11e siècle jusqu'à nos jours, l'Angleterre n'a connu pratiquement aucun régicide sinon celui d'Edouard II en 1327 (sur ordre de la reine, pour permettre l'accession au trône de son fils) et l'exécution de Charles Ier en 1649 (par les parlementaires bourgeois de Cromwell), alors que la France en connût, rien qu'entre le 16e et le 19e siècle, deux (Henri III et Henri IV), un probable (Charles IX) et plusieurs tentatives (contre Louis XV et Louis-Philippe, ainsi que plusieurs contre les deux Napoléon), sans oublier l'exécution révolutionnaire de Louis XVI. En revanche, le catholique Guy Fawkes tentera, en 1605, de faire sauter le Parlement (où le roi, certes, devait également se trouver), évènement inspirateur de la célèbre BD 'V pour Vendetta' de l'anarchiste Alan Moore (avec son célèbre masque de Fawkes porté par le 'vengeur', repris par de nombreux mouvements contestataires actuels), dont la scène finale est d'ailleurs l'explosion de Westminster : ceci montre bien, pour les Anglo-Saxons, où se situe le centre du pouvoir d'État.
D'ailleurs, un fait notable est qu'en plus du 1000 ans, du 11e siècle jusqu'à nos jours, l'Angleterre n'a connu pratiquement aucun régicide sinon celui d'Edouard II en 1327 (sur ordre de la reine, pour permettre l'accession au trône de son fils) et l'exécution de Charles Ier en 1649 (par les parlementaires bourgeois de Cromwell), alors que la France en connût, rien qu'entre le 16e et le 19e siècle, deux (Henri III et Henri IV), un probable (Charles IX) et plusieurs tentatives (contre Louis XV et Louis-Philippe, ainsi que plusieurs contre les deux Napoléon), sans oublier l'exécution révolutionnaire de Louis XVI. En revanche, le catholique Guy Fawkes tentera, en 1605, de faire sauter le Parlement (où le roi, certes, devait également se trouver), évènement inspirateur de la célèbre BD 'V pour Vendetta' de l'anarchiste Alan Moore (avec son célèbre masque de Fawkes porté par le 'vengeur', repris par de nombreux mouvements contestataires actuels), dont la scène finale est d'ailleurs l'explosion de Westminster : ceci montre bien, pour les Anglo-Saxons, où se situe le centre du pouvoir d'État.En 1640-42, donc, dans un contexte de révolte (à la fois bourgeoise presbytérienne et aristocratique-nationale) en Écosse, le Parlement de nouveau réuni (après avoir été ‘ignoré’ pendant 11 ans, sur le ‘modèle’ français) entre en guerre ouverte contre le souverain. Les Cavaliers (partisans du roi) affrontent les Têtes rondes (partisans du Parlement, ainsi appelés car les bourgeois parlementaires
 protestants ont les cheveux plutôt courts, ‘à rebours’ de la mode aristocratique de l’époque). En 1648, Charles Ier est vaincu, fait prisonnier, amené devant le Parlement, jugé et décapité (janvier 1649). Le ‘général en chef’ des armées Têtes rondes, Oliver Cromwell, proclame le Commonwealth, une république bourgeoise calviniste radicale.
protestants ont les cheveux plutôt courts, ‘à rebours’ de la mode aristocratique de l’époque). En 1648, Charles Ier est vaincu, fait prisonnier, amené devant le Parlement, jugé et décapité (janvier 1649). Le ‘général en chef’ des armées Têtes rondes, Oliver Cromwell, proclame le Commonwealth, une république bourgeoise calviniste radicale.C’est là une expérience politique inédite pour son époque, très… et même trop radicale ; regardée avec suspicion même par la république bourgeoise calviniste des Provinces-Unies (actuels Pays-Bas). Évidemment, la monarchie absolue française et la monarchie catholique espagnole, la Papauté et l’Empire germanique – tenu par l’Autriche catholique – ne souhaitent rien d’autre que sa perte. Mais même la noblesse insulaire, devenue capitaliste terrienne et qui avait pu se dresser contre l’absolutisme de Charles Ier, trouve que les choses vont trop loin. Le Parlement, d’ailleurs, se dépeuple des adversaires de la ligne Cromwell ; en 1649, pour condamner le roi, il ne reste que quelques dizaines de représentants : c’est le Rump Parliament (Parlement ‘croupion’). Et puis, c’est une république bourgeoise anglaise, et même sud-anglaise, londonienne, qui poursuit et même renforce, férocement, la politique de domination de Londres sur les nations celtiques et – même – la périphérie anglaise. En réaction, évidemment, toutes les classes de celles-ci (de la paysannerie la plus misérable à la noblesse autochtone) tendent à prendre le
 parti de l’héritier (Charles II) du roi déchu, que ce soit en Irlande (soumise à une véritable guerre d’extermination), en Haute-Écosse (après la deuxième révolution de 1688-89, on parlera dans ces deux territoires de parti jacobite), mais aussi en Basse-Écosse presbytérienne (covenantaire) qui se rallie à Charles Ier (avant tout Stuart, donc compatriote) peu avant sa défaite et sa mort, puis quasi-immédiatement à son successeur ; au Pays de Galles et en Cornouailles, en Angleterre du Sud-Ouest et du Nord, etc. (la carte montrant les ‘retranchements’ de ‘parti royal’, pendant la guerre civile contre le Parlement, est éloquente quand à la traduction territoriale de ces contradictions).
parti de l’héritier (Charles II) du roi déchu, que ce soit en Irlande (soumise à une véritable guerre d’extermination), en Haute-Écosse (après la deuxième révolution de 1688-89, on parlera dans ces deux territoires de parti jacobite), mais aussi en Basse-Écosse presbytérienne (covenantaire) qui se rallie à Charles Ier (avant tout Stuart, donc compatriote) peu avant sa défaite et sa mort, puis quasi-immédiatement à son successeur ; au Pays de Galles et en Cornouailles, en Angleterre du Sud-Ouest et du Nord, etc. (la carte montrant les ‘retranchements’ de ‘parti royal’, pendant la guerre civile contre le Parlement, est éloquente quand à la traduction territoriale de ces contradictions).Le régime s’effondre en 1660 (Cromwell est mort en 1658, son fils lui succédant) et Charles II rétablit donc une monarchie de tendance absolutiste, pro-catholique et pro-française ; ce qui, évidemment, multiplie les mécontents. Pratiquant au début une politique de tolérance politico-religieuse (logique vue la largeur de l’alliance qui l’a ramené sur le trône), son règne se durcit (et assume l’alliance ouverte avec Louis XIV et le parti-pris catholique) à partir des années 1670 ; le Parlement est dissous en 1681 et ne sera plus réuni jusqu’à sa mort (1685). C’est à cette époque que se forment au Parlement, sur la question d’exclure le fils du roi de la succession pour cause de papisme, les partis whig (favorable à cette exclusion) et tory (hostile, partisan du roi et de son héritier légitime) : s’extrayant petit à petit (au 18e siècle) de toute question religieuse, ils deviendront ni plus ni moins que le parti libéral et le parti conservateur qui structureront la vie politique britannique jusqu’en 1940 (les libéraux ont aujourd’hui été remplacés par les travaillistes).
 Succédant à son père en 1685, Jacques II Stuart poursuit la même politique. La ‘solution’, pour les parlementaires et toutes les forces que le développement capitaliste des forces productives met ‘en ébullition’ sous la chape absolutiste, semble alors être trouvée en la personne d’un prince protestant d’outre-Manche, gendre de Jacques II : le prince Guillaume III d’Orange-Nassau, stathouder (gouverneur militaire) de Hollande. Il a dirigé, à ce poste, la résistance néerlandaise à la guerre exterminatrice menée par Louis XIV (1672-78) contre les Provinces-Unies. Il lui voue depuis une haine inexpiable et en 1688, il est l’un des principaux organisateurs de la Grande Alliance qui se forme en Europe (y compris avec des puissances catholiques comme l’Autriche, l’Espagne, le Portugal, la Bavière et même le Saint-Siège) contre l’hégémonie du Roi Soleil. Jacques II, lui, demeure un fidèle allié du roi de France. Guillaume d’Orange débarque alors en Angleterre ; Jacques II s’enfuit en France et le stathouder hollandais est proclamé roi par le Parlement : c’est la Glorieuse Révolution. Le consensus orangiste autour de lui est, cette fois-ci, large : bourgeoisie anglaise protestante et anglicane, landlords agro-capitalistes anglais d’Angleterre ou établis dans les terres celtiques, Lowlands presbytériens d’Écosse, etc. Seuls la nation irlandaise et les Highlands écossais s’accrochent encore, par réaction nationale et religieuse, à Jacques II Stuart (roi catholique et écossais, ‘celte’), que Louis XIV aidera jusqu’à sa mort dans ses tentatives de reconquérir son trône ; mais c’est là (comme le foralisme basque du 19e siècle) un mouvement anti-historique : l’Europe entre peu à peu dans le Siècle des Lumières, et ce sont Guillaume d’Orange et les parlementaires anglais qui sont ‘dans le sens de l’histoire’. En Écosse, les jacobites sont globalement vaincus au début du 18e siècle, quelques révoltes seront encore écrasées jusqu’en 1746. L'affaire se solde finalement en 1707, avec le soutien de la majorité presbytérienne, par l’Acte d’Union qui supprime les institutions nationales (les représentants écossais siègeront désormais à Westminster) pour donner naissance au Royaume Uni de Grande-Bretagne (un projet raté de colonisation en Amérique centrale, qui laissera ruinée une bonne partie de la noblesse 'investisseuse' et de la grande bourgeoisie écossaise, pèsera également lourd dans ce dénouement : c'est tout simplement la promesse de renflouement des actionnaires 'malheureux' par Londres qui 'achètera' le vote du Parlement écossais - "une nation vendue par une poignée de fripouilles contre l'or des Anglais", s'exclamera le poète Robert Burns). En Irlande, la bataille de la Boyne (1690) sonne le glas définitif de la résistance à la colonisation de l’île, asseyant la domination anglaise pour plus de deux siècles ; c’est cette bataille qui est commémorée chaque année (12 juillet) par l’Ordre d’Orange ‘loyaliste’ d’Irlande du Nord.
Succédant à son père en 1685, Jacques II Stuart poursuit la même politique. La ‘solution’, pour les parlementaires et toutes les forces que le développement capitaliste des forces productives met ‘en ébullition’ sous la chape absolutiste, semble alors être trouvée en la personne d’un prince protestant d’outre-Manche, gendre de Jacques II : le prince Guillaume III d’Orange-Nassau, stathouder (gouverneur militaire) de Hollande. Il a dirigé, à ce poste, la résistance néerlandaise à la guerre exterminatrice menée par Louis XIV (1672-78) contre les Provinces-Unies. Il lui voue depuis une haine inexpiable et en 1688, il est l’un des principaux organisateurs de la Grande Alliance qui se forme en Europe (y compris avec des puissances catholiques comme l’Autriche, l’Espagne, le Portugal, la Bavière et même le Saint-Siège) contre l’hégémonie du Roi Soleil. Jacques II, lui, demeure un fidèle allié du roi de France. Guillaume d’Orange débarque alors en Angleterre ; Jacques II s’enfuit en France et le stathouder hollandais est proclamé roi par le Parlement : c’est la Glorieuse Révolution. Le consensus orangiste autour de lui est, cette fois-ci, large : bourgeoisie anglaise protestante et anglicane, landlords agro-capitalistes anglais d’Angleterre ou établis dans les terres celtiques, Lowlands presbytériens d’Écosse, etc. Seuls la nation irlandaise et les Highlands écossais s’accrochent encore, par réaction nationale et religieuse, à Jacques II Stuart (roi catholique et écossais, ‘celte’), que Louis XIV aidera jusqu’à sa mort dans ses tentatives de reconquérir son trône ; mais c’est là (comme le foralisme basque du 19e siècle) un mouvement anti-historique : l’Europe entre peu à peu dans le Siècle des Lumières, et ce sont Guillaume d’Orange et les parlementaires anglais qui sont ‘dans le sens de l’histoire’. En Écosse, les jacobites sont globalement vaincus au début du 18e siècle, quelques révoltes seront encore écrasées jusqu’en 1746. L'affaire se solde finalement en 1707, avec le soutien de la majorité presbytérienne, par l’Acte d’Union qui supprime les institutions nationales (les représentants écossais siègeront désormais à Westminster) pour donner naissance au Royaume Uni de Grande-Bretagne (un projet raté de colonisation en Amérique centrale, qui laissera ruinée une bonne partie de la noblesse 'investisseuse' et de la grande bourgeoisie écossaise, pèsera également lourd dans ce dénouement : c'est tout simplement la promesse de renflouement des actionnaires 'malheureux' par Londres qui 'achètera' le vote du Parlement écossais - "une nation vendue par une poignée de fripouilles contre l'or des Anglais", s'exclamera le poète Robert Burns). En Irlande, la bataille de la Boyne (1690) sonne le glas définitif de la résistance à la colonisation de l’île, asseyant la domination anglaise pour plus de deux siècles ; c’est cette bataille qui est commémorée chaque année (12 juillet) par l’Ordre d’Orange ‘loyaliste’ d’Irlande du Nord. Ainsi s’achève le siècle des ‘Guerres des Trois Royaumes’. Au terme de celui-ci, l’État britannique est parachevé comme État moderne – parachèvement définitivement sanctionné par l’Acte d’Union de l’Irlande (1800), où le Parlement irlandais dont sont exclus les non-anglicans (90% de la population…) fusionne à son tour avec Westminster, donnant réellement naissance au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande ; et il a connu sa révolution parlementaire bourgeoise (et ‘aristo-moderniste’ : l’aristocratie terrienne a achevé sa ‘mutation’ capitaliste, elle n’est plus une classe parasitaire, bureaucratique et rentière comme en ‘France’, mais au contraire un ‘pilier’ essentiel de la révolution industrielle qui commence), initiant ainsi sa ‘mutation’ en État contemporain, à travers l’activisme whig du 18e siècle jusqu’à la Reform des années 1830 ; processus que l’on peut considérer achevé à l’époque victorienne (1837-1901) – mais qui, par certains aspects, peut se prolonger jusqu’au 20e siècle.
Ainsi s’achève le siècle des ‘Guerres des Trois Royaumes’. Au terme de celui-ci, l’État britannique est parachevé comme État moderne – parachèvement définitivement sanctionné par l’Acte d’Union de l’Irlande (1800), où le Parlement irlandais dont sont exclus les non-anglicans (90% de la population…) fusionne à son tour avec Westminster, donnant réellement naissance au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande ; et il a connu sa révolution parlementaire bourgeoise (et ‘aristo-moderniste’ : l’aristocratie terrienne a achevé sa ‘mutation’ capitaliste, elle n’est plus une classe parasitaire, bureaucratique et rentière comme en ‘France’, mais au contraire un ‘pilier’ essentiel de la révolution industrielle qui commence), initiant ainsi sa ‘mutation’ en État contemporain, à travers l’activisme whig du 18e siècle jusqu’à la Reform des années 1830 ; processus que l’on peut considérer achevé à l’époque victorienne (1837-1901) – mais qui, par certains aspects, peut se prolonger jusqu’au 20e siècle.Un processus avec tous ses forts particularismes. Le processus, allant de la rupture d’Henri VIII avec Rome jusqu’à l’avènement de Guillaume d’Orange, s’est essentiellement déroulé sous des drapeaux religieux (catholicisme romain, anglicanisme, calvinisme ou presbytérianisme, puritanisme etc.) : ceci imprègnera profondément les consciences pour plus de deux siècles et demi, jusqu’à un mouvement de sécularisation massive de la société (en tout cas, en Angleterre, Galles et Lowlands) à partir des années 1950 ; imprégnant y compris (comme le relevait Lénine peu avant 1900) les débuts du mouvement ouvrier (chartisme à partir des années 1830, trade-unionisme), dans un esprit digger. Le Pays de Galles et les Cornouailles revendiquent, aujourd’hui, avant tout leur ‘celticité’, et l’Écosse, son existence de royaume indépendant entre 1314 et 1603 ; mais en Irlande, même si le drapeau vert, blanc et orange symbolise la volonté d’unité nationale
 par-delà les religions (le vert symbolise le catholicisme, l’orange le protestantisme et le blanc, la concorde entre les deux), le catholicisme reste une composante essentielle de la conscience nationale, même si la société s’est – là aussi – beaucoup sécularisée depuis les années 1960-70, et même si cela est parfois exagéré d’un point de vue ‘continental’ : les choses sont présentées comme un affrontement entre ‘catholiques’ et ‘protestants’, alors que les acteurs du conflit eux-mêmes, d’un côté comme de l’autre, ne présentent généralement pas les choses ainsi : on parle le plus souvent de quartiers ‘nationalistes’ et ‘loyalistes’ (et non ‘catholiques’ et ‘protestants’), et l’on ne jure pas fidélité à une Église ou à une autre, mais à la Reine ou à la République proclamée en 1916 (que les républicains authentiques ne reconnaissent pas dans le régime actuel de Dublin).
par-delà les religions (le vert symbolise le catholicisme, l’orange le protestantisme et le blanc, la concorde entre les deux), le catholicisme reste une composante essentielle de la conscience nationale, même si la société s’est – là aussi – beaucoup sécularisée depuis les années 1960-70, et même si cela est parfois exagéré d’un point de vue ‘continental’ : les choses sont présentées comme un affrontement entre ‘catholiques’ et ‘protestants’, alors que les acteurs du conflit eux-mêmes, d’un côté comme de l’autre, ne présentent généralement pas les choses ainsi : on parle le plus souvent de quartiers ‘nationalistes’ et ‘loyalistes’ (et non ‘catholiques’ et ‘protestants’), et l’on ne jure pas fidélité à une Église ou à une autre, mais à la Reine ou à la République proclamée en 1916 (que les républicains authentiques ne reconnaissent pas dans le régime actuel de Dublin).Et tout le processus de formation du Royaume-Uni, à partir de la fin du 13e siècle (Édouard Ier) jusqu’aux Actes d’Union de 1707 et 1800, en passant par les guerres des Trois Royaumes, s’est déroulé sur la base de QUATRE NATIONS FERMEMENT CONSTITUÉES dès son commencement (plus la Nation cornique, l’île de Man et les îles ‘anglo-normandes’, mais elles n’ont pas joué un rôle majeur). Songeons que, dans le processus de formation de l’État moderne ‘France’, aucune nation n’avait au départ d’unité politique (la Bretagne étant déchirée par les guerres civiles), et que l’annexion à la Couronne des deux grandes nations, ‘française proprement dite’ et occitane [2], s’est faite progressivement et parallèlement : le ‘Languedoc’ (Occitanie centrale, anciens ‘États’ toulousains et aragonais) était déjà réuni au domaine royal depuis longtemps lorsque la Bourgogne (et ses possessions jusqu’à la Mer du Nord) défiaient encore l’autorité de Louis XI… La Provence était ‘sous contrôle’ près de deux siècles avant l’actuel Nord-Pas-de-Calais ; et l’on annexait encore dans la seconde moitié du 18e siècle : Charolais en 1761, Lorraine en 1766, Corse en 1768-69, Vaucluse en 1791, pays (comtois) de Montbéliard en 1793, sans oublier la Savoie et Nice en 1860 ! La construction politico-militaire du
 Royaume-Uni a donc pris, dans les nations celtiques, un aspect nettement colonial, avec une conscience ‘nette’ (de part et d’autre) d’une nation en soumettant une autre, les plantations (grandes propriétés terriennes, à la condition paysanne épouvantable) aux mains de landlords anglais implantés ou d’aristocrates locaux ‘vendus’, etc. etc. Il en résulte ce que l’on peut qualifier de contradiction Centre (Angleterre, surtout le Sud)/Périphéries ‘parfaite’, dans un rapport quasiment métropole-colonies ; par opposition au ‘paradoxe espagnol’ où c’est le ‘pourtour’ qui est plus avancé et développé que l’intérieur, lequel ‘tient’ pourtant l’appareil politico-militaire ; ou à la construction ‘France’ qui repose plutôt sur une colonne vertébrale en ‘Y’ Rhône-Seine-Rhin, bordée de régions ‘favorisées’ (non sans ‘îlots’ ghettoïsés comme Marseille, les banlieues de Lyon, Paris ou Strasbourg, Belfort-Montbéliard, le Creusot etc.), et des territoires marginalisés sur la frontière nord (de la Moselle à la baie de Somme), le Jura et l’arc alpin, et en Occitanie (le ‘Grand Ouest’ avec la Bretagne, la Normandie, l’Anjou, le Poitou-Charentes étant dans une situation plus ‘moyenne’).
Royaume-Uni a donc pris, dans les nations celtiques, un aspect nettement colonial, avec une conscience ‘nette’ (de part et d’autre) d’une nation en soumettant une autre, les plantations (grandes propriétés terriennes, à la condition paysanne épouvantable) aux mains de landlords anglais implantés ou d’aristocrates locaux ‘vendus’, etc. etc. Il en résulte ce que l’on peut qualifier de contradiction Centre (Angleterre, surtout le Sud)/Périphéries ‘parfaite’, dans un rapport quasiment métropole-colonies ; par opposition au ‘paradoxe espagnol’ où c’est le ‘pourtour’ qui est plus avancé et développé que l’intérieur, lequel ‘tient’ pourtant l’appareil politico-militaire ; ou à la construction ‘France’ qui repose plutôt sur une colonne vertébrale en ‘Y’ Rhône-Seine-Rhin, bordée de régions ‘favorisées’ (non sans ‘îlots’ ghettoïsés comme Marseille, les banlieues de Lyon, Paris ou Strasbourg, Belfort-Montbéliard, le Creusot etc.), et des territoires marginalisés sur la frontière nord (de la Moselle à la baie de Somme), le Jura et l’arc alpin, et en Occitanie (le ‘Grand Ouest’ avec la Bretagne, la Normandie, l’Anjou, le Poitou-Charentes étant dans une situation plus ‘moyenne’).Mais, en même temps – ou du même coup, l'on remarque une absence de volonté assimilationniste comme on a pu la voir émerger en ‘France’ dès Louis XIV voire François Ier, et se déchaîner à partir de 1789 ; volonté de non seulement supprimer toute institution politique nationale ou régionale (ce que feront définitivement les révolutionnaires de 1789), mais aussi de nier socio-culturellement les nations constitutives (et les ‘subtilités’ de l’ensemble d’oïl), de les effacer historiquement pour ne laisser place qu’à des ‘français’ – nous y reviendrons.
Enfin, la défense des ‘libertés anglaises’ qui a marqué tout le processus, déjà contre les Plantagenêt ‘français’ au 13e siècle, puis contre les Stuart ‘français dans l’âme’ au 17e, a fondé la psychologie sociale capitaliste britannique sur le libéralisme politique, théorisé notamment par John Locke : un libéralisme qui peut se faire réformiste social (travaillisme jusqu’en 1979) ou au contraire ultraconservateur (thatchérisme), mais dans tous les cas, fort éloigné du Léviathan hobbesien qui imprègne la conception dominante ‘française’ de l’État et du gouvernement.
À l’extérieur, les successeurs de Guillaume d’Orange poursuivent sa politique de lutte acharnée contre la puissance française (et l’’axe’ franco-espagnol qui s’est constitué en 1701, avec l’accession du petit-fils de Louis XIV au trône d’Espagne) : Guerre de Succession d’Espagne (1701-14), Guerre de Sept Ans (1756-63), puis guerres de la Révolution et de l’Empire (qui sont des guerres mondiales par
 leurs théâtres d’opération) jusqu’à Waterloo (1815) ; on parle parfois de ‘3e Guerre de Cent Ans’ (1689-1815). Contre l’Espagne, l'Angleterre appuiera également (1810-30) les guerres d’indépendance des colonies latino-américaines, qui feront de celles-ci des semi-colonies (protectorats de fait) de Londres. L’Angleterre profite alors de sa domination navale sans partage pour étendre sa domination coloniale d’un bout à l’autre du globe, de l’Inde au Canada, des Caraïbes à l’Australie. On peut peut-être utiliser la Guerre d’Indépendance/Révolution américaine (1775-83, son unique revers) pour distinguer un premier empire colonial (Empire ‘moderne’) d’un second (Empire ‘contemporain’) ; mais la ‘rupture’ entre les deux n’est en aucun cas comparable à celle que représentent, pour l’Empire français, les défaites de Louis XV (1763) puis de Napoléon (1815).
leurs théâtres d’opération) jusqu’à Waterloo (1815) ; on parle parfois de ‘3e Guerre de Cent Ans’ (1689-1815). Contre l’Espagne, l'Angleterre appuiera également (1810-30) les guerres d’indépendance des colonies latino-américaines, qui feront de celles-ci des semi-colonies (protectorats de fait) de Londres. L’Angleterre profite alors de sa domination navale sans partage pour étendre sa domination coloniale d’un bout à l’autre du globe, de l’Inde au Canada, des Caraïbes à l’Australie. On peut peut-être utiliser la Guerre d’Indépendance/Révolution américaine (1775-83, son unique revers) pour distinguer un premier empire colonial (Empire ‘moderne’) d’un second (Empire ‘contemporain’) ; mais la ‘rupture’ entre les deux n’est en aucun cas comparable à celle que représentent, pour l’Empire français, les défaites de Louis XV (1763) puis de Napoléon (1815).Le Royaume-Uni d’après Waterloo est donc, sans conteste, la première puissance mondiale, devenant sans doute, dès le milieu du siècle, la première puissance impérialiste (selon la définition de Lénine), ce qui ne sera remis en cause (par l’impérialisme US) qu’à partir de 1918, et définitivement après la Seconde Guerre mondiale.
Comme dans toute grande puissance impérialiste, cela donnera naissance à des colonies intérieures métropolitaines, issues de cet immense Empire.
(SUITE)

[1] Ces yeomen seront, aux 14e-15e siècles, la principale force militaire du royaume, fournissant les régiments d’archers qui décimeront la chevalerie capétienne sur les champs de bataille de Crécy (1346), Poitiers (1356) et encore Azincourt (1415), avant d’être surclassés par l’artillerie – que les Capétiens importent d’Italie, et qui sera la technologie militaire emblématique de l’époque moderne. Ils seront, en revanche, laminés par les enclosures entre le 16e et le 18e siècle.
[2] La binationalité du royaume capétien est un fait communément admis, globalement, d’environ 1300 à environ 1600, avec souvent des États généraux ‘en deux temps’, une session à Paris et une autre à Toulouse.
 votre commentaire
votre commentaire
-
3. La contradiction Nations/État et la lutte des classes
 On notera ici que le processus (de 1530 jusqu'au milieu du 19e siècle) ‘parachevant’ le Royaume-Uni comme État moderne, puis assurant sa ‘transition’ révolutionnaire bourgeoise vers l’État contemporain, s’est donc déroulé sous le drapeau du ‘protestantisme’ (terme générique dans lequel les observateurs continentaux jettent, pêle-mêle, anglicanisme, calvinisme, puritanisme, presbytérianisme etc.) ; et que, parallèlement, c’est sous ce même drapeau que s’est instauré le règne de la bourgeoisie et de l'‘aristocratie capitaliste’ anglaise (avec sa fraction dominante londonienne) sur les masses populaires d’Angleterre, certes, mais aussi et surtout sur les nations celtiques (toutes classes confondues, avec bien sûr des éléments aristocratiques, cléricaux et bourgeois ‘collabos’), sans même parler des peuples colonisés d’outre-mer. C’est intéressant à relever, car il y a peut-être, dans le mouvement communiste ‘continental’, une tendance à la ‘déviation webérienne’ : une tendance à la simplification et à la systématisation de la dichotomie ‘protestantisme capitaliste donc progressiste’/’catholicisme féodal donc réactionnaire’ dans le processus mondial des révolutions bourgeoises (16e-19e siècles). Certes, le ‘protestantisme’ a été pendant plus de deux siècles une puissante force de progrès, favorisant le développement capitaliste des forces productives et les ‘idées nouvelles’ révolutionnaires bourgeoises ; et il a directement présidé à des révolutions bourgeoises, à des transitions vers l’État bourgeois contemporain et la révolution industrielle, comme en Angleterre, aux Pays-Bas, aux États-Unis ou dans certains cantons suisses. Mais dans le même temps, là où il a précisément dirigé ces processus, il s’est fait idéologie d’oppression, des masses populaires comme des nations niées par ces États modernes en transition vers l’État capitaliste contemporain ; au même titre que le catholicisme là où celui-ci était la religion d’État. Rappelons par exemple que la Prusse (protestante luthérienne), ‘despotisme éclairé’ au 18e siècle, ne fut pas, entre 1789 et 1850, précisément une force de progrès, mais au contraire une ‘forteresse’ de la réaction absolutiste, avec l’Autriche (catholique) et la Russie (orthodoxe) ; et qu’elle a ensuite ‘fait l’Allemagne’ (1850-71, il faut dire qu’elle avait annexé en 1815 les ‘moteurs’ économiques de celle-ci, Rhénanie et Westphalie) sur cette même base ultraconservatrice, non seulement anti-ouvrière et antipopulaire, mais aussi hostile à la bourgeoisie libérale et démocrate qui était alors plutôt... la bourgeoisie rhénane catholique ! C’est d’ailleurs pour le compte de cet Empire allemand prussien (en 1905) qu’écrivait le sociologue de régime Max Weber (probablement, pour être précis, dans une optique de ‘partage du monde’ entre ‘Germains’ et Anglo-Saxons, ligne qui sera, par la suite, celle d’un nazi comme Rudolf Hess par exemple).
On notera ici que le processus (de 1530 jusqu'au milieu du 19e siècle) ‘parachevant’ le Royaume-Uni comme État moderne, puis assurant sa ‘transition’ révolutionnaire bourgeoise vers l’État contemporain, s’est donc déroulé sous le drapeau du ‘protestantisme’ (terme générique dans lequel les observateurs continentaux jettent, pêle-mêle, anglicanisme, calvinisme, puritanisme, presbytérianisme etc.) ; et que, parallèlement, c’est sous ce même drapeau que s’est instauré le règne de la bourgeoisie et de l'‘aristocratie capitaliste’ anglaise (avec sa fraction dominante londonienne) sur les masses populaires d’Angleterre, certes, mais aussi et surtout sur les nations celtiques (toutes classes confondues, avec bien sûr des éléments aristocratiques, cléricaux et bourgeois ‘collabos’), sans même parler des peuples colonisés d’outre-mer. C’est intéressant à relever, car il y a peut-être, dans le mouvement communiste ‘continental’, une tendance à la ‘déviation webérienne’ : une tendance à la simplification et à la systématisation de la dichotomie ‘protestantisme capitaliste donc progressiste’/’catholicisme féodal donc réactionnaire’ dans le processus mondial des révolutions bourgeoises (16e-19e siècles). Certes, le ‘protestantisme’ a été pendant plus de deux siècles une puissante force de progrès, favorisant le développement capitaliste des forces productives et les ‘idées nouvelles’ révolutionnaires bourgeoises ; et il a directement présidé à des révolutions bourgeoises, à des transitions vers l’État bourgeois contemporain et la révolution industrielle, comme en Angleterre, aux Pays-Bas, aux États-Unis ou dans certains cantons suisses. Mais dans le même temps, là où il a précisément dirigé ces processus, il s’est fait idéologie d’oppression, des masses populaires comme des nations niées par ces États modernes en transition vers l’État capitaliste contemporain ; au même titre que le catholicisme là où celui-ci était la religion d’État. Rappelons par exemple que la Prusse (protestante luthérienne), ‘despotisme éclairé’ au 18e siècle, ne fut pas, entre 1789 et 1850, précisément une force de progrès, mais au contraire une ‘forteresse’ de la réaction absolutiste, avec l’Autriche (catholique) et la Russie (orthodoxe) ; et qu’elle a ensuite ‘fait l’Allemagne’ (1850-71, il faut dire qu’elle avait annexé en 1815 les ‘moteurs’ économiques de celle-ci, Rhénanie et Westphalie) sur cette même base ultraconservatrice, non seulement anti-ouvrière et antipopulaire, mais aussi hostile à la bourgeoisie libérale et démocrate qui était alors plutôt... la bourgeoisie rhénane catholique ! C’est d’ailleurs pour le compte de cet Empire allemand prussien (en 1905) qu’écrivait le sociologue de régime Max Weber (probablement, pour être précis, dans une optique de ‘partage du monde’ entre ‘Germains’ et Anglo-Saxons, ligne qui sera, par la suite, celle d’un nazi comme Rudolf Hess par exemple). En réalité, la Réforme protestante est née au 16e siècle comme idéologie, d’une part, de dénonciation de la corruption de la hiérarchie catholique (trafic des indulgences etc.), mais aussi et surtout, d’autre part, comme idéologie anti-absolutiste favorable à des républiques bourgeoises comme à Genève, aux Pays-Bas ou en Angleterre avec Cromwell. Mais, du moment qu’elle devenait idéologie d’État (en Angleterre, aux Pays-Bas, en Prusse, en Scandinavie, aux USA, ou dans les Républiques boers d’Afrique du Sud), elle devenait automatiquement une idéologie d’oppression pour les masses humaines sous l’autorité dudit État… De son côté, le catholicisme ultramontain (‘papiste’), la Contre-réforme, a été effectivement un mouvement réactionnaire, obscurantiste, combattant le progrès scientifique (Copernic, Bruno, Galilée) et intellectuel, qui privait l’Église de la base même de son existence : une société encore dominée par les forces de la nature. Mais, ‘derniers soldats’ d’un Pape qui n’était plus que l’ombre de son autorité universelle de l’An 1000, des courants comme les Jésuites, obscurantistes vis-à-vis des sciences et de la philosophie, étaient également anti-absolutistes (l’absolutisme rejetait l’autorité pontificale) et ont pu, dans cette logique, au même titre que les protestants radicaux, mettre en avant des idées démocratiques avancées comme le tyrannicide (lorsqu'un souverain ‘viole’ son ‘contrat’ avec le peuple, ou va à l’encontre de ‘Dieu’, c'est-à-dire des droits humains considérés comme ‘naturels’, il peut et même doit être éliminé – Juan de Mariana) ou mener des expériences très radicales pour l’époque, comme les ‘réductions’ guaranies du Paraguay, sur le principe que si chacun et chacune doit se soumettre devant ‘Dieu’, aucun être humain n’est ‘naturellement’ supérieur à un autre (pas même par la ‘grâce’ ou la ‘prédestination’ divine protestante, qu’ils rejettent) [l'ensemble de cette opposition protestante et ultra-catholique à la mise en place de l'absolutisme était qualifiée de mouvement monarchomaque ; concernant les Jésuites, l'origine basque des deux principaux fondateurs de l'ordre, Ignace de Loyola et François Xavier, contemporains (au demeurant) de l'exécution militaire du Royaume de Navarre par le jeune État moderne espagnol, n'est sans doute pas dissociable de ce catholicisme "populaire", "foi du charbonnier" et "républicain" anti-absolutiste ainsi que d'un certain esprit de syncrétisme avec les croyances ancestrales pré-chrétiennes que l'on retrouvera notamment dans les missions du Paraguay, puisque tout cela était caractéristique de la très catholique mais aussi très égalitaire et "républicaine paysanne" (dénuée de conception monarchique forte) société basque de l'époque].
En réalité, la Réforme protestante est née au 16e siècle comme idéologie, d’une part, de dénonciation de la corruption de la hiérarchie catholique (trafic des indulgences etc.), mais aussi et surtout, d’autre part, comme idéologie anti-absolutiste favorable à des républiques bourgeoises comme à Genève, aux Pays-Bas ou en Angleterre avec Cromwell. Mais, du moment qu’elle devenait idéologie d’État (en Angleterre, aux Pays-Bas, en Prusse, en Scandinavie, aux USA, ou dans les Républiques boers d’Afrique du Sud), elle devenait automatiquement une idéologie d’oppression pour les masses humaines sous l’autorité dudit État… De son côté, le catholicisme ultramontain (‘papiste’), la Contre-réforme, a été effectivement un mouvement réactionnaire, obscurantiste, combattant le progrès scientifique (Copernic, Bruno, Galilée) et intellectuel, qui privait l’Église de la base même de son existence : une société encore dominée par les forces de la nature. Mais, ‘derniers soldats’ d’un Pape qui n’était plus que l’ombre de son autorité universelle de l’An 1000, des courants comme les Jésuites, obscurantistes vis-à-vis des sciences et de la philosophie, étaient également anti-absolutistes (l’absolutisme rejetait l’autorité pontificale) et ont pu, dans cette logique, au même titre que les protestants radicaux, mettre en avant des idées démocratiques avancées comme le tyrannicide (lorsqu'un souverain ‘viole’ son ‘contrat’ avec le peuple, ou va à l’encontre de ‘Dieu’, c'est-à-dire des droits humains considérés comme ‘naturels’, il peut et même doit être éliminé – Juan de Mariana) ou mener des expériences très radicales pour l’époque, comme les ‘réductions’ guaranies du Paraguay, sur le principe que si chacun et chacune doit se soumettre devant ‘Dieu’, aucun être humain n’est ‘naturellement’ supérieur à un autre (pas même par la ‘grâce’ ou la ‘prédestination’ divine protestante, qu’ils rejettent) [l'ensemble de cette opposition protestante et ultra-catholique à la mise en place de l'absolutisme était qualifiée de mouvement monarchomaque ; concernant les Jésuites, l'origine basque des deux principaux fondateurs de l'ordre, Ignace de Loyola et François Xavier, contemporains (au demeurant) de l'exécution militaire du Royaume de Navarre par le jeune État moderne espagnol, n'est sans doute pas dissociable de ce catholicisme "populaire", "foi du charbonnier" et "républicain" anti-absolutiste ainsi que d'un certain esprit de syncrétisme avec les croyances ancestrales pré-chrétiennes que l'on retrouvera notamment dans les missions du Paraguay, puisque tout cela était caractéristique de la très catholique mais aussi très égalitaire et "républicaine paysanne" (dénuée de conception monarchique forte) société basque de l'époque].C’est ainsi qu’à partir du milieu du 17e siècle, les Jésuites seront vigoureusement combattus par les États absolutistes et les ‘despotismes éclairés’, y compris de religion d’État catholique comme l’Espagne, l’Autriche ou le Portugal ; bien plus tard, au 20e siècle, ils fourniront – notamment en Amérique latine – le gros des troupes du christianisme social-révolutionnaire et de la théologie de la libération. Dans la même veine, lorsque le roi de ‘France’ Henri III voulut asseoir son pouvoir absolu (et celui de son ‘clan’ aristocratique et grand-bourgeois) sur l’’équilibrisme’ entre catholiques et ‘huguenots’, il fut rejeté comme ‘tyran’ par les uns comme par les autres, et devinrent des ‘républiques bourgeoises’ aussi bien les cités protestantes du ‘Midi’ (‘Provinces de l’Union’), que le Paris de la Ligue, qui préfigurait à bien des égards celui des ‘sections sans-culotte’. Seule la dialectique marxiste permet de comprendre de telles choses, en comprenant qu’à partir du moment (13e, 14e siècle) où l’on sort de la féodalité au sens strict, la religion quelle qu’elle soit perd sa base matérielle et donc son assise idéologique ; à partir de là, le clergé ne peut plus être une classe sociale autonome, il éclate et chacun de ses fragments servira la cause de la classe qui parviendra à le capter…
 Donc, la mutation du Royaume-Uni en État contemporain (bourgeois, capitaliste) est un processus globalement achevé avec le règne de Victoria (1837-1901). La révolution industrielle triomphe et la population a plus que triplé (de 7 à 23 millions) entre 1750 et 1830 ; d’immenses cités industrielles (comme Manchester) surgissent de la verte campagne. Le Reform Act de 1832 intègre cette réalité en supprimant les ‘bourgs pourris’ (circonscriptions dépeuplées alors que des ‘villes nouvelles’ immenses, surgies en quelques décennies, n’ont pas de représentants) ; en revanche, il n’élargit le suffrage (censitaire) que de 300.000 à 600.000 électeurs[1] : cette ‘trahison whig’ donnera naissance au mouvement chartiste, qui réclame le suffrage universel masculin (il ne sera totalement accordé qu’en… 1918, en même temps qu’aux femmes de plus de
Donc, la mutation du Royaume-Uni en État contemporain (bourgeois, capitaliste) est un processus globalement achevé avec le règne de Victoria (1837-1901). La révolution industrielle triomphe et la population a plus que triplé (de 7 à 23 millions) entre 1750 et 1830 ; d’immenses cités industrielles (comme Manchester) surgissent de la verte campagne. Le Reform Act de 1832 intègre cette réalité en supprimant les ‘bourgs pourris’ (circonscriptions dépeuplées alors que des ‘villes nouvelles’ immenses, surgies en quelques décennies, n’ont pas de représentants) ; en revanche, il n’élargit le suffrage (censitaire) que de 300.000 à 600.000 électeurs[1] : cette ‘trahison whig’ donnera naissance au mouvement chartiste, qui réclame le suffrage universel masculin (il ne sera totalement accordé qu’en… 1918, en même temps qu’aux femmes de plus de  30 ans – et à toutes en 1928, 16 ans avant les ‘françaises’ pour le coup). Les Premiers ministres issus de la Chambre des Lords se ‘clairsèment’ sous le règne : quatre seulement (cinq avec Disraeli, anobli à la fin de sa vie), le dernier étant Robert Gascoyne-Cecil, 3e marquis de Salisbury (1895-1902) ; tous ensuite viendront des Communes (même si c’est une ‘tradition’ : rien n’y oblige légalement). Le Royaume et l’Empire sont alors au sommet de leur splendeur, l’époque victorienne deviendra un ‘symbole’ de la Grande-Bretagne à travers le monde entier. On notera toutefois que, vers l’État contemporain au sens où nous l’entendons, la transition est longue et progressive, depuis le milieu du 17e siècle jusqu’au début du 20e : c’est le fameux ‘évolutionnisme britannique’, célébré par les courants politiques ‘libéraux’ qui l’opposent à la ‘culture française des révolutions’… Mais la condition ouvrière et populaire, elle, est
30 ans – et à toutes en 1928, 16 ans avant les ‘françaises’ pour le coup). Les Premiers ministres issus de la Chambre des Lords se ‘clairsèment’ sous le règne : quatre seulement (cinq avec Disraeli, anobli à la fin de sa vie), le dernier étant Robert Gascoyne-Cecil, 3e marquis de Salisbury (1895-1902) ; tous ensuite viendront des Communes (même si c’est une ‘tradition’ : rien n’y oblige légalement). Le Royaume et l’Empire sont alors au sommet de leur splendeur, l’époque victorienne deviendra un ‘symbole’ de la Grande-Bretagne à travers le monde entier. On notera toutefois que, vers l’État contemporain au sens où nous l’entendons, la transition est longue et progressive, depuis le milieu du 17e siècle jusqu’au début du 20e : c’est le fameux ‘évolutionnisme britannique’, célébré par les courants politiques ‘libéraux’ qui l’opposent à la ‘culture française des révolutions’… Mais la condition ouvrière et populaire, elle, est  effroyable ; comme la lecture de l’écrivain Charles Dickens suffit à s’en donner une idée : des millions de prolétaires de toutes les nations constitutives (privés, comme on l’a vu, des tous droits civiques jusqu’en 1918) s’entassent dans les slums (taudis misérables) des cités industrielles du Nord ou de Londres (East End), baignés dans la boue et dans le smog (littéralement : ‘brouillard de fumée’) des cheminées d’usine.
effroyable ; comme la lecture de l’écrivain Charles Dickens suffit à s’en donner une idée : des millions de prolétaires de toutes les nations constitutives (privés, comme on l’a vu, des tous droits civiques jusqu’en 1918) s’entassent dans les slums (taudis misérables) des cités industrielles du Nord ou de Londres (East End), baignés dans la boue et dans le smog (littéralement : ‘brouillard de fumée’) des cheminées d’usine.Parallèlement, on l’a dit, en même temps que l’Angleterre achevait de soumettre à son État l’ensemble des nations (celtiques) de l’archipel britannique, elle développait également un immense empire colonial ultra-marin qui, malgré la perte (1783) des Treize Colonies américaines qui formeront les États-Unis d’Amérique, sera la base, lorsque l’exportation de capitaux deviendra principale, de la première puissance impérialiste mondiale (première chronologiquement, et par l’étendue de son influence). Dans cet Empire, l’Angleterre adoptera une attitude assez différente de celle de la ‘France’ dans le sien. Non pas qu’il y ait eu moins
 d’oppression et de massacres – encore que cela soit fort possible, en tout cas, il n’y a pas eu de grande guerre d’extermination contre un mouvement d’indépendance, comme en Indochine et en Algérie. Mais l’Angleterre a toujours cherché à appliquer ce que l’on appelle l’indigenous rule. L’impérialisme bleu-blanc-rouge, dans l’optique de ses théoriciens (Victor Hugo, Jules Ferry), se voyait dans un rôle d’’éducateur’ mondial : ‘nous sommes les Grecs du monde’, disait Hugo au génocidaire Bugeaud. La ‘France’ était vue comme investie d’une ‘mission historique’, d’une ‘destinée manifeste’ : apporter la ‘civilisation’ française aux peuples ‘mineurs’, ‘sauvages’ ou ‘barbares’, dans une forme de ‘tutorat international’. Une fois que les peuples colonisés seraient ‘majeurs’, ‘civilisés’, le régime colonial ne s’appliquerait plus (il n’était pas, alors, précisé s’ils deviendraient des États ‘indépendants’ sous influence étroite, ou des départements ‘français’ comme le sont devenues les Antilles). Bien sûr, la base économique était la même que pour tout impérialisme : la domination des monopoles. Mais telle était l’idéologie dont les monopoles se sont emparés pour servir leurs intérêts – n’était-ce pas là, finalement, qu’une transposition outre-mer de la vision que la bourgeoisie révolutionnaire parisienne (et déjà les ‘éclairés’ de la fin de l’Ancien Régime) avaient des ‘provinces reculées’ ?
d’oppression et de massacres – encore que cela soit fort possible, en tout cas, il n’y a pas eu de grande guerre d’extermination contre un mouvement d’indépendance, comme en Indochine et en Algérie. Mais l’Angleterre a toujours cherché à appliquer ce que l’on appelle l’indigenous rule. L’impérialisme bleu-blanc-rouge, dans l’optique de ses théoriciens (Victor Hugo, Jules Ferry), se voyait dans un rôle d’’éducateur’ mondial : ‘nous sommes les Grecs du monde’, disait Hugo au génocidaire Bugeaud. La ‘France’ était vue comme investie d’une ‘mission historique’, d’une ‘destinée manifeste’ : apporter la ‘civilisation’ française aux peuples ‘mineurs’, ‘sauvages’ ou ‘barbares’, dans une forme de ‘tutorat international’. Une fois que les peuples colonisés seraient ‘majeurs’, ‘civilisés’, le régime colonial ne s’appliquerait plus (il n’était pas, alors, précisé s’ils deviendraient des États ‘indépendants’ sous influence étroite, ou des départements ‘français’ comme le sont devenues les Antilles). Bien sûr, la base économique était la même que pour tout impérialisme : la domination des monopoles. Mais telle était l’idéologie dont les monopoles se sont emparés pour servir leurs intérêts – n’était-ce pas là, finalement, qu’une transposition outre-mer de la vision que la bourgeoisie révolutionnaire parisienne (et déjà les ‘éclairés’ de la fin de l’Ancien Régime) avaient des ‘provinces reculées’ ? Pour l’impérialisme ‘britannique’, en revanche, l’’aventure coloniale’ repose sur un seul mot d’ordre : business as usual. Tant que les peuples colonisés font et fournissent ce que le capitalisme et les monopoles britanniques attendent d’eux, ils conservent leur ‘civilisation’, leurs langues, leurs traditions, et même leurs ‘élites’ et leurs institutions. Là où l’Empire ‘britannique’ veut créer une ‘Nouvelle Grande-Bretagne’ (comme au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande), il la peuple d’Européens (de préférence du Nord…). À partir du 19e siècle, ne souhaitant pas refaire les erreurs des Treize Colonies d’Amérique du Nord (et une nouvelle violente révolte – Mackenzie et Papineau – ayant secoué le Canada en 1837-38), le Royaume-Uni offrira à ces territoires (dominions) un statut d’autonomie à élargissement progressif, qui débouchera après la 2e Guerre mondiale sur une indépendance totale
Pour l’impérialisme ‘britannique’, en revanche, l’’aventure coloniale’ repose sur un seul mot d’ordre : business as usual. Tant que les peuples colonisés font et fournissent ce que le capitalisme et les monopoles britanniques attendent d’eux, ils conservent leur ‘civilisation’, leurs langues, leurs traditions, et même leurs ‘élites’ et leurs institutions. Là où l’Empire ‘britannique’ veut créer une ‘Nouvelle Grande-Bretagne’ (comme au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande), il la peuple d’Européens (de préférence du Nord…). À partir du 19e siècle, ne souhaitant pas refaire les erreurs des Treize Colonies d’Amérique du Nord (et une nouvelle violente révolte – Mackenzie et Papineau – ayant secoué le Canada en 1837-38), le Royaume-Uni offrira à ces territoires (dominions) un statut d’autonomie à élargissement progressif, qui débouchera après la 2e Guerre mondiale sur une indépendance totale  (militaire, diplomatique etc.) tout en restant bien sûr des alliés étroits de la métropole (et de l’impérialisme US) ; donnant naissance à des impérialismes de petit ou moyen rang : Canada, Australie, Nouvelle-Zélande ; sans compter l’’émergent’ sud-africain. Ils ne sont plus rattachés à Londres que par le chef de l’État, qui reste officiellement la reine d’Angleterre, représentée par un ‘gouverneur’ (‘proposé’ par le Parlement national ; la reine ne fait qu’entériner, elle ne le choisit pas).
(militaire, diplomatique etc.) tout en restant bien sûr des alliés étroits de la métropole (et de l’impérialisme US) ; donnant naissance à des impérialismes de petit ou moyen rang : Canada, Australie, Nouvelle-Zélande ; sans compter l’’émergent’ sud-africain. Ils ne sont plus rattachés à Londres que par le chef de l’État, qui reste officiellement la reine d’Angleterre, représentée par un ‘gouverneur’ (‘proposé’ par le Parlement national ; la reine ne fait qu’entériner, elle ne le choisit pas).Ailleurs, telle n’est pas la vocation de la domination coloniale : il est ouvertement assumé que l’Angleterre est là pour se fournir en matières premières, écouler sa production nationale, et éventuellement utiliser la force de travail lorsque celle-ci est jugée assez productive. Ce qui ne va pas sans un lourd sous-entendu raciste : les ‘races’ sont et restent ce qu’elles sont ; un Africain, un ‘Peau-Rouge’, un Bengali ou un Maori, pas plus d’ailleurs qu’un Irlandais ou un Écossais (qui leurs sont tout de même ‘supérieurs’) ne sera jamais un Anglais, pas même un ‘demi’. Il est illusoire de prétendre, comme le font les ‘Français’, ‘européaniser’ des peuples non-européens, comme les Romains prétendaient ‘romaniser’ tous les peuples de leur Empire mais celui-ci, au faîte de sa puissance, s’est finalement brutalement effondré – les ‘Français’, en cela, sont bien leurs dignes héritiers et ils connaîtront le même sort. Ainsi raisonnait l’impérialiste anglais ‘moyen’ de l’époque victorienne, et encore dans la première moitié du 20e siècle…
Pareillement, dans les nations celtiques de l’archipel, la domination de type colonial ne s’est jamais accompagnée d’une réelle volonté d’assimilation, de négation nationale au plan socio-culturel, quand bien même les institutions politiques nationales ont été supprimées par les différents Actes d’Union (Galles 1536, Écosse 1707 et Irlande 1800, la Cornouaille n’ayant jamais eu pour sa part d’institutions parlementaires modernes et Man et les îles ‘anglo-normandes’ n’ayant pas été intégrées au Royaume-Uni). Il a certes été tenté, à partir de Georges III (après l’indépendance américaine, face à la Révolution française et à Napoléon puis dans l’expansion coloniale et face à l’Allemagne pendant les deux guerres mondiales) de développer un certain ‘patriotisme britannique’ avec le fameux chant Rule Britannia, le terme de ‘Briton’ (descendant des (Grands-)Bretons), la mise en avant de la reine celte Boadicée résistant aux légions romaines (1er siècle après J-C.) alors que Napoléon (ce ‘nouveau Néron’) planifiait l’invasion du pays ; mais globalement les nations
 constitutives sont toujours restées reconnues comme telles. Même dans l’armée, colonne vertébrale de l’État selon les marxistes, les régiments restent nationaux (comme les célèbres régiments écossais défilant en kilt avec leurs cornemuses). Au football et au rugby, sports britanniques par excellence, les quatre grandes nations ont chacune leur sélection dans les compétitions internationales, situation unique au monde alors qu’il est impossible de faire reconnaître une équipe basque par la FIFA ; au rugby, l’Irlande est même… réunifiée (au football par contre il y a une équipe d’Irlande du Nord, car c’est là-bas surtout un sport de ‘protestants’ – les Irlandais ‘catholiques’ nationalistes jouant au football gaélique – qui ne ‘peuvent’ donc jouer avec les rares ‘catholiques’ le pratiquant au Sud). Cela tient au fait que, comme on l'a dit, la classe dominante d'Angleterre a historiquement toujours plus assumé une véritable conquête coloniale des autres nations (mais maintenant tout cela "serait du passé" et "on est potes" comme après une bagarre dans un pub...), donc le fait qu'il s'agisse bien de NATIONS différentes de la Nation anglaise ; mais aussi que (comme dans toutes les constructions d’États modernes) elle a pu faire valoir une part de "volonté" (dominante, grande-bourgeoise et aristocratique) autochtone dans ces rattachements : c'est bien un roi d'origine galloise (Henri VIII Tudor) qui a formellement uni le Pays de Galles à l'Angleterre ; c'est bien une dynastie écossaise (les Stuart) qui a uni les deux couronnes puis des parlementaires bourgeois et aristocrates écossais qui ont voté l'Acte d'Union en 1707 ; ce sont (dans une large mesure) des possédants irlandais (protestants ou non) qui en ont fait de même en 1801 et c'est bien - depuis 1920 - en vertu d'une majorité unioniste que les 6 comtés d'Ulster demeurent 'britanniques'... Cette part de volonté autochtone a bien sûr été également essentielle en "France" ; mais elle a été formulée autrement et notamment, en 1789, par l'affirmation d'une fausse "Nation française" (résultat d'un "formatage" culturel des "élites" très fort, dès la Renaissance et encore plus après Richelieu) : c'est donc derrière ce mythe de la "Nation française" (affirmée par des couches sociales qui ne représentaient pas, à l'époque, 10% de la population...) que s'abrite le Grand Capital bleu-blanc-rouge. Au Royaume-Uni, en revanche, les démarches "rattachistes" des élites locales se sont faites en assumant les nationalités réelles et celles-ci sont donc historiquement reconnue ; ce qui n'empêche pas le pouvoir central londonien de tout mettre en œuvre contre la moindre velléité séparatiste (cf. le référendum écossais de 2014).
constitutives sont toujours restées reconnues comme telles. Même dans l’armée, colonne vertébrale de l’État selon les marxistes, les régiments restent nationaux (comme les célèbres régiments écossais défilant en kilt avec leurs cornemuses). Au football et au rugby, sports britanniques par excellence, les quatre grandes nations ont chacune leur sélection dans les compétitions internationales, situation unique au monde alors qu’il est impossible de faire reconnaître une équipe basque par la FIFA ; au rugby, l’Irlande est même… réunifiée (au football par contre il y a une équipe d’Irlande du Nord, car c’est là-bas surtout un sport de ‘protestants’ – les Irlandais ‘catholiques’ nationalistes jouant au football gaélique – qui ne ‘peuvent’ donc jouer avec les rares ‘catholiques’ le pratiquant au Sud). Cela tient au fait que, comme on l'a dit, la classe dominante d'Angleterre a historiquement toujours plus assumé une véritable conquête coloniale des autres nations (mais maintenant tout cela "serait du passé" et "on est potes" comme après une bagarre dans un pub...), donc le fait qu'il s'agisse bien de NATIONS différentes de la Nation anglaise ; mais aussi que (comme dans toutes les constructions d’États modernes) elle a pu faire valoir une part de "volonté" (dominante, grande-bourgeoise et aristocratique) autochtone dans ces rattachements : c'est bien un roi d'origine galloise (Henri VIII Tudor) qui a formellement uni le Pays de Galles à l'Angleterre ; c'est bien une dynastie écossaise (les Stuart) qui a uni les deux couronnes puis des parlementaires bourgeois et aristocrates écossais qui ont voté l'Acte d'Union en 1707 ; ce sont (dans une large mesure) des possédants irlandais (protestants ou non) qui en ont fait de même en 1801 et c'est bien - depuis 1920 - en vertu d'une majorité unioniste que les 6 comtés d'Ulster demeurent 'britanniques'... Cette part de volonté autochtone a bien sûr été également essentielle en "France" ; mais elle a été formulée autrement et notamment, en 1789, par l'affirmation d'une fausse "Nation française" (résultat d'un "formatage" culturel des "élites" très fort, dès la Renaissance et encore plus après Richelieu) : c'est donc derrière ce mythe de la "Nation française" (affirmée par des couches sociales qui ne représentaient pas, à l'époque, 10% de la population...) que s'abrite le Grand Capital bleu-blanc-rouge. Au Royaume-Uni, en revanche, les démarches "rattachistes" des élites locales se sont faites en assumant les nationalités réelles et celles-ci sont donc historiquement reconnue ; ce qui n'empêche pas le pouvoir central londonien de tout mettre en œuvre contre la moindre velléité séparatiste (cf. le référendum écossais de 2014). Bien sûr, il y a eu la suppression - pendant longtemps - de toute institution et gouvernement local. En Irlande, sous la pression du mouvement national qui renaît avec Wolfe Tone (1798), le Parlement londonien finit par céder et accorder le Home Rule… en 1914, mais son application est repoussée à la fin de la guerre mondiale, trop tard pour éviter la guerre de libération qui éclate en 1916 (l’institution se ‘réfugie’ alors dans le Nord, resté occupé) ; les Parlements écossais et gallois n'étant rétablis quant à eux que par les ‘dévolutions’ de la toute fin du 20e siècle, sous Tony Blair. Et depuis le 18e siècle (extinction du cornique, qui ne sera ‘ressuscité’ qu’au 20e) jusqu’à nos jours, les langues nationales ont considérablement reculé au profit de l’anglais – qui profite, aussi, de son statut de lingua franca internationale. Aujourd’hui, pour plus de 6 millions d’habitant-e-s au total (Sud et Nord), le gaélique irlandais est parlé par seulement 70.000 personnes dans la vie de tous les jours, 260.000 en ont une maîtrise ‘courante’ et 1,8 millions (200.000 au Nord) une certaine connaissance. Le gaélique écossais des Highlands et des îles (pour plus de 5 millions d’Écossais-es) n’a plus que 60.000 locuteurs courants, et une centaine de milliers de ‘personnes de plus de 3 ans’ qui le comprennent. Le gallois résiste – et a toujours résisté historiquement – un peu mieux, avec plus de 600.000 locuteurs courants en Cymru même (plus de 60% de la population dans les comtés du Nord-Ouest) et plus de 150.000 en Angleterre ; ainsi que le scots des Lowlands écossais (1,5 millions en Écosse et 30.000 en Irlande du Nord), mais c’est une langue anglo-saxonne, très proche de l’anglais et totalement intercompréhensible (ce que nos républicains BBR appelleraient un ‘patois’), ce qui explique cela – à noter, ici, que l’Écosse est une autre nation bilingue, comme la Bretagne, ce qui contredit encore une fois le ‘monolinguisme absolu’ posé par Staline dans La Question nationale. De leur côté, à Man et dans les îles ‘anglo-normandes’, il reste moins de 2% de locuteurs courants du mannois et des langues d’oïl normandes insulaires, même si jusqu’à 15% peuvent en avoir une certaine connaissance. Dans ces dernières, le normand insulaire a aussi souffert de la concurrence… du français ‘standard’, académique, toujours langue officielle des ‘baillages’ et bien maîtrisé par beaucoup de personnes (tourisme ‘continental’ oblige). Bien entendu, dans toutes ces nations, ce n’est jamais l’anglais d’Oxford qui est parlé par les masses populaires, pas plus qu’en Angleterre d’ailleurs : c’est un anglais populaire, mêlé de vocabulaire et d’expressions nationales, avec souvent un fort accent (comme les ‘r’ roulés écossais) qui rend, généralement, immédiatement identifiable la nation constitutive (et la classe sociale) de l’interlocuteur…
Bien sûr, il y a eu la suppression - pendant longtemps - de toute institution et gouvernement local. En Irlande, sous la pression du mouvement national qui renaît avec Wolfe Tone (1798), le Parlement londonien finit par céder et accorder le Home Rule… en 1914, mais son application est repoussée à la fin de la guerre mondiale, trop tard pour éviter la guerre de libération qui éclate en 1916 (l’institution se ‘réfugie’ alors dans le Nord, resté occupé) ; les Parlements écossais et gallois n'étant rétablis quant à eux que par les ‘dévolutions’ de la toute fin du 20e siècle, sous Tony Blair. Et depuis le 18e siècle (extinction du cornique, qui ne sera ‘ressuscité’ qu’au 20e) jusqu’à nos jours, les langues nationales ont considérablement reculé au profit de l’anglais – qui profite, aussi, de son statut de lingua franca internationale. Aujourd’hui, pour plus de 6 millions d’habitant-e-s au total (Sud et Nord), le gaélique irlandais est parlé par seulement 70.000 personnes dans la vie de tous les jours, 260.000 en ont une maîtrise ‘courante’ et 1,8 millions (200.000 au Nord) une certaine connaissance. Le gaélique écossais des Highlands et des îles (pour plus de 5 millions d’Écossais-es) n’a plus que 60.000 locuteurs courants, et une centaine de milliers de ‘personnes de plus de 3 ans’ qui le comprennent. Le gallois résiste – et a toujours résisté historiquement – un peu mieux, avec plus de 600.000 locuteurs courants en Cymru même (plus de 60% de la population dans les comtés du Nord-Ouest) et plus de 150.000 en Angleterre ; ainsi que le scots des Lowlands écossais (1,5 millions en Écosse et 30.000 en Irlande du Nord), mais c’est une langue anglo-saxonne, très proche de l’anglais et totalement intercompréhensible (ce que nos républicains BBR appelleraient un ‘patois’), ce qui explique cela – à noter, ici, que l’Écosse est une autre nation bilingue, comme la Bretagne, ce qui contredit encore une fois le ‘monolinguisme absolu’ posé par Staline dans La Question nationale. De leur côté, à Man et dans les îles ‘anglo-normandes’, il reste moins de 2% de locuteurs courants du mannois et des langues d’oïl normandes insulaires, même si jusqu’à 15% peuvent en avoir une certaine connaissance. Dans ces dernières, le normand insulaire a aussi souffert de la concurrence… du français ‘standard’, académique, toujours langue officielle des ‘baillages’ et bien maîtrisé par beaucoup de personnes (tourisme ‘continental’ oblige). Bien entendu, dans toutes ces nations, ce n’est jamais l’anglais d’Oxford qui est parlé par les masses populaires, pas plus qu’en Angleterre d’ailleurs : c’est un anglais populaire, mêlé de vocabulaire et d’expressions nationales, avec souvent un fort accent (comme les ‘r’ roulés écossais) qui rend, généralement, immédiatement identifiable la nation constitutive (et la classe sociale) de l’interlocuteur… Pour les besoins, et de par l’organisation territoriale du capitalisme britannique (centré sur le Grand Londres, le Grand Birmingham et le triangle Liverpool-Leeds-Sheffield avec Manchester), une très importante force de travail a été importée des nations celtiques périphériques vers l’Angleterre, où elle forma rapidement – et forme encore, en tout cas parmi les ‘blancs’ – la fraction du prolétariat la plus exploitée et, en même temps, la plus combattive ; jouant un rôle de premier plan dans le mouvement chartiste (démocratique, pour le suffrage universel), syndical (trade-unions), socialiste et communiste. Ceci contribua cependant, dans le même temps, au recul des langues nationales face à l’anglais. À partir des années 1920-30, vinrent s’ajouter des travailleurs venus de l’Empire colonial et des pays ‘sous influence’ (sous-continent indien, Afrique, Caraïbes, Proche/Moyen-Orient), ainsi que d’Europe centrale-orientale et méditerranéenne (dont la condition s’assimila rapidement à celle des ‘celtiques’). Les extra-européens formèrent, comme dans tous les pays impérialistes, des ‘indigénats métropolitains’, des ‘colonies intérieures’ (qui représentent aujourd'hui, par exemple... quelques 44% des 8,6 millions d'habitants du Grand Londres !). Celles-ci ont la caractéristique de s’être vues transposer l’esprit d’indigenous rule qui était appliqué dans l’Empire, vis-à-vis des peuples colonisés : regroupées dans des quartiers largement ‘mono-ethniques’, elles y ‘font leur vie’ sous l’égide d’autorités ‘communautaires’, ‘à leur manière’ du moment qu’elles ne
Pour les besoins, et de par l’organisation territoriale du capitalisme britannique (centré sur le Grand Londres, le Grand Birmingham et le triangle Liverpool-Leeds-Sheffield avec Manchester), une très importante force de travail a été importée des nations celtiques périphériques vers l’Angleterre, où elle forma rapidement – et forme encore, en tout cas parmi les ‘blancs’ – la fraction du prolétariat la plus exploitée et, en même temps, la plus combattive ; jouant un rôle de premier plan dans le mouvement chartiste (démocratique, pour le suffrage universel), syndical (trade-unions), socialiste et communiste. Ceci contribua cependant, dans le même temps, au recul des langues nationales face à l’anglais. À partir des années 1920-30, vinrent s’ajouter des travailleurs venus de l’Empire colonial et des pays ‘sous influence’ (sous-continent indien, Afrique, Caraïbes, Proche/Moyen-Orient), ainsi que d’Europe centrale-orientale et méditerranéenne (dont la condition s’assimila rapidement à celle des ‘celtiques’). Les extra-européens formèrent, comme dans tous les pays impérialistes, des ‘indigénats métropolitains’, des ‘colonies intérieures’ (qui représentent aujourd'hui, par exemple... quelques 44% des 8,6 millions d'habitants du Grand Londres !). Celles-ci ont la caractéristique de s’être vues transposer l’esprit d’indigenous rule qui était appliqué dans l’Empire, vis-à-vis des peuples colonisés : regroupées dans des quartiers largement ‘mono-ethniques’, elles y ‘font leur vie’ sous l’égide d’autorités ‘communautaires’, ‘à leur manière’ du moment qu’elles ne  contreviennent pas de manière flagrante aux lois britanniques (évidemment, depuis le 11-Septembre 2001 et plus encore depuis les attentats de Londres en 2005, les communautés de culture musulmane sont nettement plus ‘surveillées’). Elles continuent, dans leurs quartiers, à parler largement leurs langues nationales d’origine, et parlent anglais avec un net accent qui les identifie immédiatement. Il n’y a pas de politique d’assimilation (issue, là encore, de la ‘logique’ appliquée outre-mer) comme en ‘France’.
contreviennent pas de manière flagrante aux lois britanniques (évidemment, depuis le 11-Septembre 2001 et plus encore depuis les attentats de Londres en 2005, les communautés de culture musulmane sont nettement plus ‘surveillées’). Elles continuent, dans leurs quartiers, à parler largement leurs langues nationales d’origine, et parlent anglais avec un net accent qui les identifie immédiatement. Il n’y a pas de politique d’assimilation (issue, là encore, de la ‘logique’ appliquée outre-mer) comme en ‘France’.Après la Seconde Guerre mondiale, au terme d’un processus commencé au lendemain de la Première (malgré le triomphe apparent…), la ‘superpuissance’ impérialiste ‘britannique’ entrera en déclin, supplantée définitivement par son ‘fils prodigue’, l’impérialisme US avec lequel elle fera le choix de l’alliance inconditionnelle, au même titre que les dominions devenu à peu près complètement indépendants. Elle retire l’administration coloniale directe de son Empire, dès 1947-48 dans le sous-continent indien, dans les années 1955-70 des possessions d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie, et jusqu’aux années 1980 des Caraïbes et du Pacifique ; tout en veillant bien sûr à contrer la prise de pouvoir communiste (Malaisie 1948-60) et à combattre les velléités nationalistes les plus affirmées (Kenya 1952-56), sans toujours rencontrer le succès (le Yémen du Sud devient ‘marxiste’ et prosoviétique en 1969, la Tanzanie prochinoise avec Nyerere en 1964) ; et à maintenir sa domination indirecte à travers l’instrument du Commonwealth.
 Le Royaume-Uni n’en reste pas moins une puissance impérialiste de premier plan, membre du G8 et du G20. Au classement Forbes Global des grands monopoles pour 2012, parmi les 60 premiers groupes monopolistes mondiaux, quatre ont leur siège au Royaume-Uni (HSBC, BP, Vodafone et Barclays), plus l’anglo-néerlandais Shell dont le siège est à La Haye ; ce dernier et BP (4e et 11e) étant loin devant leur premier concurrent BBR (Total, 18e), et le groupe financier HSBC (6e) également (BNP Paribas, 20e). Deux autres se trouvent dans le Commonwealth (Commonwealth Bank et BHP Billiton, en Australie). On peut également signaler la ‘multinationale’ Rio Tinto (anglo-australienne, 69e au classement, écocide de premier ordre), ou la célèbre (par l’actualité) Mittal Steel, siégeant aux Pays-Bas (Arcelor Mittal au Luxembourg), mais avec beaucoup de capitaux du Royaume-Uni, où Mittal lui-même réside (il est la 8e fortune du pays).
Le Royaume-Uni n’en reste pas moins une puissance impérialiste de premier plan, membre du G8 et du G20. Au classement Forbes Global des grands monopoles pour 2012, parmi les 60 premiers groupes monopolistes mondiaux, quatre ont leur siège au Royaume-Uni (HSBC, BP, Vodafone et Barclays), plus l’anglo-néerlandais Shell dont le siège est à La Haye ; ce dernier et BP (4e et 11e) étant loin devant leur premier concurrent BBR (Total, 18e), et le groupe financier HSBC (6e) également (BNP Paribas, 20e). Deux autres se trouvent dans le Commonwealth (Commonwealth Bank et BHP Billiton, en Australie). On peut également signaler la ‘multinationale’ Rio Tinto (anglo-australienne, 69e au classement, écocide de premier ordre), ou la célèbre (par l’actualité) Mittal Steel, siégeant aux Pays-Bas (Arcelor Mittal au Luxembourg), mais avec beaucoup de capitaux du Royaume-Uni, où Mittal lui-même réside (il est la 8e fortune du pays).Il est important de souligner, ici, que depuis la ‘3e Guerre de Cent Ans’ (1688-1815) jusqu’à nos jours, le chauvinisme BBR s’est largement construit dans l’hostilité à l’Empire britannique, puisque la ‘France’, bien que souvent son alliée (Crimée, 1914-18, 1939-45) et jamais en conflit direct et ouvert depuis Waterloo, est devenue impérialiste dans un monde dominé par celui-ci (1815-1940), avant que ne lui succède l’impérialisme US (dont le Royaume-Uni serait aujourd'hui, selon nos chauvins, le ‘51e État’, le 52e étant sans doute Israël). De ceci résulte, parfois, une ‘célébration’ de notre ‘modèle’ colonial ‘civilisateur’, face à un impérialisme british qui serait ‘de pur pillage’ et ‘n’apporterait rien aux populations’ ; ou encore, une certaine ‘celtophilie’ réactionnaire qui se berce dans le souvenir de l’Auld Alliance et du soutien de la ‘France’ du Directoire à Wolfe Tone, allant parfois jusqu’à soutenir la résistance populaire armée irlandaise sur une ligne anti-anglo-saxonne, 100% impérialiste et n’ayant rien à voir avec la libération révolutionnaire des peuples : le ‘Celte’ (surtout l’Irlandais catholique) est considéré comme l'individu ‘ancré’ dans ‘la terre et les morts’, tandis que l’Anglo-Saxon est le ‘thalassocrate’ dominateur, soldat de la City et de la franc-maçonnerie internationale… On retrouve cette ‘celtophilie’ dans toute l’extrême-droite fasciste BBR, mais aussi, culturellement, jusque dans une chanson comme le Connemara de l’artiste de droite Sardou...
 Le Royaume-Uni revêt une grande importance dans l’histoire du mouvement communiste international : c’est là, en effet, à Londres, que vécurent exilés Marx et Engels, de 1849 jusqu’à leurs morts respectives (1883 et 1895). C’est là, donc, qu’est pour ainsi dire née la théorie socialiste révolutionnaire scientifique, même si le premier ouvrage de référence, le Manifeste, a probablement été rédigé à Bruxelles (pendant l’hiver 1847-48). C’est là (à Londres) que se tint le 2e congrès de la Ligue des communistes (novembre 1847, lors duquel fut demandée la rédaction du Manifeste), et que fut officiellement créée, en 1864, la 1ère Internationale socialiste, l’Association internationale des Travailleurs (AIT). C’est évidemment en observant la société capitaliste industrielle britannique que fut écrit l’ouvrage phare de la science marxiste, le Capital. C’est aussi dans les Îles Britanniques que Marx et Engels eurent l’occasion d’affiner leur matérialisme historique, puisqu’ils purent y voir non seulement toute l’horreur de la condition des peuples celtiques dominés et du prolétariat importé de ces nations en Angleterre, mais aussi combien cette question et le ‘privilège national’ dont jouissait la classe ouvrière anglaise, la division des opprimés ainsi permise, étaient un frein considérable au développement de la conscience ouvrière de classe et de la lutte révolutionnaire : Marx finira par dire que « Ce qui est primordial, c'est que chaque centre industriel et commercial d'Angleterre possède maintenant une classe ouvrière divisée en deux camps hostiles : les prolétaires anglais et les prolétaires irlandais. L'ouvrier anglais moyen déteste l'ouvrier irlandais en qui il voit un concurrent qui dégrade son niveau de vie. Par rapport à l'ouvrier irlandais, il se sent membre de la nation dominante et devient ainsi un instrument que les aristocrates et capitalistes de son pays utilisent contre l'Irlande. Ce faisant, il renforce leur domination sur lui-même. Il se berce de préjugés religieux, sociaux et nationaux contre les travailleurs irlandais. Il se comporte à peu près comme les blancs pauvres vis-à-vis des nègres dans les anciens États esclavagistes des États-Unis. L'Irlandais lui rend avec intérêt la monnaie de sa pièce. Il voit dans l'ouvrier anglais à la fois un complice et un instrument stupide de la domination anglaise en Irlande. Cet antagonisme est artificiellement entretenu et développé par la presse, le clergé et les revues satiriques, bref par tous les moyens dont disposent les classes dominantes. Cet antagonisme est le secret de l'impuissance de la classe ouvrière anglaise, malgré son organisation’. » (Lettre à Siegfried Mayer et August Vogt – socialistes allemands émigrés aux USA ; avril 1870)[2].
Le Royaume-Uni revêt une grande importance dans l’histoire du mouvement communiste international : c’est là, en effet, à Londres, que vécurent exilés Marx et Engels, de 1849 jusqu’à leurs morts respectives (1883 et 1895). C’est là, donc, qu’est pour ainsi dire née la théorie socialiste révolutionnaire scientifique, même si le premier ouvrage de référence, le Manifeste, a probablement été rédigé à Bruxelles (pendant l’hiver 1847-48). C’est là (à Londres) que se tint le 2e congrès de la Ligue des communistes (novembre 1847, lors duquel fut demandée la rédaction du Manifeste), et que fut officiellement créée, en 1864, la 1ère Internationale socialiste, l’Association internationale des Travailleurs (AIT). C’est évidemment en observant la société capitaliste industrielle britannique que fut écrit l’ouvrage phare de la science marxiste, le Capital. C’est aussi dans les Îles Britanniques que Marx et Engels eurent l’occasion d’affiner leur matérialisme historique, puisqu’ils purent y voir non seulement toute l’horreur de la condition des peuples celtiques dominés et du prolétariat importé de ces nations en Angleterre, mais aussi combien cette question et le ‘privilège national’ dont jouissait la classe ouvrière anglaise, la division des opprimés ainsi permise, étaient un frein considérable au développement de la conscience ouvrière de classe et de la lutte révolutionnaire : Marx finira par dire que « Ce qui est primordial, c'est que chaque centre industriel et commercial d'Angleterre possède maintenant une classe ouvrière divisée en deux camps hostiles : les prolétaires anglais et les prolétaires irlandais. L'ouvrier anglais moyen déteste l'ouvrier irlandais en qui il voit un concurrent qui dégrade son niveau de vie. Par rapport à l'ouvrier irlandais, il se sent membre de la nation dominante et devient ainsi un instrument que les aristocrates et capitalistes de son pays utilisent contre l'Irlande. Ce faisant, il renforce leur domination sur lui-même. Il se berce de préjugés religieux, sociaux et nationaux contre les travailleurs irlandais. Il se comporte à peu près comme les blancs pauvres vis-à-vis des nègres dans les anciens États esclavagistes des États-Unis. L'Irlandais lui rend avec intérêt la monnaie de sa pièce. Il voit dans l'ouvrier anglais à la fois un complice et un instrument stupide de la domination anglaise en Irlande. Cet antagonisme est artificiellement entretenu et développé par la presse, le clergé et les revues satiriques, bref par tous les moyens dont disposent les classes dominantes. Cet antagonisme est le secret de l'impuissance de la classe ouvrière anglaise, malgré son organisation’. » (Lettre à Siegfried Mayer et August Vogt – socialistes allemands émigrés aux USA ; avril 1870)[2]. L’île de Grande-Bretagne comptait à cette époque, et de loin, le plus important prolétariat ouvrier de la planète - le Royaume-Uni était appelé, à juste titre, ‘l’atelier du monde’, car à l’époque, les colonies et semi-colonies étaient encore (avant tout) des débouchés commerciaux et des fournisseurs de matières premières et agricoles, mais la transformation industrielle de la matière s’effectuait quasi-exclusivement dans les pays en révolution industrielle comme l’Angleterre. C’est ainsi que, au-delà du seul marxisme, c’est aussi là que le mouvement ouvrier au sens large s’est développé en premier. Tout au long du 19e siècle et jusqu’au début du 20e, il s’articule autour de deux axes essentiels : le chartisme, qui réclame le suffrage universel (obtenu, on l’a dit, seulement en 1918 pour les hommes et 1928 pour les femmes) et le bénéfice le plus large des ‘libertés anglaises’ pour les classes populaires ; et le trade-unionisme, qui vise à unir (union) les travailleurs pour l’obtention des meilleurs salaires, droits, conditions de travail etc. possibles dans les entreprises. Le Royaume-Uni voit aussi (toujours sur la question électorale) l’apparition du premier mouvement féministe contemporain : les suffragettes, qui réclament le droit de vote pour les femmes.
L’île de Grande-Bretagne comptait à cette époque, et de loin, le plus important prolétariat ouvrier de la planète - le Royaume-Uni était appelé, à juste titre, ‘l’atelier du monde’, car à l’époque, les colonies et semi-colonies étaient encore (avant tout) des débouchés commerciaux et des fournisseurs de matières premières et agricoles, mais la transformation industrielle de la matière s’effectuait quasi-exclusivement dans les pays en révolution industrielle comme l’Angleterre. C’est ainsi que, au-delà du seul marxisme, c’est aussi là que le mouvement ouvrier au sens large s’est développé en premier. Tout au long du 19e siècle et jusqu’au début du 20e, il s’articule autour de deux axes essentiels : le chartisme, qui réclame le suffrage universel (obtenu, on l’a dit, seulement en 1918 pour les hommes et 1928 pour les femmes) et le bénéfice le plus large des ‘libertés anglaises’ pour les classes populaires ; et le trade-unionisme, qui vise à unir (union) les travailleurs pour l’obtention des meilleurs salaires, droits, conditions de travail etc. possibles dans les entreprises. Le Royaume-Uni voit aussi (toujours sur la question électorale) l’apparition du premier mouvement féministe contemporain : les suffragettes, qui réclament le droit de vote pour les femmes.Malheureusement, il est facile de voir (pour un marxiste) qu’avec des telles revendications, ces mouvements ne réussiront jamais à franchir les limites du réformisme, en lien avec les éléments les plus ‘radicaux’ et ‘sociaux’ de la ‘gauche’ libérale bourgeoise, et finiront par confluer en 1900 dans le Parti travailliste (Labour), ‘aile gauche’ assumée de la politique des monopoles, rejetant ouvertement le marxisme, et qui commencera à gouverner en 1924 avec les libéraux (puis 1929-31, puis seuls en 1945-51, 1964-70, 1974-79 et enfin 1997-2010 avec Blair et Brown : autant dire que le travaillisme aura présidé à bon nombre des pires saloperies de l’État britannique et de son Empire !). Le marxisme, s’il est ‘né’ pour ainsi dire en Grande-Bretagne, y restera toujours très marginal ; et a fortiori le marxisme-léninisme (le PC ‘historique’ de Grande-Bretagne, celui de 1920, n’aura jamais que quelques dizaines de milliers de membres) et le maoïsme, malgré des organisations parfois de qualité. Ceci contrairement, d’ailleurs, à bon nombre d’autres pays de culture ‘anglo-saxonne’ : USA (où il a toujours été beaucoup plus important qu’on ne le pense, donnant des personnalités
 ‘phares’ du MCI comme Harry Haywood et des expériences lumineuses comme celle des Black Panthers), Canada (bien qu’il y soit surtout présent au Québec) ou Nouvelle-Zélande (où la majorité du PC choisît la Chine dans les années 1960, héritage maoïste aujourd’hui poursuivi par le PC d’Aotearoa - le nom maori de l’île). La gauche révolutionnaire d’outre-Manche est, en réalité, dominée historiquement par le trotskysme, qui en a fait son autre ‘bastion’ international après la ‘France’ (mais pour des ‘tendances’ sensiblement différentes de l’héritage du barbichu), avec des organisations comme le Socialist Worker’s Party (SWP de Tony Cliff, sans doute l’une des plus importantes organisations trotskystes au monde), le Socialist Party qui ‘dirige’ internationalement le CWI/CIO (auquel se rattache en Hexagone la ‘Gauche révolutionnaire’ qui a rejoint le NPA), et le siège de la Tendance Marxiste Internationale (Ted Grant, Alan Woods) à laquelle se rattache ici la bien connue ‘Riposte’ qui milite au sein du PCF. Un trotskysme qui, dans sa logique d’‘entrer’ les forces politiques et syndicales réformistes du système (au Royaume-Uni, c’est la même chose : le Labour est LE parti des syndicats), pour les 'pousser en avant’ jusqu’à la 'rupture révolutionnaire’, ne pouvait évidemment guère trouver un terrain plus propice (les trade-unions comptent encore 7 millions de membres, et le Labour 450.000). Globalement, la Grande-Bretagne et particulièrement l’Angleterre se sont caractérisées au cours du 20e siècle, par opposition au continent, par une très forte ‘paix sociale’ qui reste un modèle pour beaucoup d’idéologues bourgeois, malgré - évidemment - une certaine agitation lors de la crise de 1929, la contestation démocratique de la jeunesse dans les années 1960-70, et les fortes luttes (mais dont la défaite, là encore, est restée un ‘modèle’ pour la bourgeoisie mondiale) des années 1980, contre la politique thatchérienne de destruction des ‘acquis sociaux’ des gouvernements travaillistes successifs. C’est pourquoi, par exemple, la grande explosion de rage populaire de l’été 2011 a pu être considérée là-bas comme du ‘jamais vu’, avec des forces de répression parfois débordées (de même avec le mouvement étudiant quelques mois auparavant, contre l’augmentation délirante des frais universitaires).
‘phares’ du MCI comme Harry Haywood et des expériences lumineuses comme celle des Black Panthers), Canada (bien qu’il y soit surtout présent au Québec) ou Nouvelle-Zélande (où la majorité du PC choisît la Chine dans les années 1960, héritage maoïste aujourd’hui poursuivi par le PC d’Aotearoa - le nom maori de l’île). La gauche révolutionnaire d’outre-Manche est, en réalité, dominée historiquement par le trotskysme, qui en a fait son autre ‘bastion’ international après la ‘France’ (mais pour des ‘tendances’ sensiblement différentes de l’héritage du barbichu), avec des organisations comme le Socialist Worker’s Party (SWP de Tony Cliff, sans doute l’une des plus importantes organisations trotskystes au monde), le Socialist Party qui ‘dirige’ internationalement le CWI/CIO (auquel se rattache en Hexagone la ‘Gauche révolutionnaire’ qui a rejoint le NPA), et le siège de la Tendance Marxiste Internationale (Ted Grant, Alan Woods) à laquelle se rattache ici la bien connue ‘Riposte’ qui milite au sein du PCF. Un trotskysme qui, dans sa logique d’‘entrer’ les forces politiques et syndicales réformistes du système (au Royaume-Uni, c’est la même chose : le Labour est LE parti des syndicats), pour les 'pousser en avant’ jusqu’à la 'rupture révolutionnaire’, ne pouvait évidemment guère trouver un terrain plus propice (les trade-unions comptent encore 7 millions de membres, et le Labour 450.000). Globalement, la Grande-Bretagne et particulièrement l’Angleterre se sont caractérisées au cours du 20e siècle, par opposition au continent, par une très forte ‘paix sociale’ qui reste un modèle pour beaucoup d’idéologues bourgeois, malgré - évidemment - une certaine agitation lors de la crise de 1929, la contestation démocratique de la jeunesse dans les années 1960-70, et les fortes luttes (mais dont la défaite, là encore, est restée un ‘modèle’ pour la bourgeoisie mondiale) des années 1980, contre la politique thatchérienne de destruction des ‘acquis sociaux’ des gouvernements travaillistes successifs. C’est pourquoi, par exemple, la grande explosion de rage populaire de l’été 2011 a pu être considérée là-bas comme du ‘jamais vu’, avec des forces de répression parfois débordées (de même avec le mouvement étudiant quelques mois auparavant, contre l’augmentation délirante des frais universitaires). Il en va sensiblement différemment dans les nations celtiques, et particulièrement en Irlande. Là, tout au long du 19e siècle, comme l’expliquait Marx dans sa lettre à Mayer et Vogt, la question sociale fut essentiellement paysanne, nationale et démocratique : les landlords anglais installés depuis le 17e siècle avaient pour fonction sociale de transformer l’île en ‘grenier de proximité’ de la Grande-Bretagne industrielle, au détriment total de la population gaélique qui, ‘après tout’, n’avait qu’à aller ‘voir ailleurs’ - ce qu’elle fit, massivement, principalement vers les États-Unis, ou encore le Canada ou l’Australie, et bien sûr vers les centres industriels anglais (Londres, Manchester etc.) ou bas-écossais
Il en va sensiblement différemment dans les nations celtiques, et particulièrement en Irlande. Là, tout au long du 19e siècle, comme l’expliquait Marx dans sa lettre à Mayer et Vogt, la question sociale fut essentiellement paysanne, nationale et démocratique : les landlords anglais installés depuis le 17e siècle avaient pour fonction sociale de transformer l’île en ‘grenier de proximité’ de la Grande-Bretagne industrielle, au détriment total de la population gaélique qui, ‘après tout’, n’avait qu’à aller ‘voir ailleurs’ - ce qu’elle fit, massivement, principalement vers les États-Unis, ou encore le Canada ou l’Australie, et bien sûr vers les centres industriels anglais (Londres, Manchester etc.) ou bas-écossais  (Glasgow). Le summum des conséquences de cet ordre colonial barbare, tombant d’ailleurs ‘à point nommé’ pour favoriser le ‘nettoyage’ voulu par les landlords d’une île qui commençait à se ‘surpeupler’[3], fut la tristement célèbre Grande Famine de 1845-51, suite à une maladie de la pomme de terre (base de l’alimentation insulaire), dont les conséquences sanitaires (on y mourut peu ‘de faim’ à proprement parler, mais des conséquences de la sous-alimentation) se chiffrent à plus d’un million de mort-e-s, provoquant l’émigration de millions d’autres Irlandais-es vers (principalement) les États-Unis - au total, la population de l’île tombera de 8,5 millions au début de la famine à 4,5 millions en 1911, soit le niveau de 1800. La question ouvrière irlandaise se trouvait essentiellement, comme l’explique Marx, ‘expatriée’ dans les centres industriels anglais ; bien que, dès cette époque, une industrie et donc une classe ouvrière se développe en Irlande même, autour de Dublin ou - particulièrement - de Belfast (où fut construit, par exemple, le célèbre Titanic).
(Glasgow). Le summum des conséquences de cet ordre colonial barbare, tombant d’ailleurs ‘à point nommé’ pour favoriser le ‘nettoyage’ voulu par les landlords d’une île qui commençait à se ‘surpeupler’[3], fut la tristement célèbre Grande Famine de 1845-51, suite à une maladie de la pomme de terre (base de l’alimentation insulaire), dont les conséquences sanitaires (on y mourut peu ‘de faim’ à proprement parler, mais des conséquences de la sous-alimentation) se chiffrent à plus d’un million de mort-e-s, provoquant l’émigration de millions d’autres Irlandais-es vers (principalement) les États-Unis - au total, la population de l’île tombera de 8,5 millions au début de la famine à 4,5 millions en 1911, soit le niveau de 1800. La question ouvrière irlandaise se trouvait essentiellement, comme l’explique Marx, ‘expatriée’ dans les centres industriels anglais ; bien que, dès cette époque, une industrie et donc une classe ouvrière se développe en Irlande même, autour de Dublin ou - particulièrement - de Belfast (où fut construit, par exemple, le célèbre Titanic). À partir de la fin du 18e siècle, le mouvement national irlandais renaît ; il tourne le dos au ‘passéisme’ jacobite (et, côté ‘protestant’ parfois, à un ‘nationalisme colonial’ sur le modèle américain : des ‘droits’... mais pour les colons seulement), pour s’emparer des idées démocratiques avancées de la révolution bourgeoise ‘française’. Il repose sur une union de la bourgeoisie libérale et démocratique ‘protestante’, dont la figure la plus connue est Theobald Wolfe Tone (1763-98), et des masses paysannes et populaires ultra-majoritairement catholiques : de là, on l’a dit, le drapeau irlandais que nous connaissons, symbolisant de manière idéaliste la concorde (blanc) entre les catholiques (vert) et les protestants (orange). Le soulèvement de Wolfe Tone recevra l’aide du Directoire ‘français’ en guerre, lui aussi, contre l’Empire britannique ; il sera néanmoins écrasé et sauvagement réprimé (Wolfe Tone lui-même sera condamné à mort, il se suicidera avant son exécution). Cette première tentative donne néanmoins subjectivement naissance au nouveau mouvement national, animé d’un contenu progressiste - elle en restera une ‘référence’ jusqu’à nos jours. Le mouvement se ‘relance’ à partir du milieu du 19e siècle (Grande Famine), notamment au sein de l’émigration en Amérique du Nord : Irish Republican Brotherhood (IRB, née en 1858 à Dublin et New York), mouvement Fenian (plus large, désigne tou-te-s celles et ceux qui luttent par la violence contre la domination anglaise), et militantisme (plus pacifiste, de concert avec les ‘libéraux avancés’ anglais) pour le Home Rule - l’autonomie, le retour d’un
À partir de la fin du 18e siècle, le mouvement national irlandais renaît ; il tourne le dos au ‘passéisme’ jacobite (et, côté ‘protestant’ parfois, à un ‘nationalisme colonial’ sur le modèle américain : des ‘droits’... mais pour les colons seulement), pour s’emparer des idées démocratiques avancées de la révolution bourgeoise ‘française’. Il repose sur une union de la bourgeoisie libérale et démocratique ‘protestante’, dont la figure la plus connue est Theobald Wolfe Tone (1763-98), et des masses paysannes et populaires ultra-majoritairement catholiques : de là, on l’a dit, le drapeau irlandais que nous connaissons, symbolisant de manière idéaliste la concorde (blanc) entre les catholiques (vert) et les protestants (orange). Le soulèvement de Wolfe Tone recevra l’aide du Directoire ‘français’ en guerre, lui aussi, contre l’Empire britannique ; il sera néanmoins écrasé et sauvagement réprimé (Wolfe Tone lui-même sera condamné à mort, il se suicidera avant son exécution). Cette première tentative donne néanmoins subjectivement naissance au nouveau mouvement national, animé d’un contenu progressiste - elle en restera une ‘référence’ jusqu’à nos jours. Le mouvement se ‘relance’ à partir du milieu du 19e siècle (Grande Famine), notamment au sein de l’émigration en Amérique du Nord : Irish Republican Brotherhood (IRB, née en 1858 à Dublin et New York), mouvement Fenian (plus large, désigne tou-te-s celles et ceux qui luttent par la violence contre la domination anglaise), et militantisme (plus pacifiste, de concert avec les ‘libéraux avancés’ anglais) pour le Home Rule - l’autonomie, le retour d’un  Parlement et d’un gouvernement autonome irlandais. Au début du 20e siècle naît le Sinn Féin (1905), fondé par Arthur Griffith, qui est au départ plutôt un mouvement de renaissance culturelle, ne prônant pas vraiment l’indépendance, mais plutôt une semi-indépendance en union personnelle via le souverain britannique, sur le ‘modèle’ austro-hongrois. Mais, avec le développement d’une classe ouvrière irlandaise (et la grande importance des Irlandais-es dans le prolétariat de Grande-Bretagne et d’Amérique du Nord), le mouvement national va bientôt voir naître un courant socialiste, avec notamment James Connolly, qui fonde en 1896 le (premier) Parti socialiste républicain irlandais (ISRP). Celui-ci est le premier parti irlandais à revendiquer, clairement, une République indépendante (ce n’est pas encore le cas du Sinn Féin). Il devient en 1912 l’Irish Labour Party et crée dans la foulée une armée populaire, l’Irish Citizen Army (ICA). Cette ICA converge finalement avec des éléments de l’IRB et les Irish Volunteers (milice née
Parlement et d’un gouvernement autonome irlandais. Au début du 20e siècle naît le Sinn Féin (1905), fondé par Arthur Griffith, qui est au départ plutôt un mouvement de renaissance culturelle, ne prônant pas vraiment l’indépendance, mais plutôt une semi-indépendance en union personnelle via le souverain britannique, sur le ‘modèle’ austro-hongrois. Mais, avec le développement d’une classe ouvrière irlandaise (et la grande importance des Irlandais-es dans le prolétariat de Grande-Bretagne et d’Amérique du Nord), le mouvement national va bientôt voir naître un courant socialiste, avec notamment James Connolly, qui fonde en 1896 le (premier) Parti socialiste républicain irlandais (ISRP). Celui-ci est le premier parti irlandais à revendiquer, clairement, une République indépendante (ce n’est pas encore le cas du Sinn Féin). Il devient en 1912 l’Irish Labour Party et crée dans la foulée une armée populaire, l’Irish Citizen Army (ICA). Cette ICA converge finalement avec des éléments de l’IRB et les Irish Volunteers (milice née  pour défendre le Home Rule face aux Ulster Volunteers unionistes, farouchement opposés à celui-ci) pour déclencher l’insurrection de Pâques 1916 (en 1919, ces forces donneront officiellement naissance à l’IRA). Connolly sera également l'un des premiers marxistes à affirmer, à l'ère de la révolution prolétarienne, le caractère indissociable de la libération sociale et de la libération nationale : "si dès demain vous chassiez l’Armée anglaise et hissiez le drapeau vert sur le Château de Dublin, à moins que vous ne proclamiez la République socialiste, vos efforts auraient été vains. L’Angleterre continuerait à vous dominer. Elle vous dominerait par l’intermédiaire de ses capitalistes, de ses propriétaires fonciers, de ses financiers, de toutes les institutions commerciales et individualistes qu’elle a plantées dans ce pays et arrosées des larmes de nos mères et du sang de nos martyrs". L'insurrection de Pâques est brutalement réprimée par le pouvoir 'britannique' (500 mort-e-s) ; Connolly, avec d'autres (Patrick Pearse de l'IRB, sir Roger Casement), est fait prisonnier, condamné à mort et exécuté. La lutte ne tarde cependant pas à reprendre, dès la fin de la guerre mondiale. On ne rentrera pas, ici, dans les détails de la guerre de libération nationale irlandaise : rien que la période des ‘Troubles’ de 1969-98 fait l’objet d’un ouvrage entier du camarade Liam O’Ruairc. On dira simplement que c’est un processus, depuis 1916 jusqu’à nos jours, marqué par une succession de ‘ruptures’ qui amènent systématiquement une partie – une droite – du mouvement à trahir la cause de la libération nationale et sociale au nom de ses intérêts de classe (bourgeois, petits-bourgeois), et une autre à poursuivre la lutte, ‘tirant’ l’’idéal' républicain de libération toujours plus vers la gauche... La guerre d’indépendance de 1919-21 débouche sur le ‘fameux’ Traité de Londres, qui conserve au Royaume-Uni les 6 comtés du Nord-Est et crée dans les 26 restants l’’État libre’ qui deviendra la ‘République d’Éire’ ; et qui voit la division et l’éclatement d’une guerre civile (1922-23) entre ses partisans (Griffith, Michael Collins etc.) et ses adversaires résolus (Eamon De Valera), qui conservent les appellations IRA et Sinn Féin. En 1926, De Valera adopte à son tour une position plus ‘conciliante’ vis-à-vis des institutions de l’’État libre’ (il représente la fraction ultranationaliste de la bourgeoisie irlandaise, liée aux monopoles US et allemands), et fonde le Fianna Fáil, qui est aujourd’hui l'un des deux grands partis bourgeois de droite de la ‘République d’Éire’ (les pro-Traité, eux, donneront naissance au Fine Gael et même, dans les années 1930, à un mouvement fasciste, les ‘chemises bleues’ du général O’Duffy : ce sont les forces grandes-bourgeoises, cléricales et même aristocratiques ‘nationales’ les plus compradores vis-à-vis de l’impérialisme). Le Sinn Féin et l’IRA poursuivent de leur côté mais leur
pour défendre le Home Rule face aux Ulster Volunteers unionistes, farouchement opposés à celui-ci) pour déclencher l’insurrection de Pâques 1916 (en 1919, ces forces donneront officiellement naissance à l’IRA). Connolly sera également l'un des premiers marxistes à affirmer, à l'ère de la révolution prolétarienne, le caractère indissociable de la libération sociale et de la libération nationale : "si dès demain vous chassiez l’Armée anglaise et hissiez le drapeau vert sur le Château de Dublin, à moins que vous ne proclamiez la République socialiste, vos efforts auraient été vains. L’Angleterre continuerait à vous dominer. Elle vous dominerait par l’intermédiaire de ses capitalistes, de ses propriétaires fonciers, de ses financiers, de toutes les institutions commerciales et individualistes qu’elle a plantées dans ce pays et arrosées des larmes de nos mères et du sang de nos martyrs". L'insurrection de Pâques est brutalement réprimée par le pouvoir 'britannique' (500 mort-e-s) ; Connolly, avec d'autres (Patrick Pearse de l'IRB, sir Roger Casement), est fait prisonnier, condamné à mort et exécuté. La lutte ne tarde cependant pas à reprendre, dès la fin de la guerre mondiale. On ne rentrera pas, ici, dans les détails de la guerre de libération nationale irlandaise : rien que la période des ‘Troubles’ de 1969-98 fait l’objet d’un ouvrage entier du camarade Liam O’Ruairc. On dira simplement que c’est un processus, depuis 1916 jusqu’à nos jours, marqué par une succession de ‘ruptures’ qui amènent systématiquement une partie – une droite – du mouvement à trahir la cause de la libération nationale et sociale au nom de ses intérêts de classe (bourgeois, petits-bourgeois), et une autre à poursuivre la lutte, ‘tirant’ l’’idéal' républicain de libération toujours plus vers la gauche... La guerre d’indépendance de 1919-21 débouche sur le ‘fameux’ Traité de Londres, qui conserve au Royaume-Uni les 6 comtés du Nord-Est et crée dans les 26 restants l’’État libre’ qui deviendra la ‘République d’Éire’ ; et qui voit la division et l’éclatement d’une guerre civile (1922-23) entre ses partisans (Griffith, Michael Collins etc.) et ses adversaires résolus (Eamon De Valera), qui conservent les appellations IRA et Sinn Féin. En 1926, De Valera adopte à son tour une position plus ‘conciliante’ vis-à-vis des institutions de l’’État libre’ (il représente la fraction ultranationaliste de la bourgeoisie irlandaise, liée aux monopoles US et allemands), et fonde le Fianna Fáil, qui est aujourd’hui l'un des deux grands partis bourgeois de droite de la ‘République d’Éire’ (les pro-Traité, eux, donneront naissance au Fine Gael et même, dans les années 1930, à un mouvement fasciste, les ‘chemises bleues’ du général O’Duffy : ce sont les forces grandes-bourgeoises, cléricales et même aristocratiques ‘nationales’ les plus compradores vis-à-vis de l’impérialisme). Le Sinn Féin et l’IRA poursuivent de leur côté mais leur  activité devient alors très marginale. À la fin des années 1960 éclatent, au Nord, les ‘Troubles’ pour l’égalité des droits des ‘catholiques’, citoyens de seconde zone. L’armée ‘britannique’ intervient, les institutions ‘nord-irlandaises’ sont ‘suspendues’ et l’IRA prend en main la résistance populaire. Dans ce contexte, un courant Officiel de l’IRA et du Sinn Féin rejette le principe d’abstentionnisme électoral (qui exprime la non-reconnaissance des institutions britanniques, ‘nord-irlandaises’ et d’’Éire’), puis la lutte armée (1972) et fait passer la libération nationale au 18e plan, pour se transformer en gauche ‘radicale’ électoraliste ; tandis qu’un courant Provisoire, peut-être moins ‘socialiste’ mais plus intransigeant sur la question nationale, poursuit la lutte ainsi qu’une scission des Officiels, l'Irish Republican Socialist Party (IRSP) (1-2-3-4) avec l’Armée de Libération nationale irlandaise (INLA). Mais l’Empire britannique et son valet d’’Éire’ (avec l’appui US et UE), très habilement et tout en réprimant sans pitié (assassinats, emprisonnements sans procès dans les ‘H-blocks’, grévistes de la faim abandonnés jusqu’à la mort, etc.), vont favoriser au sein de ce MLN une droite capitulationniste (Adams, McGuinness & co) qui va dès les années 1980 renoncer à l’abstentionnisme, et s’engager dans des ‘pourparlers’ qui conduiront finalement à l'‘Accord du Vendredi Saint’ (10 avril 1998), ré-entérinant la partition de l’île, ‘refondant’ des institutions ‘nord-irlandaises’ fantoches etc., mais cette fois avec la complicité de ceux-là mêmes qui étaient le ‘Grand Satan’ de la propagande britannique et
activité devient alors très marginale. À la fin des années 1960 éclatent, au Nord, les ‘Troubles’ pour l’égalité des droits des ‘catholiques’, citoyens de seconde zone. L’armée ‘britannique’ intervient, les institutions ‘nord-irlandaises’ sont ‘suspendues’ et l’IRA prend en main la résistance populaire. Dans ce contexte, un courant Officiel de l’IRA et du Sinn Féin rejette le principe d’abstentionnisme électoral (qui exprime la non-reconnaissance des institutions britanniques, ‘nord-irlandaises’ et d’’Éire’), puis la lutte armée (1972) et fait passer la libération nationale au 18e plan, pour se transformer en gauche ‘radicale’ électoraliste ; tandis qu’un courant Provisoire, peut-être moins ‘socialiste’ mais plus intransigeant sur la question nationale, poursuit la lutte ainsi qu’une scission des Officiels, l'Irish Republican Socialist Party (IRSP) (1-2-3-4) avec l’Armée de Libération nationale irlandaise (INLA). Mais l’Empire britannique et son valet d’’Éire’ (avec l’appui US et UE), très habilement et tout en réprimant sans pitié (assassinats, emprisonnements sans procès dans les ‘H-blocks’, grévistes de la faim abandonnés jusqu’à la mort, etc.), vont favoriser au sein de ce MLN une droite capitulationniste (Adams, McGuinness & co) qui va dès les années 1980 renoncer à l’abstentionnisme, et s’engager dans des ‘pourparlers’ qui conduiront finalement à l'‘Accord du Vendredi Saint’ (10 avril 1998), ré-entérinant la partition de l’île, ‘refondant’ des institutions ‘nord-irlandaises’ fantoches etc., mais cette fois avec la complicité de ceux-là mêmes qui étaient le ‘Grand Satan’ de la propagande britannique et  impérialiste mondiale quelques années auparavant… Les éléments qui refusent cette dérive liquidatrice sont appelés les ‘dissidents’ : Republican Sinn Féin, 32CSM, IRA ‘véritable’ et ‘continuité’, etc. (l’IRSP/INLA a pour sa part déposé les armes, à son tour, en 2009). Pour s’informer sur tout cela, et c’est très volontiers que pub leur sera faite, il y a le site des camarades de Libération Irlande, unique média de solidarité francophone ‘non-aligné’ avec la capitulation ‘Provo’. En tout cas, la guerre de libération irlandaise a donné lieu à des expériences fascinantes comme les quartiers ‘catholiques’ libérés où les forces étatiques ne pouvaient mettre les pieds qu’à leurs risques et périls (voire pas du tout), notamment le ‘Free Derry’ du quartier Bogside (début des années 1970), les maoïstes ou ‘maoïsants’ Jim Lynagh de la brigade Provo IRA de l’East Tyrone (abattu par les SAS en 1987), Jim Lane, John O’Reilly et Thomas ‘Ta’ Power de l’IRSP/INLA, les ‘maos de Cork’, etc. etc. ; expériences extrêmement instructives sur la question de la Guerre populaire en pays capitaliste avancé.
impérialiste mondiale quelques années auparavant… Les éléments qui refusent cette dérive liquidatrice sont appelés les ‘dissidents’ : Republican Sinn Féin, 32CSM, IRA ‘véritable’ et ‘continuité’, etc. (l’IRSP/INLA a pour sa part déposé les armes, à son tour, en 2009). Pour s’informer sur tout cela, et c’est très volontiers que pub leur sera faite, il y a le site des camarades de Libération Irlande, unique média de solidarité francophone ‘non-aligné’ avec la capitulation ‘Provo’. En tout cas, la guerre de libération irlandaise a donné lieu à des expériences fascinantes comme les quartiers ‘catholiques’ libérés où les forces étatiques ne pouvaient mettre les pieds qu’à leurs risques et périls (voire pas du tout), notamment le ‘Free Derry’ du quartier Bogside (début des années 1970), les maoïstes ou ‘maoïsants’ Jim Lynagh de la brigade Provo IRA de l’East Tyrone (abattu par les SAS en 1987), Jim Lane, John O’Reilly et Thomas ‘Ta’ Power de l’IRSP/INLA, les ‘maos de Cork’, etc. etc. ; expériences extrêmement instructives sur la question de la Guerre populaire en pays capitaliste avancé.  Les autres nations, nettement plus (et plus précocement) industrialisées (Pays de Galles minier, Lowlands écossais), ont vu très tôt se développer un mouvement ouvrier ‘socialisant’ : en 1831, le drapeau rouge est ainsi hissé au cours d’un soulèvement gallois à Merthyr Tydfil. Le mouvement socialiste écossais est également conséquent (même si le travaillisme a rapidement fait des Lowlands un de ses bastions, Gordon Brown en étant par exemple originaire) ; Connolly y fait notamment ses premières armes avant d’aller fonder l’IRSP en Irlande. Il faut cependant un certain temps pour que, sans jamais en avoir perdu conscience (la conscience nationale ne fut, de toute façon, jamais réellement niée), ce mouvement fusionne avec l’affirmation de la question nationale dans un véritable MLN socialiste (NB : le terme ‘socialiste’ reste dans les pays anglo-saxons très radicalement ‘connoté’, loin de la gestion ‘de gôche’ du capitalisme qu’il peut signifier en Europe ‘latine’). Nous avons ainsi un mouvement républicain socialiste écossais (SRSM), né en 1973, ainsi qu’un Parti socialiste écossais anticapitaliste et indépendantiste (SSP) membre de la Gauche anticapitaliste européenne, proche du NPA, du SWP, de Syriza etc., très influencé par le SRSM qui en est (depuis 1999) un courant, et même un Parti communiste qui a scissionné du PC ‘historique’ de
Les autres nations, nettement plus (et plus précocement) industrialisées (Pays de Galles minier, Lowlands écossais), ont vu très tôt se développer un mouvement ouvrier ‘socialisant’ : en 1831, le drapeau rouge est ainsi hissé au cours d’un soulèvement gallois à Merthyr Tydfil. Le mouvement socialiste écossais est également conséquent (même si le travaillisme a rapidement fait des Lowlands un de ses bastions, Gordon Brown en étant par exemple originaire) ; Connolly y fait notamment ses premières armes avant d’aller fonder l’IRSP en Irlande. Il faut cependant un certain temps pour que, sans jamais en avoir perdu conscience (la conscience nationale ne fut, de toute façon, jamais réellement niée), ce mouvement fusionne avec l’affirmation de la question nationale dans un véritable MLN socialiste (NB : le terme ‘socialiste’ reste dans les pays anglo-saxons très radicalement ‘connoté’, loin de la gestion ‘de gôche’ du capitalisme qu’il peut signifier en Europe ‘latine’). Nous avons ainsi un mouvement républicain socialiste écossais (SRSM), né en 1973, ainsi qu’un Parti socialiste écossais anticapitaliste et indépendantiste (SSP) membre de la Gauche anticapitaliste européenne, proche du NPA, du SWP, de Syriza etc., très influencé par le SRSM qui en est (depuis 1999) un courant, et même un Parti communiste qui a scissionné du PC ‘historique’ de  Grande-Bretagne lorsque celui-ci s’est débandé en ‘gauche démocratique’ à l’italienne (1991), soutient l’indépendance et fait souvent liste commune avec le SSP. L’idée d’un PC d’Écosse autonome est ancienne : John MacLean, socialiste révolutionnaire marxiste, figure de la Red Clydeside (région 'rouge' de Glasgow) dans les années 1910 et parmi les tous premiers membres ‘britanniques’ de la 3e Internationale, la défendit en effet dès 1919-20 face aux ‘unionistes rouges’ du PC de Grande-Bretagne. Il prônait une République indépendante des travailleurs d’Écosse et il est intéressant, au regard des analyses de SLP sur la question, de remarquer qu’il voyait cette République socialiste écossaise comme un rétablissement de la civilisation communautaire clanique médiévale ‘sur une base moderne’, autrement dit à un niveau supérieur [exactement la manière dont SLP voit l'Occitanie socialiste par rapport à l''Andalousie du Nord' arago-catalo-occitane du 12e siècle ; et que disait d'autre Mariátegui lorsqu'il faisait de l'ayllu - communauté agraire - inca, 'à un niveau supérieur', la base du futur socialisme rural au Pérou ?]. Il est une référence du SRSM. Cependant, aucun de ces courants ne suit une réelle stratégie de Guerre populaire pour la libération sociale et nationale : ils se situent clairement sur un terrain légaliste et électoraliste, visant l’indépendance de l’Écosse par une majorité séparatiste au Parlement et un référendum, ensuite de quoi ils formeraient la ‘gauche de transformation sociale’ du nouvel État indépendant… Il y a, enfin, une Armée de Libération nationale (SLNA) qui se dit ‘maoïsante’ et agit militairement – essentiellement – par colis
Grande-Bretagne lorsque celui-ci s’est débandé en ‘gauche démocratique’ à l’italienne (1991), soutient l’indépendance et fait souvent liste commune avec le SSP. L’idée d’un PC d’Écosse autonome est ancienne : John MacLean, socialiste révolutionnaire marxiste, figure de la Red Clydeside (région 'rouge' de Glasgow) dans les années 1910 et parmi les tous premiers membres ‘britanniques’ de la 3e Internationale, la défendit en effet dès 1919-20 face aux ‘unionistes rouges’ du PC de Grande-Bretagne. Il prônait une République indépendante des travailleurs d’Écosse et il est intéressant, au regard des analyses de SLP sur la question, de remarquer qu’il voyait cette République socialiste écossaise comme un rétablissement de la civilisation communautaire clanique médiévale ‘sur une base moderne’, autrement dit à un niveau supérieur [exactement la manière dont SLP voit l'Occitanie socialiste par rapport à l''Andalousie du Nord' arago-catalo-occitane du 12e siècle ; et que disait d'autre Mariátegui lorsqu'il faisait de l'ayllu - communauté agraire - inca, 'à un niveau supérieur', la base du futur socialisme rural au Pérou ?]. Il est une référence du SRSM. Cependant, aucun de ces courants ne suit une réelle stratégie de Guerre populaire pour la libération sociale et nationale : ils se situent clairement sur un terrain légaliste et électoraliste, visant l’indépendance de l’Écosse par une majorité séparatiste au Parlement et un référendum, ensuite de quoi ils formeraient la ‘gauche de transformation sociale’ du nouvel État indépendant… Il y a, enfin, une Armée de Libération nationale (SLNA) qui se dit ‘maoïsante’ et agit militairement – essentiellement – par colis  piégé. Au Pays de Galles un mouvement socialiste-républicain a existé quelques années dans les années 1960-80, signant notamment avec le groupe Cymru Gosh ("Pays de Galles rouge") la Charte de Brest en 1974 ; et aujourd’hui un Great Unrest Group, levant le drapeau rouge de Merthyr Tydfil et le drapeau libérationniste révolutionnaire vert et blanc à l'étoile rouge, milite pour la reconstruction d’un Parti socialiste républicain de Galles ; il est en lien avec le collectif des camarades de Democracy & Class Struggle.
piégé. Au Pays de Galles un mouvement socialiste-républicain a existé quelques années dans les années 1960-80, signant notamment avec le groupe Cymru Gosh ("Pays de Galles rouge") la Charte de Brest en 1974 ; et aujourd’hui un Great Unrest Group, levant le drapeau rouge de Merthyr Tydfil et le drapeau libérationniste révolutionnaire vert et blanc à l'étoile rouge, milite pour la reconstruction d’un Parti socialiste républicain de Galles ; il est en lien avec le collectif des camarades de Democracy & Class Struggle.Il faut bien comprendre que, dans des pays qui n’ont JAMAIS connu que la monarchie (hormis la courte période 1649-60 en Angleterre, mais associée à une politique génocidaire dans les nations celtiques), monarchie entourée d’un véritable culte de masse y compris, depuis les années 1970-80, à travers la fameuse presse tabloids, la mise en avant de la République revêt encore une signification progressiste-radicale et révolutionnaire incontestable, comme dans l’État espagnol d’ailleurs ; à des années-lumière de ce que l’invocation 'républicaine’ peut revêtir de réactionnaire en 'France’. C’est ce qu’expliquait fort bien un camarade de Libération Irlande, dans un entretien avec les camarades de la Cause du Peuple, fin 2010 : « Alors pour résumer, je te dirai que c’est le contraire d’être républicain en France. Ici, ceux qui mettent en avant la république, ce sont les flics et les profs, c’est l’idéologie de l’État bourgeois. En Irlande, c’est une
 idéologie révolutionnaire anti-coloniale, un truc qui vient du peuple, qui cherche la confrontation avec l’État et les institutions. Les républicains sont ceux qui se revendiquent de Wolfe Tone, un protestant de l’époque de la révolution bourgeoise en France, qui a voulu faire pareil en Irlande et chasser le colonialisme anglais, les nobles propriétaires terriens et bien sûr la monarchie. La base de l’idéologie, c’est la démocratie, le pouvoir pour tout le monde, protestants et catholiques et autres. Rien que ça, c’est révolutionnaire là-bas, il y a des aspects très médiévaux en Irlande. Avec le développement de la classe ouvrière au 20e siècle, le républicanisme a évolué, en incorporant les besoins et les exigences de la classe ouvrière. D’ailleurs, l’IRA vient de l’insurrection de 1916 à Dublin, où il y a eu la fusion d’une milice ouvrière et des détachements armés patriotes qui avaient une idéologie nationaliste petite-bourgeoise. Donc les républicains aujourd’hui se disent socialistes, ils se définissent comme un mouvement de libération national ».
idéologie révolutionnaire anti-coloniale, un truc qui vient du peuple, qui cherche la confrontation avec l’État et les institutions. Les républicains sont ceux qui se revendiquent de Wolfe Tone, un protestant de l’époque de la révolution bourgeoise en France, qui a voulu faire pareil en Irlande et chasser le colonialisme anglais, les nobles propriétaires terriens et bien sûr la monarchie. La base de l’idéologie, c’est la démocratie, le pouvoir pour tout le monde, protestants et catholiques et autres. Rien que ça, c’est révolutionnaire là-bas, il y a des aspects très médiévaux en Irlande. Avec le développement de la classe ouvrière au 20e siècle, le républicanisme a évolué, en incorporant les besoins et les exigences de la classe ouvrière. D’ailleurs, l’IRA vient de l’insurrection de 1916 à Dublin, où il y a eu la fusion d’une milice ouvrière et des détachements armés patriotes qui avaient une idéologie nationaliste petite-bourgeoise. Donc les républicains aujourd’hui se disent socialistes, ils se définissent comme un mouvement de libération national ».De son côté, l’Empire britannique, concomitamment avec les ‘accords du Vendredi Saint’, a inauguré le long gouvernement de Tony Blair par les ‘dévolutions’, c’est-à-dire le retour d’institutions autonomes en Écosse (1997) et au Pays de Galles (1999), et l’intégration dans le ‘système UK’ des forces nationalistes bourgeoises (Scottish National Party (SNP), Plaid Cymru etc.). Ces réformes, comme le Vendredi Saint et, dans une vision beaucoup plus large, comme les accords d’Oslo sur la Palestine (1993), la ‘transition’ sud-africaine (1990-95) ou les divers ‘accords’ et ‘réconciliations nationales’ en Amérique latine à la même époque, s’inscrivent dans un vaste contexte de ‘ravalement de façade’ des impérialismes occidentaux, principalement anglo-saxons, consécutivement à leur victoire sur l’URSS révisionniste et à la restauration capitaliste en Chine.
 Tel est le panorama que l’on peut dresser en cette fin d’année 2012. En Angleterre, où la lutte des masses du peuple n’a jamais été à un très haut niveau révolutionnaire depuis le début du 20e siècle, et a de plus – et du coup – subi la dure défaite des ‘années Thatcher’, on observe depuis le début de la décennie un regain de radicalité, avec des mobilisations étudiantes d’une violence jusque là inconnue ; et bien sûr les émeutes prolétariennes d’août 2011, avec pour pointe avancée les colonies intérieures (bien que des personnes de toutes les ‘couleurs’ y aient participé), là encore un ‘tremblement de terre’ qui a fait vaciller l’État britannique sur ses bases qu’il croyait solides. En Irlande, le mouvement de libération nationale et sociale se relève lentement du ‘coup de poignard’ de la trahison provo des années 1990, mais la crise qui ravage l’île au Nord comme au Sud, faisant s’écrouler le mythe du ‘tigre celtique’, apporte de l’eau au moulin des ‘dissidents’, dont l’activité militaire reprend du ‘poil de la bête’. En Écosse et au Pays de Galles, les courants nationalistes bourgeois et petits-bourgeois ont été ‘intégrés’ à la construction ‘Royaume-Uni’ par les ‘dévolutions’ de
Tel est le panorama que l’on peut dresser en cette fin d’année 2012. En Angleterre, où la lutte des masses du peuple n’a jamais été à un très haut niveau révolutionnaire depuis le début du 20e siècle, et a de plus – et du coup – subi la dure défaite des ‘années Thatcher’, on observe depuis le début de la décennie un regain de radicalité, avec des mobilisations étudiantes d’une violence jusque là inconnue ; et bien sûr les émeutes prolétariennes d’août 2011, avec pour pointe avancée les colonies intérieures (bien que des personnes de toutes les ‘couleurs’ y aient participé), là encore un ‘tremblement de terre’ qui a fait vaciller l’État britannique sur ses bases qu’il croyait solides. En Irlande, le mouvement de libération nationale et sociale se relève lentement du ‘coup de poignard’ de la trahison provo des années 1990, mais la crise qui ravage l’île au Nord comme au Sud, faisant s’écrouler le mythe du ‘tigre celtique’, apporte de l’eau au moulin des ‘dissidents’, dont l’activité militaire reprend du ‘poil de la bête’. En Écosse et au Pays de Galles, les courants nationalistes bourgeois et petits-bourgeois ont été ‘intégrés’ à la construction ‘Royaume-Uni’ par les ‘dévolutions’ de  la fin des années 1990, le SNP venant même de remporter les élections dans cette nation constitutive, ouvrant la voie à un possible référendum d'indépendance (ici un article du NPA, pas inintéressant d'un point de vue factuel) ; néanmoins, des courants indépendantistes ‘républicains-socialistes’, ainsi que des groupes marxistes conscients de la question nationale, émergent et se développent.
la fin des années 1990, le SNP venant même de remporter les élections dans cette nation constitutive, ouvrant la voie à un possible référendum d'indépendance (ici un article du NPA, pas inintéressant d'un point de vue factuel) ; néanmoins, des courants indépendantistes ‘républicains-socialistes’, ainsi que des groupes marxistes conscients de la question nationale, émergent et se développent.Quoi qu’il en soit, comme dans tout grand État impérialiste plurinational, le ‘pilote’ du processus révolutionnaire à travers la Guerre populaire est le prolétariat révolutionnaire avec son avant-garde organisée ; et les ‘campagnes’, moteur de la Guerre populaire prolongée, sont les ‘Périphéries’ qui sont, ici, très clairement les nations celtiques opprimées, leurs ‘représentants’ au sein des classes populaires d’Angleterre, et les colonies intérieures de travailleurs issus de l’ex-Empire colonial (qui représentent notamment près de la moitié de la population londonienne).
[1] Un nouveau Reform Act de 1867 l’élargira à 2,25 millions (élargissement concernant uniquement l’Angleterre et le Pays de Galles…), un autre de 1884 (fixant le cens à 10£) à 5,5 millions, inégalement répartis entre les nations (2/3 des Gallois et des Anglais, 3/5 des Écossais, et seulement 1 irlandais sur 2).
[2] Autres passages : « Après que je me suis préoccupé, durant de longues années, de la question irlandaise, j'en suis venu à la conclusion que le coup décisif contre les classes dominantes anglaises (et il sera décisif pour le mouvement ouvrier du monde entier) ne peut pas être porté en Angleterre, mais seulement en Irlande. (…) L'Irlande est la citadelle de l'aristocratie foncière anglaise. L'exploitation de ce pays ne constitue pas seulement l'une des sources principales de sa richesse matérielle, en même temps que sa plus grande force morale. De fait, elle représente la domination de l'Angleterre sur l'Irlande. L'Irlande est donc le grand moyen grâce auquel l'aristocratie anglaise maintient sa domination en Angleterre même. D'autre part, si demain l'armée et la police anglaises se retiraient d'Irlande, nous aurions immédiatement une révolution agraire en Irlande. Le renversement de l'aristocratie anglaise en Irlande aurait pour conséquence nécessaire son renversement en Angleterre, de sorte que nous aurions les conditions préalables à une révolution prolétarienne en Angleterre »
La notion d’encerclement du centre par la périphérie semble ici commencer à être effleurée, mais dans une situation tout de même très particulière, coloniale en Europe même, avec les grandes plantations des landlords, une infime minorité (de l’ordre de 10%) de la population bénéficiant du droit de vote, etc.
Et un autre ‘grand’ argument anticolonial qui sera récurrent dans l’argumentaire marxiste de la première moitié du 20e siècle : « De plus, l'Irlande est le seul prétexte du gouvernement anglais pour entretenir une grande armée permanente qui, en cas de besoin, comme cela s'est vu, est lancée sur les ouvriers anglais, après avoir fait ses études soldatesques en Irlande » (circulaire du CG de l’AIT à la Fédération de Suisse romande, 1er janvier 1870).
[3] La ‘surpopulation’ est une notion bourgeoise, visant à ‘disculper’ le mode de production dominant des catastrophes humaines qu’il entraîne et de la misère en général, et qui n’a aucune existence réelle. Aucun territoire de la planète n’est ‘surpeuplé’ en soi : l’Irlande de 1845 ne comptait qu’un peu plus de 100 habitants au km², ce qui est moins que l’État français métropolitain (territoires européens) aujourd’hui, qui est l'un des moins denses d’Europe. Il n'y a ‘surpopulation’ que par rapport au niveau des forces productives et - surtout - au ‘frein’ à celles-ci que représente un mode de production et une organisation sociale donnée.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Dans la ‘foulée’ de la longue étude menée sur la construction de l’État français moderne puis contemporain (1 – 2 – 3 et 4), SLP propose maintenant de procéder à une étude comparative du processus de construction politico-militaire de deux ou trois autres grands États européens.Ceci nous semble, en effet, d’autant plus important qu’aujourd’hui, la conviction de SLP est qu’avec le niveau d’intégration économique continentale, un mouvement révolutionnaire du prolétariat pourrait difficilement être autre chose que continental, ce qu’il tendait déjà – fortement – à être en 1918-23, à la suite de la Révolution bolchévique ; même si évidemment, la loi marxiste du développement inégal (de la révolution, en l’occurrence) s’appliquera sans aucun doute au processus (avec des régions ‘bases rouges’ et des régions ‘bases noires’, bastions réactionnaires).
Pour commencer ce travail, SLP propose de se pencher sur le cas de l’État espagnol, grand voisin méridional de notre Hexagone. Cela parce que, comme on l’a déjà dit maintes fois ici, celui-ci – deuxième d’Europe occidentale par sa taille, après l’État français – renferme un GRAND NOMBRE (et une grande complexité) de questions nationales ; mais aussi, est celui où la CONSCIENCE PROLÉTARIENNE du problème, et son articulation avec la lutte de classe contre le Capital, est sans doute (en Europe) de loin la plus avancée.
Nous allons donc voir, dans cette perspective, 1°/ comment se sont formées les NATIONS qui peuplent actuellement la péninsule (avec la particularité, pour celle-ci, d’avoir longtemps abrité un puissant État musulman médiéval), 2°/ comment s’est construit l’ÉTAT MODERNE ‘espagnol’ et comment celui-ci a ensuite évolué en État contemporain, et 3°/ comment la lutte du prolétariat, à la tête des masses populaires, contre cet état de fait s’articule avec sa lutte de classe contre l’exploitation capitaliste.
1. LES PROCESSUS DE FORMATION NATIONALEL’Hispania, dont tire son nom l’Espagne, était un ‘joyau’ de l’Empire romain, et la civilisation hispano-romaine fut brillante. Les populations ibériques préromaines furent profondément romanisées (ce sont peut-être les populations non-italiques qui le furent le plus), et aujourd’hui toutes les langues de la péninsule sont des langues latines, à l’exception du basque, qui est sans doute proche de la langue que parlaient les anciens Ibères, et s’est maintenu dans les vallées de l’ouest de la chaîne pyrénéenne (sur une aire beaucoup plus large que celle où il est parlé actuellement).
Puis, comme dans toute l’Europe et la Méditerranée, l’Empire romain s’effondra sous le poids de ses contradictions et des peuples germaniques et est-européens vinrent se fixer dans la péninsule, avec leur organisation sociale gentilice, dont le ‘mariage’ avec l’organisation sociale romaine et l’idéologie chrétienne donnera naissance au système féodal : les Suèves se fixèrent dans le Nord-Ouest (Galice, Asturies, nord du Portugal actuels), les Alains dans le centre-sud, les Vandales dans l’extrême-sud auquel ils donneront son nom d’Andalousie [carte] (Vandalusia, mais les arabo-imazighen feront ‘tomber’ le ‘V’ pour dire Andalus) ; puis (à partir de 418) Alains et Vandales sont dégagés par les Wisigoths (ils partent en Afrique du Nord), les Suèves se maintenant dans le Nord-Ouest tandis que le Nord repasse aux mains des populations ‘originelles’ vasconnes (basques) et cantabres [carte].
L’extrême-sud sera momentanément conquis par l’Empire byzantin (554-624). Ces populations cohabitent et, au fil des générations, fusionnent avec le ‘substrat’ hispano-romain (en tout cas, sa classe possédante). Et la période n’est pas (encore une fois, contrairement au mythe des ‘invasions barbares’ construit par les bourgeois des 18e-19e siècles, qui se vivaient en ‘nouveaux romains’) un ‘âge des ténèbres’ : le royaume des Wisigoths (qui perd en l’an 507 ses possessions au nord des Pyrénées, sauf la ‘Septimanie’ – côte languedocienne) est au contraire un très important ‘conservatoire’ de l’héritage civilisationnel antique ; rôle qui sera ensuite repris… par les ‘Maures’, coalition d’Arabes et d’Imazighen (‘berbères’) musulmans qui
 débarquent en 711 dans l’extrême-sud, conduits par l’émir Tariq ibn Zyad. Car là est la dernière – et fondamentale – invasion de la péninsule, déterminante, indissociable des processus de formation nationale ET étatique, tant par la civilisation (la plus brillante de l’époque en Europe et Méditerranée occidentale) qu’elle installera pour plusieurs siècles, transmettant aux langues locales (le castillan, surtout) un nombre considérables de mots et de phonèmes qui leur sont propres, que par le processus de reconquête catholique contre elle, qui se déroulera, du Nord vers le Sud, pendant plus de 7 siècles.
débarquent en 711 dans l’extrême-sud, conduits par l’émir Tariq ibn Zyad. Car là est la dernière – et fondamentale – invasion de la péninsule, déterminante, indissociable des processus de formation nationale ET étatique, tant par la civilisation (la plus brillante de l’époque en Europe et Méditerranée occidentale) qu’elle installera pour plusieurs siècles, transmettant aux langues locales (le castillan, surtout) un nombre considérables de mots et de phonèmes qui leur sont propres, que par le processus de reconquête catholique contre elle, qui se déroulera, du Nord vers le Sud, pendant plus de 7 siècles.Il faut bien comprendre ce processus. Lorsque les arabo-imazighen conquirent la péninsule, à la faveur des contradictions entre noblesse wisigothe catholique et noblesse wishigothe arienne (celle-ci se ralliant alors massivement à l’islam), ils se désintéressèrent des régions peu propices à leur agriculture ‘traditionnelle’ (méditerranéenne), c'est-à-dire les régions pyrénéennes (Navarre/Euskadi, Ribagorza et Aragon, Haute-Catalogne) et de la côte nord-atlantique (Cantabrie, Asturies, Galice), où le ‘parti catholique’ wisigoth et hispano-romain se réfugia. Ce dernier y amena (ou y renforça) vraisemblablement la langue latine hispano-romane (encore, sans doute, peu différenciée), car il est probable que ces régions, peu romanisées sous l’Empire (toujours à cause de leur climat), parlaient encore des langues celtiques, ibériques ou celtibériques, comme dans l’ouest des Pyrénées où s’est maintenu l’euskara.
C’est de ces territoires que fut lancée, dès le 8e siècle, la Reconquista : à la fin du 10e siècle, tous les territoires (sommairement) au nord du Douro et de l’Èbre sont ‘reconquis’ ; au milieu du 12e, tous les territoires au nord du Tage, des monts Ibériques et du delta de l’Èbre ; et en l’an 1300 ne restent plus que le sud et l’est de l’Andalousie actuelle (l’émirat de Grenade, jusqu’en 1492).
Et c’est au cours de ce processus que se sont forgées les nations ibériques actuelles :
- au Nord, les nations ‘point de départ’ de la ‘reconquête’ : Pays Basque (royaume de Navarre), Cantabrie, Asturies, Galice. C'est ce royaume des Asturies (8e-10e siècles) qui deviendra en 910 le royaume de León, qui fusionnera lui-même avec la Castille (petit comté devenant dès lors royaume) de 1037 à 1065, puis de 1072 à 1165 et définitivement en 1230. Il est dès lors considéré comme le ‘berceau’ de l’État et de la monarchie actuelle et traditionnellement (depuis 1388), l'héritier de la Couronne castillane puis ‘espagnole’ porte le titre de prince des Asturies (équivalent du prince de Galles outre-Manche ou du dauphin dans l'ancienne monarchie française).
- à partir des vallées pyrénéennes centrales et orientales, en ‘déroulant’ vers le sud : nation aragonaise et nation catalane ; leurs ‘branches’ méridionales (Pays valencien, régions de l'Èbre domaine des Banū Qāsī, Baléares) se distinguant par une arabité plus tardive, jusqu’au milieu du 12e voire parfois du 13e siècle. Cette arabité plus tardive, que l'on trouve aussi au sud de la Navarre basque (région de Tudela ‘reconquise’ vers 1120), a engendré un net particularisme culturel vis-à-vis des terres pyrénéennes (largement ‘reconquises’ en l’An 1000) ; particularisme parfois difficile à appréhender pour une affirmation basque, aragonaise ou catalane trop ‘étroite’ et retranchée dans ses vallées. On peut éventuellement qualifier de mudéjars (de l'arabe mudajjan, مدجّن, ‘domestiqué’) ces territoires ‘reconquis’ à cette étape intermédiaire du processus (11e et 12e siècles), comme les régions de l'Èbre mais aussi le plateau (Meseta) castillan-léonais (voir ci-dessous), par distinction avec les terres mozarabes plus au sud. Entre (sommairement) le milieu du 11e siècle et le milieu du 13e, les nations aragonaise et catalane (réunies en 1137 en un même royaume) ont également la particularité d’avoir connu une brillante symbiose avec la civilisation occitane (au nord des Pyrénées) : les comtes de Barcelone, puis la Couronne d’Aragon, sont en effet maîtres de la Provence, du Gévaudan (Lozère) et de Millau, des Comminges, de Foix et de Carcassonne, et sont des alliés et exercent une influence certaine sur les comtes de Toulouse et leurs vassaux (qui tiennent le reste de l’Occitanie centrale et provençale). C’est une coalition Aragon-Toulouse-Foix-Comminges, commandée par le roi d’Aragon, qui est écrasée à Muret en 1213 par Simon de Montfort, amenant l’annexion ‘française’ de l’Occitanie centrale (un peu plus tard, la
 Provence sera retirée à l’Aragon-Catalogne et donnée au frère de ‘saint’ Louis, début de l’annexion française de la région). Aujourd’hui, l’occitan et le catalan sont des langues sœurs, quasi-jumelles, et l’aragonais est largement compréhensible pour un Occitan ou un Catalan.
Provence sera retirée à l’Aragon-Catalogne et donnée au frère de ‘saint’ Louis, début de l’annexion française de la région). Aujourd’hui, l’occitan et le catalan sont des langues sœurs, quasi-jumelles, et l’aragonais est largement compréhensible pour un Occitan ou un Catalan. - depuis les territoires au sud de la chaîne cantabrique, peu arabisés et rapidement reconquis (9e-10e siècles) par la Galice, les Asturies et la Cantabrie, en ‘déroulant’ là encore vers le sud : nation portugaise (à partir de la région de Porto-Braga-Bragance, atteignant l’Algarve en 1249, on peut considérer qu’il y a deux ‘branches’ à cette nation, au nord et au sud du Tage) ; nation léonaise (autour de la ville de León, dont les rois asturiens font leur capitale en 914, et jusqu’à Salamanque à la fin du 11e siècle) ; et bien sûr la nation castillane, qui démarre d’un petit comté autour de Burgos au 10e siècle, atteint la chaîne centrale vers l’An 1000, puis Tolède en 1085 et finalement la Sierra Morena à la fin du 12e siècle (on distingue Vieille-Castille au nord de la chaîne centrale et Nouvelle-Castille au sud).
- tout au Sud, les nations mozarabes (de musta’rib, مستعرب, qui signifie ‘arabisé’), d’arabisation profonde et tardive, ‘reconquises’ pour l'essentiel au 13e siècle après Navas de Tolosa, l’extrême-sud (émirat de Grenade) résistant même jusqu’en 1492 et la population morisque jusqu’au 17e siècle : Andalousie, Murcie, Estrémadure (celle-ci ayant été partiellement 'reconquise' par le León, on y trouve une 'poche' de langue asturléonaise dans la partie nord), dans une certaine mesure la Mancha (sud de la Nouvelle-Castille). On peut aussi qualifier de la sorte le sud du Pays valencien ou les îles Baléares (nation catalane), de ‘reconquête’ très tardive (13e voire début du 14e siècle) et marqués comme on l'a dit par un fort particularisme vis-à-vis de la Vieille Catalogne pyrénéenne. Cette partie de la péninsule (ainsi que la Catalogne) abrite également l'essentiel de la communauté gitane (Gitanos), population rrom originaire de l'Inde et arrivée au début du 15e siècle. C'est la plus importante communauté en Europe de l'Ouest, avec de l'ordre de 600.000 à 800.000 personnes ; et elle a énormément contribué à forger la culture nationale andalouse (mais n'en est pas moins en bute à un très fort racisme, bien qu'ayant obtenu un statut de "minorité nationale").
- enfin, loin de la péninsule, au large du Sahara occidental, les îles Canaries : de population amazighe guanche et connues des navigateurs de l’Antiquité, elles sont ‘redécouvertes’ au 14e siècle et colonisées à partir du 15e. C’est la nation canarienne.
[Voir ici l'évolution nationale-linguistique de la Péninsule, de l'An 1000 à nos jours]
Telles sont les nations qui habitent encore, à ce jour, la péninsule ibérique, c'est-à-dire l’État dénommé ‘Espagne’ et le Portugal.
2. LA CONSTRUCTION POLITICO-MILITAIRE ÉTATIQUELa ligne directrice dominante de ce processus est la Reconquista menée par les royaumes chrétiens contre le ou les royaume(s) musulmans ‘maures’. Ce qui, bien entendu, n’empêche nullement les royaumes chrétiens de se battre entre eux (ou de connaître des guerres civiles), tout comme les musulmans de leur côté (épisodes dit de taïfa, 1031-1085/1112, 1145-1163/1203 et
 1224-1266). Mais globalement, les fusions politiques féodales qui déboucheront sur le royaume d’Espagne se feront plutôt pacifiquement (par mariage, en général), comme s’il y avait une ‘solidarité post-wisigothe’ des familles régnantes, contrairement à la ‘France’ où c’est par le fer que les Capétiens constitueront leur domaine.
1224-1266). Mais globalement, les fusions politiques féodales qui déboucheront sur le royaume d’Espagne se feront plutôt pacifiquement (par mariage, en général), comme s’il y avait une ‘solidarité post-wisigothe’ des familles régnantes, contrairement à la ‘France’ où c’est par le fer que les Capétiens constitueront leur domaine.Le royaume de León, héritier du royaume des Asturies qui fixe en 914 sa capitale dans cette cité reconquise, comprend en l’An 1000 les actuelles Asturies et Galice, et le Pays léonais (provinces de León, Zamora et Salamanca). En 1037, il fusionne avec un ancien petit comté établi autour de Burgos (comprenant aussi la Cantabrie), qui s’est étendu vers le sud jusqu’au Douro et s’est érigé en royaume : la Castille. Cette unité se fera et défera à plusieurs reprises par la suite, mais deviendra définitive en 1230. C’est cette entité (surtout dans ses périodes d’unité, évidemment) qui réalisera le ‘gros’ de la Reconquista, depuis le Douro jusqu’au détroit de Gibraltar, ‘achevant’ l’Espagne musulmane en prenant Grenade en 1492 (et par la suite, c’est à elle que seront ‘juridiquement’ rattachées les ‘découvertes’ d’outre-mer, en particulier les Amériques). Sa composante dominante est le León jusqu’au milieu du 12e siècle, puis devient progressivement la Castille : c’est la langue castillane (et non le léonais) qui sera imposée aux territoires ‘reconquis’ vers le Sud - ‘Nouvelle-Castille’, Estrémadure (rattachée toutefois ‘juridiquement’ au León), Andalousie et Murcie.
Au Nord-Est, c’est en 1137 que le comté devenu royaume (1035) d’Aragon fusionne, par mariage de l’héritière du trône, avec le comté de Barcelone. De pair, ils conquerront sur les ‘Maures’ la région valencienne (qui deviendra ‘royaume de Valence’, subsistant juridiquement… jusqu’au 18e siècle) et les Baléares (érigées en ‘royaume de Majorque’ autonome, parfois en conflit avec la Couronne aragonaise, de 1229 à 1349 ; il subsistera lui aussi ‘sur le papier’ jusqu’en 1716). Ils se ‘partagent les tâches’ : l’Aragon tient l’appareil politico-militaire tandis que la Catalogne (avec ses États généraux, les Corts, et son ‘gouvernement général’, la Generalitat) assure le rayonnement économique et culturel de l’entité sur toute la Méditerranée occidentale : jusqu’à la conquête capétienne du 13e siècle, le royaume domine d'ailleurs (politiquement, économiquement et culturellement) l’Occitanie centrale et provençale ; puis à partir de la fin du 13e siècle c’est l’Empire arago-catalan qui comprend, outre l’Aragon, la Catalogne, Valence et les Baléares, la Sardaigne, l’Italie du Sud et la Sicile (territoires qu’il apportera à l’Espagne unifiée).
 En 1479, par le mariage d’Isabelle Ière de Castille et Ferdinand II d’Aragon, les deux couronnes sont réunies, et achèvent ensemble la Reconquista par la conquête de l’émirat de Grenade : C’EST LA NAISSANCE DU ROYAUME D’ESPAGNE COMME ÉTAT MODERNE.
En 1479, par le mariage d’Isabelle Ière de Castille et Ferdinand II d’Aragon, les deux couronnes sont réunies, et achèvent ensemble la Reconquista par la conquête de l’émirat de Grenade : C’EST LA NAISSANCE DU ROYAUME D’ESPAGNE COMME ÉTAT MODERNE.Au final c’est seulement le royaume de Navarre (pourtant l'un des principaux initiateurs de la Reconquista), centré sur la nation basque et qui dans le premier tiers du 11e siècle (Sanche III le Fort) s’étendait outre l’Euskal Herria sur le Haut-Aragon, la Rioja, la Cantabrie et le comté de Castille (région de Burgos), qui sera l’objet d’un grignotage de plusieurs siècles aussi bien par le Nord (Aquitaine, puis Anglais et Capétiens) que par le Sud (Aragon et Castille) avant de disparaître en 1512, annexé par le royaume 'espagnol’ de ‘Castille et Aragon’. Une unique province basque du Nord, la Basse-Navarre, conservera alors le ‘souvenir’ du royaume sous la maison d’Albret ; son dernier roi, Henri III de Navarre (1572), deviendra… ‘roi de France et de Navarre’ en 1589 sous le nom d’Henri IV.
 Concomitamment à tout cela va survenir en 1492 un évènement historique d’une importance sans précédent, qui va bouleverser l’histoire de l’humanité : la ‘découverte’ par le capitaine génois Christophe Colomb (au service de Ferdinand et Isabelle), la conquête et la colonisation des AMÉRIQUES. Le royaume castillo-aragonais avait commencé, comme son voisin portugais, à se lancer dans la navigation lointaine (explorant les côtes de l’Afrique jusqu’au Sénégal, ‘redécouvrant’ les Canaries au 14e siècle etc.). À cette époque, la ‘première puissance mondiale’ apparaissait comme étant l’Empire ottoman, qui avait pris Constantinople en 1453 et rétabli à son profit le Califat islamique. Mais celui-ci, ‘paradoxalement’, va ainsi se tirer ‘une balle dans le pied’ : en coupant la route terrestre vers l’Inde et la Chine (la fameuse route de la soie), il va pousser les Européens, et notamment ceux de la péninsule ibérique, à rechercher une route maritime vers celles-ci. Les Portugais cherchent le contournement de l’Afrique par le sud et en 1488 Bartolomeu Dias franchit la pointe australe extrême de celle-ci, le cap de Bonne Espérance. Les ‘Espagnols’, eux, ont une autre idée : ‘couper droit’ vers l’Ouest et logiquement, puisque la Terre est ronde, atteindre en quelques semaines ou quelques mois... les Indes ou la Chine. C’est ainsi qu’est ‘découvert’ le ‘Nouveau Monde’ (auparavant des Scandinaves, des Celtes et des Basques en avaient déjà touché les côtes du Nord-Est, mais n’y avaient pas fait souche), dont il faudra plusieurs années encore pour réaliser qu’il s’agit là d’un nouveau continent inconnu et non de l’Extrême-Orient. Un évènement aussi important pour l’humanité, à l’époque, que si l’on découvrait aujourd’hui une nouvelle planète habitée ; et qui lancera réellement (à travers la colonisation et l’exploitation de ce continent) ce que les marxistes appellent classiquement ‘l’accumulation primitive’ du Capital : en réalité, le ‘boom’ économique du capitalisme (qui existait déjà depuis trois ou quatre siècles), qui le fera balayer les dernières scories féodales et débouchera sur les révolutions bourgeoises et la révolution industrielle.
Concomitamment à tout cela va survenir en 1492 un évènement historique d’une importance sans précédent, qui va bouleverser l’histoire de l’humanité : la ‘découverte’ par le capitaine génois Christophe Colomb (au service de Ferdinand et Isabelle), la conquête et la colonisation des AMÉRIQUES. Le royaume castillo-aragonais avait commencé, comme son voisin portugais, à se lancer dans la navigation lointaine (explorant les côtes de l’Afrique jusqu’au Sénégal, ‘redécouvrant’ les Canaries au 14e siècle etc.). À cette époque, la ‘première puissance mondiale’ apparaissait comme étant l’Empire ottoman, qui avait pris Constantinople en 1453 et rétabli à son profit le Califat islamique. Mais celui-ci, ‘paradoxalement’, va ainsi se tirer ‘une balle dans le pied’ : en coupant la route terrestre vers l’Inde et la Chine (la fameuse route de la soie), il va pousser les Européens, et notamment ceux de la péninsule ibérique, à rechercher une route maritime vers celles-ci. Les Portugais cherchent le contournement de l’Afrique par le sud et en 1488 Bartolomeu Dias franchit la pointe australe extrême de celle-ci, le cap de Bonne Espérance. Les ‘Espagnols’, eux, ont une autre idée : ‘couper droit’ vers l’Ouest et logiquement, puisque la Terre est ronde, atteindre en quelques semaines ou quelques mois... les Indes ou la Chine. C’est ainsi qu’est ‘découvert’ le ‘Nouveau Monde’ (auparavant des Scandinaves, des Celtes et des Basques en avaient déjà touché les côtes du Nord-Est, mais n’y avaient pas fait souche), dont il faudra plusieurs années encore pour réaliser qu’il s’agit là d’un nouveau continent inconnu et non de l’Extrême-Orient. Un évènement aussi important pour l’humanité, à l’époque, que si l’on découvrait aujourd’hui une nouvelle planète habitée ; et qui lancera réellement (à travers la colonisation et l’exploitation de ce continent) ce que les marxistes appellent classiquement ‘l’accumulation primitive’ du Capital : en réalité, le ‘boom’ économique du capitalisme (qui existait déjà depuis trois ou quatre siècles), qui le fera balayer les dernières scories féodales et débouchera sur les révolutions bourgeoises et la révolution industrielle. La conquête et la colonisation des Amériques (pratiquement achevée au milieu du 16e siècle) va être, la Reconquista terminée, le formidable ciment de cette construction politique plurinationale que l’on nomme désormais ‘Espagne’. Une pluri-nationalité qui est d’ailleurs, à l’époque, totalement reconnue : Charles Quint, qui hérite du trône en 1516, s’il y met peu les pieds (héritier des Habsbourg d’Autriche et de l’Empire bourguignon, il vit surtout à Gand, en Belgique actuelle), dira ainsi de l’Espagne qu’elle est ‘un ensemble de peuples, réunis pour l’accomplissement de destinées universelles’. L’Hispanité devient alors le grand mythe fondateur de l’État, sa principale ‘idéologie-ciment’, dont Franco (centralisateur espagnoliste autoritaire) usera encore dans les grandes largeurs au siècle dernier ; et encore aujourd’hui, la fête ‘nationale’ est le 12 octobre, jour de la ‘découverte’ des Amériques par Colomb.
La conquête et la colonisation des Amériques (pratiquement achevée au milieu du 16e siècle) va être, la Reconquista terminée, le formidable ciment de cette construction politique plurinationale que l’on nomme désormais ‘Espagne’. Une pluri-nationalité qui est d’ailleurs, à l’époque, totalement reconnue : Charles Quint, qui hérite du trône en 1516, s’il y met peu les pieds (héritier des Habsbourg d’Autriche et de l’Empire bourguignon, il vit surtout à Gand, en Belgique actuelle), dira ainsi de l’Espagne qu’elle est ‘un ensemble de peuples, réunis pour l’accomplissement de destinées universelles’. L’Hispanité devient alors le grand mythe fondateur de l’État, sa principale ‘idéologie-ciment’, dont Franco (centralisateur espagnoliste autoritaire) usera encore dans les grandes largeurs au siècle dernier ; et encore aujourd’hui, la fête ‘nationale’ est le 12 octobre, jour de la ‘découverte’ des Amériques par Colomb. Le jeune royaume est alors la première puissance planétaire de l’histoire, c’est le ‘Siècle d’Or’ de ‘l’Empire sur lequel le Soleil ne se couche jamais’. À la mort de Charles Quint, son fils Philippe II récupère l’héritage ‘espagnol’ (ainsi que le Portugal, pays de sa mère, annexé en 1580) et bourguignon (Pays-Bas, Franche-Comté), tandis que son frère Ferdinand, déjà archiduc d’Autriche, récupère l’héritage germanique (la couronne du Saint-Empire).
Le jeune royaume est alors la première puissance planétaire de l’histoire, c’est le ‘Siècle d’Or’ de ‘l’Empire sur lequel le Soleil ne se couche jamais’. À la mort de Charles Quint, son fils Philippe II récupère l’héritage ‘espagnol’ (ainsi que le Portugal, pays de sa mère, annexé en 1580) et bourguignon (Pays-Bas, Franche-Comté), tandis que son frère Ferdinand, déjà archiduc d’Autriche, récupère l’héritage germanique (la couronne du Saint-Empire).Mais ce ‘Siècle d’Or’ ne durera pas : on le considère, généralement, comme achevé en 1648, avec les grands traités européens de Westphalie qui mettent fin à la Guerre de Trente Ans. Les raisons matérialistes en sont connues : l’‘Espagne’ a découvert les Amériques par hasard, ‘sur un coup de bol’ ; mais elle a appliqué à ces immenses territoires une colonisation de pillage à courte vue, ne cherchant pas une véritable mise en valeur comme ce qu’ont pu faire les colons anglais ou hollandais (et, dans une moindre mesure, ‘français’) en Amérique du Nord, aux Caraïbes et en Asie. Elle n’en a pas profité, non plus, pour DÉVELOPPER une métropole qui était, à la fin du 15e siècle, très arriérée d’un point de vue capitaliste (sauf les terres catalanes) ; ceci d’autant plus que Charles Quint, flamand de cœur, fera surtout bénéficier les ‘Pays-Bas’ (actuel Bénélux), déjà - eux - très développés, des richesses ainsi accumulées. Par l'achat de toutes sortes de fournitures et la contraction de dettes, c'est en réalité du Nord de l'Europe (dont la
 France) qu'elle fera la destination finale de ces gigantesques masses d'or et d'argent extraites (par des esclaves indigènes mourant par milliers) des mines coloniales comme celles de Potosí (Haut-Pérou, actuelle Bolivie) ; masses de liquidités qui jetteront dans ces pays les bases du développement industriel, au point que Colbert pourra dire que "plus un pays fait commerce avec l'Espagne, plus il est prospère"...
France) qu'elle fera la destination finale de ces gigantesques masses d'or et d'argent extraites (par des esclaves indigènes mourant par milliers) des mines coloniales comme celles de Potosí (Haut-Pérou, actuelle Bolivie) ; masses de liquidités qui jetteront dans ces pays les bases du développement industriel, au point que Colbert pourra dire que "plus un pays fait commerce avec l'Espagne, plus il est prospère"...Au nom du catholicisme, autre ‘ciment idéologique’ essentiel de la monarchie, on expulse et massacre les Juifs (1492), les musulmans, puis les ‘marranes’ et les ‘morisques’ (Juifs et musulmans convertis de force, mais continuant à pratiquer secrètement leur religion), et l'on écrase dans l’œuf la Réforme protestante : bref, toutes les forces porteuses d’un esprit capitaliste un peu avancé.
C’est donc, du point de vue du développement capitaliste, un pays extrêmement arriéré qui règne sur le premier empire colonial au monde (auquel s’adjoint en 1580 l’Empire portugais, immense lui aussi).
L’Empire 'espagnol’ recule inexorablement en Europe. Le Portugal, royaume indépendant (et uni-national) depuis le 12e siècle, résiste à la domination castillane : il reconquiert son indépendance en 1640. Aux Pays-Bas, les provinces du Nord (les Pays-Bas actuels, ou ‘Hollande’) se soulèvent dans une révolution bourgeoise (et aristocrate-moderniste) sous le drapeau de la Réforme calviniste : dès 1580, elles sont indépendantes de fait (‘République des Provinces-Unies’), bien que cette
 indépendance (comme celle du Portugal) ne soit officiellement ‘sanctionnée’ qu’au traité de Münster, en 1648.
indépendance (comme celle du Portugal) ne soit officiellement ‘sanctionnée’ qu’au traité de Münster, en 1648.Surtout, au terme de ce "Siècle d'Or" que l'on peut considérer révolu au milieu du 17e siècle, la Castille qui a achevé la "Reconquista", unifié politiquement la péninsule et "découvert" les Amériques n'a pas su mettre à profit cet imperium mundi pour s'ériger en PUISSANCE ÉCONOMIQUE, en véritable CENTRE DIRIGEANT de la production capitaliste ibérique. Les territoires/nations plus avancés au départ (Pays catalans) et ceux qui bientôt (Pays Basque, côte nord-atlantique) "boomeront" en lien avec les deux grandes puissances économiques européennes de l'époque ("France" et Angleterre) vont alors définitivement lui damer le pion. C'est là une donnée fondamentale pour comprendre tout le reste.
Les possessions sont également grignotées par la ‘France’ (actuel Nord-Pas-de-Calais, Franche-Comté, Roussillon) ; puis, lorsque le petit-fils de Louis XIV (héritier par sa grand-mère du trône ‘espagnol’) devient roi sous le nom de Philippe V de Bourbon, par la coalition anti-française de la Guerre de Succession d’Espagne (1701-14) : au traité d’Utrecht qui y met fin, les ‘Pays-Bas’ (Belgique), Naples et la Sicile passent à l’Autriche (les deux derniers seront récupérés en 1738, mais la perte des Pays-Bas est le ‘coup de grâce’), et la Sardaigne au Piémont-Savoie (qui devient l’État le plus puissant d’Italie du Nord, et réalisera l’Unité italienne au siècle suivant).
Cette Guerre de Succession, et le changement dynastique qui en est à l’origine, marquent un véritable tournant dans l’histoire de l’État espagnol : c'est la naissance de deux phénomènes structurels pour cet État jusqu’aujourd’hui.
 D’abord, la montée sur le trône d’un petit-fils de Louis XIV scelle une alliance de sang indéfectible du royaume ibérique avec l’État moderne français, ‘ennemi héréditaire’ encore quelques décennies auparavant. Mais une alliance qui, de par le développement inégal des forces productives et la supériorité de celles-ci en ‘France’, fait que la monarchie espagnole devient en réalité la vassale de sa cousine française. Son Empire colonial devient un ‘relais’ de l’Empire français ; ainsi, lorsque la France perd la Guerre de Sept Ans (1756-63) face à l’Angleterre, elle perd la quasi-totalité de son ‘bel’ Empire colonial, mais la Louisiane est simplement ‘transférée’ à l’Espagne : une ‘sanction’ qui n’en est pas une, la Louisiane reste française de facto. Cette situation perdure après la Révolution bourgeoise en ‘France’, et même à l’époque impérialiste des monopoles : c’est ainsi que Paul Lafargue, gendre de Marx et introducteur du marxisme en ‘France’, est né en 1842 à Cuba (alors colonie 'espagnole'), d’un couple de ‘français’ (bordelais) qui y étaient installés ; que le Maroc sera tranquillement ‘partagé’ entre les deux pays dans les années 1900 (et la ‘France’, avec Pétain, viendra en 1925 prêter main forte à son malheureux vassal, malmené par les Berbères du Rif) ; ou encore que la Guinée équatoriale (colonie espagnole) sera toujours de fait un ‘appendice’ du Gabon, et fait aujourd’hui totalement partie de la Françafrique (avec le franc CFA etc.). De même, si l’on compare sur ces trois siècles, jusqu’à la fin du 20e, l’évolution politique de l’État espagnol et de son grand voisin du Nord, les parallèles sont saisissants. Même sous la Révolution bourgeoise hexagonale, l’Espagne, qui reste une monarchie absolue, n’est en guerre contre la ‘France’ révolutionnaire que deux ans (1793-95 sous la Convention et la Terreur, après l’exécution de Louis XVI) ; elle redevient ensuite son alliée. Et malgré l’aide décisive que lui aura apporté Hitler, et les supplications de ce dernier, Franco restera neutre en 1940 et refusera catégoriquement d’entrer en guerre contre la ‘France’ (en avançant volontairement des revendications territoriales inacceptables pour les nazis, qui devaient aussi ménager Vichy).
D’abord, la montée sur le trône d’un petit-fils de Louis XIV scelle une alliance de sang indéfectible du royaume ibérique avec l’État moderne français, ‘ennemi héréditaire’ encore quelques décennies auparavant. Mais une alliance qui, de par le développement inégal des forces productives et la supériorité de celles-ci en ‘France’, fait que la monarchie espagnole devient en réalité la vassale de sa cousine française. Son Empire colonial devient un ‘relais’ de l’Empire français ; ainsi, lorsque la France perd la Guerre de Sept Ans (1756-63) face à l’Angleterre, elle perd la quasi-totalité de son ‘bel’ Empire colonial, mais la Louisiane est simplement ‘transférée’ à l’Espagne : une ‘sanction’ qui n’en est pas une, la Louisiane reste française de facto. Cette situation perdure après la Révolution bourgeoise en ‘France’, et même à l’époque impérialiste des monopoles : c’est ainsi que Paul Lafargue, gendre de Marx et introducteur du marxisme en ‘France’, est né en 1842 à Cuba (alors colonie 'espagnole'), d’un couple de ‘français’ (bordelais) qui y étaient installés ; que le Maroc sera tranquillement ‘partagé’ entre les deux pays dans les années 1900 (et la ‘France’, avec Pétain, viendra en 1925 prêter main forte à son malheureux vassal, malmené par les Berbères du Rif) ; ou encore que la Guinée équatoriale (colonie espagnole) sera toujours de fait un ‘appendice’ du Gabon, et fait aujourd’hui totalement partie de la Françafrique (avec le franc CFA etc.). De même, si l’on compare sur ces trois siècles, jusqu’à la fin du 20e, l’évolution politique de l’État espagnol et de son grand voisin du Nord, les parallèles sont saisissants. Même sous la Révolution bourgeoise hexagonale, l’Espagne, qui reste une monarchie absolue, n’est en guerre contre la ‘France’ révolutionnaire que deux ans (1793-95 sous la Convention et la Terreur, après l’exécution de Louis XVI) ; elle redevient ensuite son alliée. Et malgré l’aide décisive que lui aura apporté Hitler, et les supplications de ce dernier, Franco restera neutre en 1940 et refusera catégoriquement d’entrer en guerre contre la ‘France’ (en avançant volontairement des revendications territoriales inacceptables pour les nazis, qui devaient aussi ménager Vichy).Le Portugal, au demeurant, connaîtra après le traité d’Utrecht la même situation, mais vis-à-vis de l’Angleterre, comme l’expose bien Lénine dans L’Impérialisme.
 Ensuite, c’est juste à la sortie de la Guerre de Succession (et alors qu’une grande partie des aristocraties et des bourgeoisies des différentes nations, en particulier en Aragon et Catalogne, avaient soutenu le prétendant habsbourgeois au trône), que suivant le ‘modèle’ de ses cousins d’outre-Pyrénées, Philippe V de Bourbon va mener une politique de centralisation autoritaire à travers les Décrets de Nueva Planta (‘nouvelle base’, 1707-16).
Ensuite, c’est juste à la sortie de la Guerre de Succession (et alors qu’une grande partie des aristocraties et des bourgeoisies des différentes nations, en particulier en Aragon et Catalogne, avaient soutenu le prétendant habsbourgeois au trône), que suivant le ‘modèle’ de ses cousins d’outre-Pyrénées, Philippe V de Bourbon va mener une politique de centralisation autoritaire à travers les Décrets de Nueva Planta (‘nouvelle base’, 1707-16).Jusque là, en effet, s’il y avait bien un royaume d’Espagne ou ‘des Espagnes’ (on employait généralement le pluriel), la Castille, le León, l’Aragon et la Catalogne, ainsi que la Navarre et les provinces vascongadas (basques) continuaient à former des entités juridiques distinctes, avec leurs Cortes (Generalitat en Catalogne) et leurs gouvernements distincts, leurs lois et coutumes propres (fueros) etc. ; de même que continuaient à exister sur le papier un ‘royaume de Valence’, un ‘royaume de Majorque’, une 'principauté des Asturies' etc. etc., voire même, en Andalus 're'-conquise, un ‘royaume de Grenade’ (présent sur le blason de la monarchie, encore aujourd’hui sur l’écusson du drapeau ‘espagnol’), un ‘royaume de Murcie’ ou encore ‘de Séville’. On parlait, pour désigner ce système, de polysynodie [voir ici une carte des différents royaumes et principautés].
Il y avait ‘les Espagnes’, unies par leur souverain commun, la défense du catholicisme et leurs ‘destinées universelles’ outre-mer ; mais selon les mots d'un jésuite du 17e siècle (Baltasar Gracián), "dans la Monarchie d'Espagne, où les provinces sont multitude, les nations différentes, les langues variées, les inclinations opposées et les climats contrastés, il est nécessaire une grande capacité pour la conserver, et d'autant plus pour l'unir". D'ailleurs, à cette époque, les seules véritables contestations de l'autorité centrale étaient la résistance anticoloniale (morisque) en Andalousie et la révolte des communes... de Castille (comuneros) contre Charles Quint, souverain germano-flamand qui tendait à ne régner que par et pour l'Allemagne et la Flandre. Nada en Catalogne (sinon le bref mouvement des Germanías à Valence et
 dans les Baléares), ni au Pays Basque... Les 'problèmes' ne commencent que vers 1640 (première politique centraliste du comte-duc d'Olivares) avec la sécession du Portugal et, quelques années durant (1640-52), de la Catalogne qui proclame la 'république' (au sens de l'époque : sa constitution en nation souveraine) avec Pau Claris et s'allie à Louis XIII (proclamé 'comte de Barcelone') [des soulèvements séparatistes similaires éclateront également à la même époque en Andalousie (ici en castillan), en Navarre et en Aragon ainsi que dans la lointaine possession italienne de Naples].
dans les Baléares), ni au Pays Basque... Les 'problèmes' ne commencent que vers 1640 (première politique centraliste du comte-duc d'Olivares) avec la sécession du Portugal et, quelques années durant (1640-52), de la Catalogne qui proclame la 'république' (au sens de l'époque : sa constitution en nation souveraine) avec Pau Claris et s'allie à Louis XIII (proclamé 'comte de Barcelone') [des soulèvements séparatistes similaires éclateront également à la même époque en Andalousie (ici en castillan), en Navarre et en Aragon ainsi que dans la lointaine possession italienne de Naples]. La Generalitat récidivera pendant la Guerre de Succession, soutenant le prétendant habsbourgeois et ouvrant ses ports aux coalisés ; ce qui lui vaudra justement (avec toute l'ancienne Couronne d'Aragon) le terrible châtiment des Bourbons victorieux.
Tout cela cesse d’exister avec la Nueva Planta ; sauf en Navarre et dans les ‘Vascongadas’ (les trois autres provinces basques : Bizkaia, Gipuzkoa et Alava), où les assemblées et les fueros locaux sont maintenus jusqu’à l’époque isabellienne (1833, lorsque le ministre Javier de Burgos parachève l’œuvre centralisatrice avec sa division provinciale sur le ‘modèle’ des départements ‘français’).
Est-ce un hasard ? Les terres et les populations qui se sont montrées ‘déloyales’ envers Philippe V sont celles où, déjà lors de la constitution du royaume, le développement (capitaliste) des forces productives était le plus avancé : les terres catalanes... Sans doute pressentaient-elles, à juste titre, le dur impact du 'modèle' absolutiste français sur la large autonomie dont elles jouissaient jusqu'alors.

DE FAIT, la centralisation castillane autoritaire qui se met alors en place va devenir l’élément essentiel du ‘système espagnol’ jusqu’à nos jours, encore plus à travers l’époque des révolutions bourgeoises et - fondamentalement - lorsque la péninsule, comme le reste du monde, entrera (dans le dernier tiers du 19e siècle) dans l’époque de la révolution prolétarienne. Un système que l’on peut, finalement et en dernière analyse, qualifier de ‘Sainte Alliance miniature’. En effet, en termes de niveau des forces productives et de développement de la classe révolutionnaire (bourgeoisie libérale puis prolétariat), l’‘Espagne’ a une structure en ‘donut’ : les régions économiquement avancées, avec la plus importante bourgeoisie et (par suite) le plus important et conscient prolétariat, sont sur le pourtour, sur les côtes atlantiques et méditerranéennes. Au centre géographique exact (la ville fut choisie précisément pour cela au 16e siècle) il y a la métropole madrilène, centre industriel et d’affaires, avec également un important prolétariat. Mais tout autour, sur des centaines de kilomètres... c’est le ‘vide’ économique, un immense plateau agro-pastoral, la Meseta (Vieille- et Nouvelle-Castille, León) à laquelle on peut ajouter la vallée de l’Èbre en amont de Saragosse, y compris le sud d’Euskal Herria : un monde rural traditionnel fermement encadré par la propriété foncière et l’Église, aux mentalités politiques conservatrices (mais où le patriciat grand-bourgeois madrilène peut impulser un peu de progressisme quand même). Et ce sont pourtant, au contraire de tous les grands États modernes/contemporains, ces territoires les plus arriérés économiquement (encore aujourd’hui, et très nettement jusqu’aux années 1970) qui tiennent l’appareil politico-militaire 'Espagne’ ; exactement comme la Russie et l’Autriche-Hongrie
 dans le système européen de la ‘Sainte Alliance’, entre 1815 et 1848. Car ils sont en réalité, sous la coupe de leur aristocratie qui a suivi la ‘modernité’ en traînant des pieds et de leur bourgeoisie oligarchique, et bien sûr de l’Église catholique, une masse de manœuvre pouvant ‘voler à la rescousse’ de la grande bourgeoisie ‘du pourtour’, lorsque (hier) la révolution bourgeoise se faisait un peu trop ‘radicale’ (sous l’influence d’éléments petits-bourgeois), et (aujourd’hui et depuis la fin du 19e siècle) lorsque se lève le vent de la révolution prolétarienne. Le ‘système Espagne’ est en réalité un ‘cartel’ d’oligarchies (grand-bourgeoises et aristocrates ‘modernisées’), avec des ‘centres’ économiques sur tout le pourtour (Barcelone, Bilbao, Santander, Oviedo- Gijón, La Corogne, le triangle Séville-Cadix- Málaga, Murcie-Carthagène, Valence) plus Madrid, et dont l’armée de secours est la Meseta et la haute vallée de l’Èbre, (semi-) féodales, cléricales et arriérées : la Castille, en dernière analyse, est la forteresse de la Réaction ibérique comme les Empires du tsar et de Metternich dans l'Europe post-Waterloo ; tel est le fondement (et le seul) de sa prééminence politique. [Lire à ce sujet cette intéressante analyse de Sartre à partir du cas du Pays Basque] [Pour illustrer ce qui vient d'être dit, l'on peut aussi regarder la carte de provenance des guardias civiles par province (nombre d'individus devenus gardes civils pour 1.000 naissances)]
dans le système européen de la ‘Sainte Alliance’, entre 1815 et 1848. Car ils sont en réalité, sous la coupe de leur aristocratie qui a suivi la ‘modernité’ en traînant des pieds et de leur bourgeoisie oligarchique, et bien sûr de l’Église catholique, une masse de manœuvre pouvant ‘voler à la rescousse’ de la grande bourgeoisie ‘du pourtour’, lorsque (hier) la révolution bourgeoise se faisait un peu trop ‘radicale’ (sous l’influence d’éléments petits-bourgeois), et (aujourd’hui et depuis la fin du 19e siècle) lorsque se lève le vent de la révolution prolétarienne. Le ‘système Espagne’ est en réalité un ‘cartel’ d’oligarchies (grand-bourgeoises et aristocrates ‘modernisées’), avec des ‘centres’ économiques sur tout le pourtour (Barcelone, Bilbao, Santander, Oviedo- Gijón, La Corogne, le triangle Séville-Cadix- Málaga, Murcie-Carthagène, Valence) plus Madrid, et dont l’armée de secours est la Meseta et la haute vallée de l’Èbre, (semi-) féodales, cléricales et arriérées : la Castille, en dernière analyse, est la forteresse de la Réaction ibérique comme les Empires du tsar et de Metternich dans l'Europe post-Waterloo ; tel est le fondement (et le seul) de sa prééminence politique. [Lire à ce sujet cette intéressante analyse de Sartre à partir du cas du Pays Basque] [Pour illustrer ce qui vient d'être dit, l'on peut aussi regarder la carte de provenance des guardias civiles par province (nombre d'individus devenus gardes civils pour 1.000 naissances)]Bien sûr, tout cela ne va pas sans contradictions (parfois explosives) entre ces ‘centres’ de pouvoir, et ne se vérifie pas exactement à chaque épisode de l’histoire péninsulaire ; mais la tendance fondamentale est celle-ci.
Tutelle de la ‘France’ (très nette jusqu’aux années 1970 voire 1980) et centralisation castillane autoritaire dans un système de ‘mini-Sainte-Alliance’, telles sont les deux spécificités fondamentales de la réalité politique ‘Espagne’. Si l’on ne comprend pas cela, on ne peut strictement rien comprendre à l’‘Espagne’ des 300 dernières années (autrement dit, de l’époque des révolutions bourgeoises puis de la révolution prolétarienne).
À ce stade, donc, avec les Décrets de Nueva Planta, l’on peut considérer que la construction de l’‘Espagne’ comme État moderne est parachevée (... sous la ‘suzeraineté’ de l’État moderne ‘français’ voisin).
 La mutation de l’État moderne espagnol en État contemporain est un processus que l’on peut faire débuter sous le règne de Charles IV, contemporain de la Révolution bourgeoise française (et successeur du ‘despote éclairé’ Charles III), et s’achever à l’avènement d’Alphonse XII (1874), qui promulgue une Constitution et met fin aux guerres carlistes (1876). Cette période va ‘brouiller’ quelque peu ce qui vient d’être exposé plus haut car, pour le coup, le système de ‘Sainte Alliance’ conservatrice sous la botte castillane va entrer en contradiction avec l’autre aspect, la tutelle de la ‘France’ qui est à cette époque le ‘phare’ et le ‘métronome’ des bouleversements politiques mondiaux. Pour faire simple, il suffira de dire de regarder vers le Nord : une ‘France’ conservatrice, c’est (quasi simultanément) une ‘botte castillane’ qui agit dans un sens conservateur ; une ‘France’ libérale, ‘progressiste’, c’est une Castille qui pousse l’‘Espagne’ sur le chemin de la modernité capitaliste.
La mutation de l’État moderne espagnol en État contemporain est un processus que l’on peut faire débuter sous le règne de Charles IV, contemporain de la Révolution bourgeoise française (et successeur du ‘despote éclairé’ Charles III), et s’achever à l’avènement d’Alphonse XII (1874), qui promulgue une Constitution et met fin aux guerres carlistes (1876). Cette période va ‘brouiller’ quelque peu ce qui vient d’être exposé plus haut car, pour le coup, le système de ‘Sainte Alliance’ conservatrice sous la botte castillane va entrer en contradiction avec l’autre aspect, la tutelle de la ‘France’ qui est à cette époque le ‘phare’ et le ‘métronome’ des bouleversements politiques mondiaux. Pour faire simple, il suffira de dire de regarder vers le Nord : une ‘France’ conservatrice, c’est (quasi simultanément) une ‘botte castillane’ qui agit dans un sens conservateur ; une ‘France’ libérale, ‘progressiste’, c’est une Castille qui pousse l’‘Espagne’ sur le chemin de la modernité capitaliste.Lorsque, donc, éclate la Grande Révolution bourgeoise ‘française’ en 1789, Charles IV de Bourbon vient de monter sur le trône (1788). Il reste au début passif, voire bienveillant envers les évènements qui se déroulent au nord des Pyrénées : fils du ‘despote éclairé’ Charles III, il est lui-même un monarque ‘libéral’. Il ne se joint pas à la coalition absolutiste qui, en avril 1792, déferle sur la ‘France’ révolutionnaire. Il n’entre en guerre contre elle que début 1793, lorsque la Convention fait guillotiner Louis XVI : cette fois, le symbole va beaucoup trop loin pour toute tête couronnée qui se respecte ; mais ses armées ne joueront pas de rôle militaire vraiment décisif. Lorsque la ‘folie’ jacobine est enfin conjurée, en 1795, il redevient son allié – indéfectible. C’est une escadre ‘franco’-‘espagnole’ qui affrontera, par exemple, la flotte anglaise de Nelson à la célèbre bataille navale de Trafalgar. En réalité, Charles IV est un monarque ‘faible’, sous l’influence d’un parvenu, le ‘favori’ Manuel Godoy, favorable à la révolution bourgeoise française.
 Napoléon, premier consul depuis 1799 et auto-couronné empereur en 1804, peut donc penser que le ‘vassal’ du Sud va tranquillement ‘évoluer’, en ‘suivant le mouvement’ de la Grande Révolution bourgeoise qu’il est en train de répandre à travers toute l’Europe. Mais les choses piétinent, notamment face à l’opposition de l’héritier Ferdinand, farouche contre-révolutionnaire, traditionnaliste, absolutiste et partisan de Louis XVIII. Suite à un coup de force que tente celui-ci, avec l’appui de l’aristocratie conservatrice, contre son père et Godoy, Napoléon dépose tout ce beau monde (expédié en France) et installe directement son propre frère aîné, Joseph Bonaparte, sur le trône. Celui-ci commence immédiatement à prendre les ‘mesures’ révolutionnaires bourgeoises (refonte de l’administration, du droit etc.) que son cadet a déjà imposé à la ‘France’ et à une bonne partie de l’Europe. Mais cette fois, la ‘suzeraineté’ française se fait beaucoup trop ‘concrète’ et visible : c’est clairement une occupation étrangère. La réaction nationaliste est unanime, panibérique. Au Nord et à l’Ouest, elle est principalement conservatrice, traditionaliste, catholique, hostile aux ‘idées nouvelles’ et aux ‘réformes’ bourgeoises importées par les ‘Français’ ; au Sud et à l’Est, en revanche, elle est libérale, parfois même libérale ‘avancée’ (mais ‘hispaniste’, hostile à la domination étrangère), et adopte en 1812 la Constitution de Cadix – qui deviendra le ‘Graal’ des libéraux et des progressistes pour plus d’un siècle. Avec l’appui de son ‘suzerain’ britannique, le Portugal quant à lui résiste aux assauts napoléoniens. Les cinq ans de conflit qui s’ensuivent sont véritablement le ‘Vietnam’ de Napoléon, aux affrontements ‘conventionnels’ avec les troupes anglo-portugaises et ‘espagnoles’ bourbonistes s’ajoutant une
Napoléon, premier consul depuis 1799 et auto-couronné empereur en 1804, peut donc penser que le ‘vassal’ du Sud va tranquillement ‘évoluer’, en ‘suivant le mouvement’ de la Grande Révolution bourgeoise qu’il est en train de répandre à travers toute l’Europe. Mais les choses piétinent, notamment face à l’opposition de l’héritier Ferdinand, farouche contre-révolutionnaire, traditionnaliste, absolutiste et partisan de Louis XVIII. Suite à un coup de force que tente celui-ci, avec l’appui de l’aristocratie conservatrice, contre son père et Godoy, Napoléon dépose tout ce beau monde (expédié en France) et installe directement son propre frère aîné, Joseph Bonaparte, sur le trône. Celui-ci commence immédiatement à prendre les ‘mesures’ révolutionnaires bourgeoises (refonte de l’administration, du droit etc.) que son cadet a déjà imposé à la ‘France’ et à une bonne partie de l’Europe. Mais cette fois, la ‘suzeraineté’ française se fait beaucoup trop ‘concrète’ et visible : c’est clairement une occupation étrangère. La réaction nationaliste est unanime, panibérique. Au Nord et à l’Ouest, elle est principalement conservatrice, traditionaliste, catholique, hostile aux ‘idées nouvelles’ et aux ‘réformes’ bourgeoises importées par les ‘Français’ ; au Sud et à l’Est, en revanche, elle est libérale, parfois même libérale ‘avancée’ (mais ‘hispaniste’, hostile à la domination étrangère), et adopte en 1812 la Constitution de Cadix – qui deviendra le ‘Graal’ des libéraux et des progressistes pour plus d’un siècle. Avec l’appui de son ‘suzerain’ britannique, le Portugal quant à lui résiste aux assauts napoléoniens. Les cinq ans de conflit qui s’ensuivent sont véritablement le ‘Vietnam’ de Napoléon, aux affrontements ‘conventionnels’ avec les troupes anglo-portugaises et ‘espagnoles’ bourbonistes s’ajoutant une  guerre de guérilla (le terme naît à cette occasion) qui éreinte l'armée d'occupation ; l'Empereur reconnaîtra lui-même avoir sans doute plus perdu la guerre en ‘Espagne’ qu’en Russie.
guerre de guérilla (le terme naît à cette occasion) qui éreinte l'armée d'occupation ; l'Empereur reconnaîtra lui-même avoir sans doute plus perdu la guerre en ‘Espagne’ qu’en Russie.De retour sur le trône, Ferdinand (VII) balaye d’un revers de main la Constitution de Cadix que lui présentent les libéraux : il entend régner en monarque absolu et ‘très catholique’, et arrime son régime de terreur blanche à la Sainte Alliance de Metternich et à la Restauration française de Louis XVIII, qui l’aide, en 1823, à écraser le soulèvement andalou constitutionnaliste de Riego (celui-ci devient un martyr et un mythe de la gauche bourgeoise ibérique). Mais en 1830, la Restauration cède la place à la Monarchie libérale de Juillet, et Ferdinand meurt en 1833. Lui succède sa fille Isabelle, âgée de… 3 ans. La Monarchie de Juillet, épaulée par l’autre ‘puissance libérale’ de l'époque, l’Angleterre (qui a plus combattu l’expansionnisme de la Révolution française que ses idées elles-mêmes), va imposer à la régente Marie-Christine et à son aide de camp, Espartero, de ‘moderniser’ le pays en brisant les résistances aristocratiques, cléricales, et des derniers fueros : les fueros ‘basco-navarrais’, épargnés par les Décrets de Nueva Planta. Ces forces (aristo-cléricales et basques) vont alors soutenir le frère de feu Ferdinand VII, Charles, prétendant au trône (invoquant l’impossibilité pour une femme de régner…) : c’est la première
 guerre carliste (1833-46), dans laquelle la France et l’Angleterre (avec son ‘vassal’ portugais) interviennent en faveur des modernistes isabelliens, qui remportent finalement la victoire. Une Constitution de 1812 ‘édulcorée’ est adoptée (1837).
guerre carliste (1833-46), dans laquelle la France et l’Angleterre (avec son ‘vassal’ portugais) interviennent en faveur des modernistes isabelliens, qui remportent finalement la victoire. Une Constitution de 1812 ‘édulcorée’ est adoptée (1837).La politique intérieure du royaume suivra alors les ‘coups de barre’ à ‘gauche’ ou à ‘droite’ de Paris, sous la conduite de caudillos militaires tantôt ‘libéraux-progressistes’ (Espartero, Prim, Serrano), tantôt ‘modérés-conservateurs’ (Narvaez, O’Donnell). Lorsqu’un pronunciamiento libéral (Prim et Serrano) dépose finalement Isabelle II en 1868, peut-être à la faveur de l’évolution très libérale du Second Empire à ce moment-là, Napoléon III réussit à ‘placer’ sur le trône un prince allié, Amédée de Savoie, fils du roi d’Italie (bien que les putschistes aient envisagé, un temps, de couronner un Hohenzollern, ce qui ‘nourrira’ le contentieux franco-prussien pré-1870).
Dans le contexte de ‘flou artistique’ qui règne à Paris, entre monarchistes et républicains, après la défaite de 1870-71 et la chute de l’Empire, la guerre carliste reprend, chaque camp ‘français’ soutenant son ‘champion’ : le prétendant carliste parvient à contrôler un tiers du territoire étatique. Il y aura à ce moment-là une ‘Ière République’ (1873-74), mais c’est en réalité plus une junte militaire libérale
 d’urgence, suite à la démission précipitée d’Amédée, qu'autre chose. Lorsque les choses, en ‘France’, commencent à se ‘décanter’ en faveur des républicains modérés (les jeunes monopoles ayant choisi leur camp), le carlisme perd du terrain ; finalement, l’héritier légitime Alphonse XII est couronné (1874), met fin à la guerre carliste et proclame une nouvelle Constitution – encore une fois, du ‘1812 édulcoré’ – en 1876. Ayant ‘présenté sa candidature’ aux Cortes de l’oligarchie et à la junte ‘républicaine’ comme celle d’un ‘‘prince catholique, espagnol, constitutionnaliste, libéral et désireux de servir la Nation’’, il reçoit le titre de Pacificateur. À ce stade (ère alphonsine, 1874-1931), l'on peut considérer comme achevée la mutation de l’‘Espagne’ en État contemporain : une monarchie libérale, constitutionnelle, avec un Parlement (Cortes) où s’affrontent des libéraux et des conservateurs, et… totalement en phase avec la ‘république des notables’, du ‘juste milieu’, qui règne alors à Paris. Cette période voit une première grande phase de modernisation capitaliste du pays – et, à vrai dire, sa première véritable révolution industrielle.
d’urgence, suite à la démission précipitée d’Amédée, qu'autre chose. Lorsque les choses, en ‘France’, commencent à se ‘décanter’ en faveur des républicains modérés (les jeunes monopoles ayant choisi leur camp), le carlisme perd du terrain ; finalement, l’héritier légitime Alphonse XII est couronné (1874), met fin à la guerre carliste et proclame une nouvelle Constitution – encore une fois, du ‘1812 édulcoré’ – en 1876. Ayant ‘présenté sa candidature’ aux Cortes de l’oligarchie et à la junte ‘républicaine’ comme celle d’un ‘‘prince catholique, espagnol, constitutionnaliste, libéral et désireux de servir la Nation’’, il reçoit le titre de Pacificateur. À ce stade (ère alphonsine, 1874-1931), l'on peut considérer comme achevée la mutation de l’‘Espagne’ en État contemporain : une monarchie libérale, constitutionnelle, avec un Parlement (Cortes) où s’affrontent des libéraux et des conservateurs, et… totalement en phase avec la ‘république des notables’, du ‘juste milieu’, qui règne alors à Paris. Cette période voit une première grande phase de modernisation capitaliste du pays – et, à vrai dire, sa première véritable révolution industrielle.Porté par cette conjoncture économique favorable (malgré la grave crise de la perte des dernières colonies, face à l’impérialisme US, en 1898), le régime ‘gère’ efficacement les contradictions au sein de la classe dominante, qu’elles soient nationales ou ‘progressistes’/conservateurs.
 Mais le capitalisme mondial est entré, en même temps que se parachevait l’État contemporain, dans l’époque des crises générales du capitalisme et des monopoles, et donc, dans l’époque de la révolution prolétarienne : le mouvement ouvrier, prolétaire rural et paysan-pauvre se développe à grande vitesse ; le Parti socialiste (PSOE) naît en 1879, tandis que se développe (surtout en Catalogne industrielle et dans le prolétariat/semi-prolétariat rural du Sud) un mouvement anarcho-syndicaliste qui devient en 1910 la CNT. De leur côté, prises entre la classe dominante (qui a trouvé son équilibre) et ce mouvement ouvrier-paysan en pleine expansion, les couches moyennes (intellectuels, petits fonctionnaires, petits notables locaux, petits entrepreneurs, paysans moyens etc.) abandonnent le ‘libéralisme avancé’ du 19e siècle et s’ouvrent à l’idée républicaine (qui fait son chemin, en fait, depuis l’éphémère et mouvementée ‘Ière République’ de 1873-74), sur une ligne ‘positiviste’ proche du radicalisme ‘français’, ou sur une ligne ‘démocratique et sociale’ (et, bien sûr, sur une ligne 'fédéraliste' dans les nations non-castillanes). Et puis, ‘locomotive’ économique de la péninsule dans le contexte de développement accéléré des forces productives, la grande bourgeoisie catalane commence à se réaffirmer face à Madrid, avec la Ligue régionaliste (plutôt ‘libérale-conservatrice’, ancêtre net de la CiU actuelle) formée en 1901, arrachant en 1913 un relatif statut d’autonomie administrative (la Mancommunauté) ; tandis qu’à l’autre bout des Pyrénées, le Parti nationaliste basque (PNV-EAJ), très ‘réac’ - mais nettement plus bourgeois que son prédécesseur carliste, naît en 1895.
Mais le capitalisme mondial est entré, en même temps que se parachevait l’État contemporain, dans l’époque des crises générales du capitalisme et des monopoles, et donc, dans l’époque de la révolution prolétarienne : le mouvement ouvrier, prolétaire rural et paysan-pauvre se développe à grande vitesse ; le Parti socialiste (PSOE) naît en 1879, tandis que se développe (surtout en Catalogne industrielle et dans le prolétariat/semi-prolétariat rural du Sud) un mouvement anarcho-syndicaliste qui devient en 1910 la CNT. De leur côté, prises entre la classe dominante (qui a trouvé son équilibre) et ce mouvement ouvrier-paysan en pleine expansion, les couches moyennes (intellectuels, petits fonctionnaires, petits notables locaux, petits entrepreneurs, paysans moyens etc.) abandonnent le ‘libéralisme avancé’ du 19e siècle et s’ouvrent à l’idée républicaine (qui fait son chemin, en fait, depuis l’éphémère et mouvementée ‘Ière République’ de 1873-74), sur une ligne ‘positiviste’ proche du radicalisme ‘français’, ou sur une ligne ‘démocratique et sociale’ (et, bien sûr, sur une ligne 'fédéraliste' dans les nations non-castillanes). Et puis, ‘locomotive’ économique de la péninsule dans le contexte de développement accéléré des forces productives, la grande bourgeoisie catalane commence à se réaffirmer face à Madrid, avec la Ligue régionaliste (plutôt ‘libérale-conservatrice’, ancêtre net de la CiU actuelle) formée en 1901, arrachant en 1913 un relatif statut d’autonomie administrative (la Mancommunauté) ; tandis qu’à l’autre bout des Pyrénées, le Parti nationaliste basque (PNV-EAJ), très ‘réac’ - mais nettement plus bourgeois que son prédécesseur carliste, naît en 1895.Au milieu de tout cela, il faut bien comprendre que la 'révolution bourgeoise' hispanique, tardive, est une révolution bourgeoise inachevée (comme en Italie, par exemple) : la bourgeoisie, faible et craignant le débordement par les masses - ou même par sa propre aile 'radicale', a laissé subsister de manière très importante les forces féodales (Église bien sûr, grande propriété foncière, aristocratie 'de Cour' qui forme une oligarchie bureaucratique, aristocratie militaire, etc.), ce qui est un aspect structurant de l'État contemporain espagnol encore aujourd'hui.
 Avec la Révolution bolchévique de 1917, l’entrée dans la première vague de la Révolution prolétarienne mondiale fait à nouveau ‘exploser’ les contradictions de classe (trienio bolchevique - "trois années bolchéviques" 1918-21, notamment en Andalousie) et au sein de la classe dominante. C’est ainsi qu’en 1923, Alphonse XIII remet le pouvoir au général pronunciamientiste Primo de Rivera, qui suspend la Constitution de 1876 et instaure un ‘premier fascisme espagnol’ (inspiré du ‘modèle’ italien), régime autoritaire, contre-révolutionnaire et bien sûr centralisateur castillan (constante de la réaction ibérique) ; mais sachant aussi manier la ‘carotte’ des réformettes sociales. Il ne parvient cependant pas à ‘gérer’ les contradictions sociales et inter-bourgeoises explosives, les mouvements populaires qui ont le soutien de la ‘gauche’ bourgeoise républicaine et progressiste etc., et il jette l’éponge en 1930. Dans un contexte social semi-insurrectionnel, les républicains et les socialistes triomphent aux municipales d’avril 1931 : le roi abdique, la République est proclamée.
Avec la Révolution bolchévique de 1917, l’entrée dans la première vague de la Révolution prolétarienne mondiale fait à nouveau ‘exploser’ les contradictions de classe (trienio bolchevique - "trois années bolchéviques" 1918-21, notamment en Andalousie) et au sein de la classe dominante. C’est ainsi qu’en 1923, Alphonse XIII remet le pouvoir au général pronunciamientiste Primo de Rivera, qui suspend la Constitution de 1876 et instaure un ‘premier fascisme espagnol’ (inspiré du ‘modèle’ italien), régime autoritaire, contre-révolutionnaire et bien sûr centralisateur castillan (constante de la réaction ibérique) ; mais sachant aussi manier la ‘carotte’ des réformettes sociales. Il ne parvient cependant pas à ‘gérer’ les contradictions sociales et inter-bourgeoises explosives, les mouvements populaires qui ont le soutien de la ‘gauche’ bourgeoise républicaine et progressiste etc., et il jette l’éponge en 1930. Dans un contexte social semi-insurrectionnel, les républicains et les socialistes triomphent aux municipales d’avril 1931 : le roi abdique, la République est proclamée.La suite des évènements est connue : cinq années d’affrontements aigus entre d’un côté le mouvement ouvrier-paysan, les sociaux-démocrates, les marxistes, les anarchistes et la ‘gauche républicaine’ bourgeoise, de l’autre les réactionnaires, possédants, cléricaux, monarchistes et de plus en plus de républicains ‘modérés’ conservateurs ; puis la victoire (février 1936, deux mois avant celle - annoncée - de son équivalent hexagonal) d’un Front populaire progressiste (PCE, PSOE, gauche républicaine, syndicats réformistes et révolutionnaires) et, cinq mois plus tard, le pronunciamiento réactionnaire-fasciste de Sanjurjo, Mola et Franco. À Paris, les radicaux au pouvoir sont plutôt favorables aux républicains, d’idéologie finalement assez proche, mais la ‘droite dure’, qui monte en puissance et s’agite face au ‘bolchévisme’, est évidemment favorable à une ‘reprise en main’, militaire si besoin est. Les anti-républicains de la péninsule se tournent vers Hitler et Mussolini, qui ont ‘terrassé le péril rouge’ dans leurs pays respectifs.
 Aborder la question de la guerre civile antifasciste, des contradictions inter-impérialistes qui l’ont sous-tendue, des contradictions et des erreurs du camp républicain/révolutionnaire et du mouvement communiste international qui le soutenait, prendrait des pages et des pages : ce ne sera pas le sujet ici. Il y a, en castillan, cet article publié sur Dazibao Rojo qui en donne un aperçu intéressant ; traduit par SLP sur sa page Facebook.
Aborder la question de la guerre civile antifasciste, des contradictions inter-impérialistes qui l’ont sous-tendue, des contradictions et des erreurs du camp républicain/révolutionnaire et du mouvement communiste international qui le soutenait, prendrait des pages et des pages : ce ne sera pas le sujet ici. Il y a, en castillan, cet article publié sur Dazibao Rojo qui en donne un aperçu intéressant ; traduit par SLP sur sa page Facebook. Arrivé au pouvoir avec le soutien d’Hitler et Mussolini, Franco, tout en mettant en place une terreur blanche effroyable contre les révolutionnaires et les républicains progressistes (centaines de milliers d’exécutions jusqu’au milieu des années 1940), ne s’engagera cependant pas à leurs côtés dans la Seconde Guerre mondiale. Ce qui lui permettra, après 1945, de prendre toute sa place dans le ‘dispositif’ anticommuniste du ‘monde libre’... encore une fois, sous le bienveillant ‘parapluie’ de l’impérialisme français, bien que celui-ci (pour faire bonne mesure ? pour avoir deux fers au feu ?) héberge également l’opposition (modérée) en exil. Dans les années 1960, De Gaulle et Franco sont ‘copains comme cochons’. L’époque voit, surtout à partir de 1957 (avec les ‘technocrates’ de l’Opus Dei), une nouvelle grande vague de modernisation, qui se poursuivra jusqu’aux années 2000. Mais cette modernisation, en plus de se heurter à l’opposition antifasciste populaire (qui ne pardonne pas l’assassinat de la République et de centaines de milliers de révolutionnaires, démocrates et progressistes), profite une nouvelle fois surtout au pourtour et voit monter les affirmations nationales des bourgeoisies, supportant de moins en moins la centralisation castillane autoritaire (qui n’a plus vraiment lieu d’être...).
Arrivé au pouvoir avec le soutien d’Hitler et Mussolini, Franco, tout en mettant en place une terreur blanche effroyable contre les révolutionnaires et les républicains progressistes (centaines de milliers d’exécutions jusqu’au milieu des années 1940), ne s’engagera cependant pas à leurs côtés dans la Seconde Guerre mondiale. Ce qui lui permettra, après 1945, de prendre toute sa place dans le ‘dispositif’ anticommuniste du ‘monde libre’... encore une fois, sous le bienveillant ‘parapluie’ de l’impérialisme français, bien que celui-ci (pour faire bonne mesure ? pour avoir deux fers au feu ?) héberge également l’opposition (modérée) en exil. Dans les années 1960, De Gaulle et Franco sont ‘copains comme cochons’. L’époque voit, surtout à partir de 1957 (avec les ‘technocrates’ de l’Opus Dei), une nouvelle grande vague de modernisation, qui se poursuivra jusqu’aux années 2000. Mais cette modernisation, en plus de se heurter à l’opposition antifasciste populaire (qui ne pardonne pas l’assassinat de la République et de centaines de milliers de révolutionnaires, démocrates et progressistes), profite une nouvelle fois surtout au pourtour et voit monter les affirmations nationales des bourgeoisies, supportant de moins en moins la centralisation castillane autoritaire (qui n’a plus vraiment lieu d’être...). À la mort du dictateur fasciste, son successeur désigné, Juan Carlos de Bourbon, devient roi et amorce un processus de libéralisation, autorisant les partis réformistes (PSOE, PCE et quelques autres) et nationalistes bourgeois non-castillans (PNV, CiU) ) à sortir de la clandestinité. Alors que le monde entre dans une nouvelle crise générale du capitalisme (mais qui frappe peu l’‘Espagne’, voire lui profite, grâce à son coût du travail relativement peu élevé ; ce qui n’empêche cependant pas un taux de chômage et de pauvreté structurellement élevé), et face à un mouvement révolutionnaire relativement faible (quoique plus fort qu’ailleurs, avec des organisations combattantes ML comme le FRAP ou les GRAPO, et bien sûr la lutte armée de libération basque, mais moins qu’en Italie à la même époque, par exemple), le pacte ‘espagnol’ des bourgeoisies est refondé (avec le système des ‘autonomies régionales’ etc.) et scellé dans la Constitution de 1978 ; les forces réformistes et
À la mort du dictateur fasciste, son successeur désigné, Juan Carlos de Bourbon, devient roi et amorce un processus de libéralisation, autorisant les partis réformistes (PSOE, PCE et quelques autres) et nationalistes bourgeois non-castillans (PNV, CiU) ) à sortir de la clandestinité. Alors que le monde entre dans une nouvelle crise générale du capitalisme (mais qui frappe peu l’‘Espagne’, voire lui profite, grâce à son coût du travail relativement peu élevé ; ce qui n’empêche cependant pas un taux de chômage et de pauvreté structurellement élevé), et face à un mouvement révolutionnaire relativement faible (quoique plus fort qu’ailleurs, avec des organisations combattantes ML comme le FRAP ou les GRAPO, et bien sûr la lutte armée de libération basque, mais moins qu’en Italie à la même époque, par exemple), le pacte ‘espagnol’ des bourgeoisies est refondé (avec le système des ‘autonomies régionales’ etc.) et scellé dans la Constitution de 1978 ; les forces réformistes et  les nationalistes bourgeois (catalans, basques, galiciens, andalous etc.) intègrent le ‘système’, les ‘affaires’ (notamment immobilières, secteur très important) de chaque bourgeoisie nationale étant toujours ‘bien à l’abri’ sous le parapluie politico-militaire castillan. C’est l’État espagnol que nous connaissons aujourd’hui, dans lequel luttent au quotidien, affrontent la répression, croupissent au cachot, sont torturés et parfois meurent des milliers de révolutionnaires de toutes les nations constitutives. Son capitalisme, 'tiré’ par les locomotives catalane et basque ou encore cantabre (Banco Santander, première entreprise 'espagnole', 23e mondiale en 2012 et 13e en 2011, selon le classement Forbes Global), asturienne (Aceralia, une des composantes d'Arcelor) etc. a atteint un stade 'semi-impérialiste’, avec des monopoles importants, exportateurs de capitaux (l’hispanité est mobilisée pour se tourner vers les anciennes colonies latino-américaines, avec les 'sommets ibéro-américains’, annuels depuis 1991) ; mais reste néanmoins 'bien à l‘abri’ sous l'aile 'protectrice' de l’axe franco-allemand et de sa construction impérialiste UE, bien que José Maria Aznar (1996-2004) ait tenté un moment un alignement plus ‘atlantiste' (anglo-saxon). Depuis 2008, il est entré dans une crise économique est sociale sans précédent dans son histoire, et des mouvements populaires de type semi-insurrectionnel secouent la péninsule.
les nationalistes bourgeois (catalans, basques, galiciens, andalous etc.) intègrent le ‘système’, les ‘affaires’ (notamment immobilières, secteur très important) de chaque bourgeoisie nationale étant toujours ‘bien à l’abri’ sous le parapluie politico-militaire castillan. C’est l’État espagnol que nous connaissons aujourd’hui, dans lequel luttent au quotidien, affrontent la répression, croupissent au cachot, sont torturés et parfois meurent des milliers de révolutionnaires de toutes les nations constitutives. Son capitalisme, 'tiré’ par les locomotives catalane et basque ou encore cantabre (Banco Santander, première entreprise 'espagnole', 23e mondiale en 2012 et 13e en 2011, selon le classement Forbes Global), asturienne (Aceralia, une des composantes d'Arcelor) etc. a atteint un stade 'semi-impérialiste’, avec des monopoles importants, exportateurs de capitaux (l’hispanité est mobilisée pour se tourner vers les anciennes colonies latino-américaines, avec les 'sommets ibéro-américains’, annuels depuis 1991) ; mais reste néanmoins 'bien à l‘abri’ sous l'aile 'protectrice' de l’axe franco-allemand et de sa construction impérialiste UE, bien que José Maria Aznar (1996-2004) ait tenté un moment un alignement plus ‘atlantiste' (anglo-saxon). Depuis 2008, il est entré dans une crise économique est sociale sans précédent dans son histoire, et des mouvements populaires de type semi-insurrectionnel secouent la péninsule.
 votre commentaire
votre commentaire
-
3. LES CONTRADICTIONS NATIONS/ÉTAT ET LA LUTTE DES CLASSES
 Cela a déjà été dit à plusieurs reprises : l’État espagnol est sans doute l’espace géographique, en Europe, où existe la plus haute conscience populaire de ce que théorise SLP sur le rapport question nationale/lutte de classe, depuis maintenant plusieurs années : les grands États modernes, qui ont fourni au capitalisme et aux révolutions bourgeoises (les transformant en États contemporains) leur ‘cadre propice’ de développement et d’action, sont tous sans exception des États plurinationaux qui ont nié politiquement (et tenté de nier socialement et culturellement, au stade des monopoles) un ensemble de nations précédemment constituées ; et le ‘retour’ de ces nations niées à un niveau supérieur (sur une ligne politique révolutionnaire, sous la direction du prolétariat) est une composante intrinsèque du processus de la révolution prolétarienne (et non un épiphénomène ‘déplaisant’ avec lequel les révolutionnaires marxistes devraient, presque à contrecœur, ‘composer’).
Cela a déjà été dit à plusieurs reprises : l’État espagnol est sans doute l’espace géographique, en Europe, où existe la plus haute conscience populaire de ce que théorise SLP sur le rapport question nationale/lutte de classe, depuis maintenant plusieurs années : les grands États modernes, qui ont fourni au capitalisme et aux révolutions bourgeoises (les transformant en États contemporains) leur ‘cadre propice’ de développement et d’action, sont tous sans exception des États plurinationaux qui ont nié politiquement (et tenté de nier socialement et culturellement, au stade des monopoles) un ensemble de nations précédemment constituées ; et le ‘retour’ de ces nations niées à un niveau supérieur (sur une ligne politique révolutionnaire, sous la direction du prolétariat) est une composante intrinsèque du processus de la révolution prolétarienne (et non un épiphénomène ‘déplaisant’ avec lequel les révolutionnaires marxistes devraient, presque à contrecœur, ‘composer’).En ‘Espagne’, donc, la contradiction entre les nationalités et l’État qui les a absorbées, et surtout, le lien entre cette contradiction et la lutte des classes, ont toujours été à un niveau sans guère d’équivalent ailleurs ; et sont encore aujourd’hui ‘à la pointe’ européenne et occidentale sur la question.
 Déjà dans les années 1930, les marxistes-léninistes venus de toute l’Europe, dépêchés par le Komintern pour ‘appuyer’ le jeune mouvement communiste en formation, avec leurs conceptions ‘kominterniennes’ d’un Lénine ou d’un Staline qui ne s’étaient jamais départis d’un certain jacobinisme, comprirent rapidement avec quelle réalité sociale ils allaient devoir ‘composer’. Ainsi, en Catalogne, la fédération locale du PCE sera amenée à former un Front, puis à fusionner en juillet 1936 (immédiatement après le pronunciamiento franquiste) avec la fédération du PSOE, l’Union socialiste de Catalogne et le Parti prolétaire catalan pour former le Parti socialiste unifié de Catalogne, tandis qu’un Parti communiste basque est créé en 1935. La gauche radicale et révolutionnaire était particulièrement ancrée en Catalogne et dans le Pays valencien (où s’installeront les institutions républicaines), au Pays Basque côtier (urbain et industriel) qui deviendra République d’Euzkadi, en Andalousie, en Cantabrie et dans les Asturies (théâtre d’une puissante insurrection ouvrière en 1934, contrôlant plusieurs milliers de km² pendant plusieurs semaines ; en 1937, dernier territoire du Nord à résister aux franquistes, elles tenteront de proclamer leur indépendance sous la conduite du socialiste Belarmino Tomás) ; cela sans jamais se départir d’un profond sentiment national. En revanche les nations galicienne et léonaise, la Vieille-Castille – où s’installe le gouvernement franquiste, à Burgos – et le Pays Basque navarrais et alavais seront des bastions contre-révolutionnaires...
Déjà dans les années 1930, les marxistes-léninistes venus de toute l’Europe, dépêchés par le Komintern pour ‘appuyer’ le jeune mouvement communiste en formation, avec leurs conceptions ‘kominterniennes’ d’un Lénine ou d’un Staline qui ne s’étaient jamais départis d’un certain jacobinisme, comprirent rapidement avec quelle réalité sociale ils allaient devoir ‘composer’. Ainsi, en Catalogne, la fédération locale du PCE sera amenée à former un Front, puis à fusionner en juillet 1936 (immédiatement après le pronunciamiento franquiste) avec la fédération du PSOE, l’Union socialiste de Catalogne et le Parti prolétaire catalan pour former le Parti socialiste unifié de Catalogne, tandis qu’un Parti communiste basque est créé en 1935. La gauche radicale et révolutionnaire était particulièrement ancrée en Catalogne et dans le Pays valencien (où s’installeront les institutions républicaines), au Pays Basque côtier (urbain et industriel) qui deviendra République d’Euzkadi, en Andalousie, en Cantabrie et dans les Asturies (théâtre d’une puissante insurrection ouvrière en 1934, contrôlant plusieurs milliers de km² pendant plusieurs semaines ; en 1937, dernier territoire du Nord à résister aux franquistes, elles tenteront de proclamer leur indépendance sous la conduite du socialiste Belarmino Tomás) ; cela sans jamais se départir d’un profond sentiment national. En revanche les nations galicienne et léonaise, la Vieille-Castille – où s’installe le gouvernement franquiste, à Burgos – et le Pays Basque navarrais et alavais seront des bastions contre-révolutionnaires...Aujourd’hui, il n’existe pas de courant politique indépendantiste ou ‘confédéraliste’ qui soit ‘de droite’ : tous sont – à minima – sur une ligne réformiste radicale, sinon révolutionnaire anticapitaliste. La droite modérée – présente dans toutes les nations ou presque – est au mieux autonomiste, comme d’ailleurs la social-démocratie (déclinaisons du PSOE et d’IU dans chaque ‘communauté autonome’), même si en Catalogne (CiU) et au Pays Basque (PNV) la contradiction de la puissante
 bourgeoisie avec l’État madrilène peut aller jusqu’au ‘chantage à la sécession’. La ‘droite radicale’ PP et l’extrême-droite néo-franquiste sont profondément espagnolistes. Et ‘dans l’autre sens’, il n’y a pratiquement aucun individu, aucun groupe (fut-il simplement de musique) ayant une ‘conscience sociale avancée’ et a fortiori une conscience anticapitaliste, qui n’intègre des éléments de ‘réaffirmation nationale’. ‘Frères’ de nos ‘thoréziens’ façon URCF, PRCF ou Coordination communiste, amis internationaux du PTB, du KKE, des PC cubain ou vietnamien, bref, dans cette ‘mouvance-là’, les révisionnistes ‘orthodoxes’ du PCPE (qui ont scissionné du PCE ‘eurocommuniste’ en 1984, avec l’appui soviétique et cubain) mettent en avant ‘sans complexe’ le mot d’ordre de ‘République confédérale socialiste’ (la République est évidemment un autre grand mot d'ordre incontournable pour toute personne progressiste, puisque c’est sous cette forme institutionnelle que ‘l’espoir a été assassiné’ en 1936-39 : il n’y a pas de force révolutionnaire ni même sincèrement réformiste qui ne revendique le rétablissement de la République).
bourgeoisie avec l’État madrilène peut aller jusqu’au ‘chantage à la sécession’. La ‘droite radicale’ PP et l’extrême-droite néo-franquiste sont profondément espagnolistes. Et ‘dans l’autre sens’, il n’y a pratiquement aucun individu, aucun groupe (fut-il simplement de musique) ayant une ‘conscience sociale avancée’ et a fortiori une conscience anticapitaliste, qui n’intègre des éléments de ‘réaffirmation nationale’. ‘Frères’ de nos ‘thoréziens’ façon URCF, PRCF ou Coordination communiste, amis internationaux du PTB, du KKE, des PC cubain ou vietnamien, bref, dans cette ‘mouvance-là’, les révisionnistes ‘orthodoxes’ du PCPE (qui ont scissionné du PCE ‘eurocommuniste’ en 1984, avec l’appui soviétique et cubain) mettent en avant ‘sans complexe’ le mot d’ordre de ‘République confédérale socialiste’ (la République est évidemment un autre grand mot d'ordre incontournable pour toute personne progressiste, puisque c’est sous cette forme institutionnelle que ‘l’espoir a été assassiné’ en 1936-39 : il n’y a pas de force révolutionnaire ni même sincèrement réformiste qui ne revendique le rétablissement de la République). Il y a évidemment à cela des raisons de culture politique historique : ‘droite’ = Franco = centralisation castillane autoritaire. Mais ces ‘raisons historiques’, à moins de considérer que l’histoire ‘flotte dans les airs’, sont en réalité indissociables de la base matérialiste fondamentale sur laquelle l’’Espagne’ s’est construite comme État moderne, puis comme État contemporain dans lequel se déroule présentement la lutte des classes.
Là sont les raisons historiques de la situation objective. Sur le plan subjectif, c’est-à-dire de la conscience élevée que les masses populaires en ont, les raisons sont également matérialistes historiques : la bourgeoisie, on l’a dit, a toujours été historiquement faible, elle l’était déjà lorsque l’État s’est formé par un mariage féodal, et n’a pas pu profiter de la colonisation des Amériques pour se développer (la richesse produite étant captée par l’aristocratie coloniale pillarde, la splendeur de la Cour, les Pays-Bas privilégiés par Charles Quint, l’Église et les besoins de la Contre-Réforme etc.). Elle n’a, à vrai dire, jamais rien pu entreprendre de sérieux (au regard de
 l’histoire) sans le renfort d’une frange aristocratique ‘éclairée’, moderniste. Et surtout - de ce fait même - elle n’a pas connu l’émergence d’une bourgeoisie dominante, qui aurait imposé sa langue et sa culture aux autres bourgeoisies nationales puis, de là, à l’époque des monopoles, aux masses populaires. Les tentatives ont bien existé, au 18e siècle sur le ‘modèle français’, sous Primo de Rivera, puis sous Franco ; sous ce dernier, le castillan s’est effectivement répandu dans toute la péninsule comme langue véhiculaire et ‘d’usage public’ (puisqu’il était interdit d’en parler publiquement une autre) ; mais globalement, cela n’a jamais ‘pris’. Si bien que les langues, les cultures et les sentiments nationaux sont toujours bien vivants ; la centralisation castillane est le ‘pilier’ de l’ordre établi, mais un ‘pilier’ strictement politico-militaire : malgré la férocité - et la durée - de la répression franquiste, aucune nation ibérique ne connaît le niveau d’aliénation culturelle, de perte de conscience d’elle-même que connaissent les nations d’Hexagone après 200 ans de bonapartisme et de ‘République une et indivisible’. Toute personne un tant soit peu ‘éveillée’ et progressiste en ‘Espagne’ comprend parfaitement la fonction historique et actuelle de l’‘espagnolisme’ ; alors qu’en ‘France’, non seulement le rôle de l’idéologie ‘républicaine’ et ‘française’ est incompris, mais il est de surcroît célébré et défendu, et les affirmations nationales, même sur la ligne la plus prolétarienne et révolutionnaire qui soit, sont rejetées comme du ‘fascisme masqué’, de l’‘identitarisme de gauche’ etc. etc...
l’histoire) sans le renfort d’une frange aristocratique ‘éclairée’, moderniste. Et surtout - de ce fait même - elle n’a pas connu l’émergence d’une bourgeoisie dominante, qui aurait imposé sa langue et sa culture aux autres bourgeoisies nationales puis, de là, à l’époque des monopoles, aux masses populaires. Les tentatives ont bien existé, au 18e siècle sur le ‘modèle français’, sous Primo de Rivera, puis sous Franco ; sous ce dernier, le castillan s’est effectivement répandu dans toute la péninsule comme langue véhiculaire et ‘d’usage public’ (puisqu’il était interdit d’en parler publiquement une autre) ; mais globalement, cela n’a jamais ‘pris’. Si bien que les langues, les cultures et les sentiments nationaux sont toujours bien vivants ; la centralisation castillane est le ‘pilier’ de l’ordre établi, mais un ‘pilier’ strictement politico-militaire : malgré la férocité - et la durée - de la répression franquiste, aucune nation ibérique ne connaît le niveau d’aliénation culturelle, de perte de conscience d’elle-même que connaissent les nations d’Hexagone après 200 ans de bonapartisme et de ‘République une et indivisible’. Toute personne un tant soit peu ‘éveillée’ et progressiste en ‘Espagne’ comprend parfaitement la fonction historique et actuelle de l’‘espagnolisme’ ; alors qu’en ‘France’, non seulement le rôle de l’idéologie ‘républicaine’ et ‘française’ est incompris, mais il est de surcroît célébré et défendu, et les affirmations nationales, même sur la ligne la plus prolétarienne et révolutionnaire qui soit, sont rejetées comme du ‘fascisme masqué’, de l’‘identitarisme de gauche’ etc. etc...  Cela ne veut pas dire, bien entendu, que tout cela n’ait jamais rencontré de résistances, dans un mouvement communiste dont les dogmatismes obtus sont le cancer latent, toujours prêt à dégénérer : Argala décrivait fort bien ce mélange de ‘nihilisme national’ (au cri de : ‘les prolétaires n’ont pas de patrie !’) et d’espagnolisme objectif, qu’il avait tant de fois rencontré dans son parcours militant.
Cela ne veut pas dire, bien entendu, que tout cela n’ait jamais rencontré de résistances, dans un mouvement communiste dont les dogmatismes obtus sont le cancer latent, toujours prêt à dégénérer : Argala décrivait fort bien ce mélange de ‘nihilisme national’ (au cri de : ‘les prolétaires n’ont pas de patrie !’) et d’espagnolisme objectif, qu’il avait tant de fois rencontré dans son parcours militant.Fondamentalement, deux territoires/populations peuvent sembler faire mentir la théorie du ‘donut Sainte-Alliance’ ; mais il faut, en réalité, simplement étudier la question de plus près : il s’agit du ‘Grand Sud’ Andalousie-Murcie (et, plus largement, des terres mozarabes au sud du Tage et de Valence), et de la nation basque.
Le ‘Grand Sud’ est un territoire d’une arriération économique qui, encore aujourd’hui, évoque plus l’Amérique latine qu’une région d’Europe. Il devrait donc, logiquement, faire partie de la ‘masse de manœuvre’ conservatrice/réactionnaire.
Mais la région du Bas-Guadalquivir (Séville, Cadix) a aussi été, de la fin du 15e au début du 19e siècle, le ‘grand port’ ibérique vers les Amériques, point de départ le plus proche pour les Canaries (d’où l’on ‘prenait’ ensuite l’alizé jusqu’aux Caraïbes) ; bien qu’à partir de Charles Quint, elle
 ait souffert de la concurrence d’Anvers (privilégiée par le souverain flamand). Ceci a donné naissance à une bourgeoisie réduite, mais offensive, plongeant en partie les racines de son ‘humanisme’ dans l’héritage d’al-Andalus : ce n’est pas un hasard si la première Constitution de l’histoire ibérique (1812) fut adoptée à Cadix. Voilà pour l’aspect révolutionnaire bourgeois. Du côté des masses populaires (essentiellement paysannes très pauvres), la réalité sociale sous l’État espagnol a souvent été perçue – non sans raison – comme une réalité coloniale : terre de ‘reconquête’ tardive (entre le 13e siècle et 1492), le ‘Grand Sud’ a vu la liquidation de tous les éléments porteurs d’un peu de développement économique et d’‘esprit moderne’ (juifs, musulmans, puis ‘marranes’ et ‘morisques’), et le ‘plaquage’ d’une aristocratie terrienne (ou, souvent, d’une grande propriété ecclésiastique) vieille-castillane sur le ‘substrat’ populaire mozarabe… Ceci donnera naissance à une masse rurale ultra-pauvre, réellement semi-prolétarienne – évoluant, par la suite, vers le prolétariat rural. D’où, historiquement, un fort sentiment populaire anti-castillan (y
ait souffert de la concurrence d’Anvers (privilégiée par le souverain flamand). Ceci a donné naissance à une bourgeoisie réduite, mais offensive, plongeant en partie les racines de son ‘humanisme’ dans l’héritage d’al-Andalus : ce n’est pas un hasard si la première Constitution de l’histoire ibérique (1812) fut adoptée à Cadix. Voilà pour l’aspect révolutionnaire bourgeois. Du côté des masses populaires (essentiellement paysannes très pauvres), la réalité sociale sous l’État espagnol a souvent été perçue – non sans raison – comme une réalité coloniale : terre de ‘reconquête’ tardive (entre le 13e siècle et 1492), le ‘Grand Sud’ a vu la liquidation de tous les éléments porteurs d’un peu de développement économique et d’‘esprit moderne’ (juifs, musulmans, puis ‘marranes’ et ‘morisques’), et le ‘plaquage’ d’une aristocratie terrienne (ou, souvent, d’une grande propriété ecclésiastique) vieille-castillane sur le ‘substrat’ populaire mozarabe… Ceci donnera naissance à une masse rurale ultra-pauvre, réellement semi-prolétarienne – évoluant, par la suite, vers le prolétariat rural. D’où, historiquement, un fort sentiment populaire anti-castillan (y  compris dans le Sud de la Nouvelle-Castille, la Mancha) et un fort ‘particularisme’ valencien vis-à-vis de la Catalogne ; un fort sentiment anticlérical (catholicisme imposé de force aux masses musulmanes, juives ou ariennes) ; et une forte conscience politique progressiste : ‘libérale avancée’ voire – déjà – républicaine au 19e siècle (pour l’aspect bourgeois, les masses tendant alors à se ranger derrière le ‘libéralisme radical’ de la bourgeoisie, souvent issue de l’ancienne élite andalouse, ‘marrane’ ou ‘morisque’ ‘passée à travers’), culminant dans la ‘révolution cantonaliste’ de 1873-74 ; puis ‘républicaine sociale’, socialiste (l’Andalousie devient un ‘bastion’ du PSOE, créé en 1879), anarcho-syndicaliste et enfin marxiste-léniniste (pour l’aspect prolétarien). Le mouvement national andalou, fondé vers 1915 par Blas Infante, se pose d’entrée de jeu comme républicain fédéraliste, progressiste, démocratique, ‘socialisant’ (Infante avait même des sympathies pour l’anarcho-syndicalisme ; il sera finalement assassiné par la Phalange en août 1936). Pour se faire une idée du niveau de conscience et de lutte de classe en Andalousie, il suffit de regarder vers l’expérience étonnante de Marinaleda : sous la ‘transition démocratique’, des paysans pauvres ont occupé les terres de grands propriétaires fonciers autour de cette localité (ils sont toujours poursuivis en justice dans bien des cas...) et fondé une communauté agricole ‘socialiste’ autogérée. Sous la conduite de leur ‘maire’ (Juan Manuel Sánchez Gordillo), ils mènent à présent des opérations d’‘autoréduction’ (expropriation de nourriture et de produits essentiels dans les supermarchés, redistribués ensuite dans les quartiers populaires dévastés par la crise) dans la région...
compris dans le Sud de la Nouvelle-Castille, la Mancha) et un fort ‘particularisme’ valencien vis-à-vis de la Catalogne ; un fort sentiment anticlérical (catholicisme imposé de force aux masses musulmanes, juives ou ariennes) ; et une forte conscience politique progressiste : ‘libérale avancée’ voire – déjà – républicaine au 19e siècle (pour l’aspect bourgeois, les masses tendant alors à se ranger derrière le ‘libéralisme radical’ de la bourgeoisie, souvent issue de l’ancienne élite andalouse, ‘marrane’ ou ‘morisque’ ‘passée à travers’), culminant dans la ‘révolution cantonaliste’ de 1873-74 ; puis ‘républicaine sociale’, socialiste (l’Andalousie devient un ‘bastion’ du PSOE, créé en 1879), anarcho-syndicaliste et enfin marxiste-léniniste (pour l’aspect prolétarien). Le mouvement national andalou, fondé vers 1915 par Blas Infante, se pose d’entrée de jeu comme républicain fédéraliste, progressiste, démocratique, ‘socialisant’ (Infante avait même des sympathies pour l’anarcho-syndicalisme ; il sera finalement assassiné par la Phalange en août 1936). Pour se faire une idée du niveau de conscience et de lutte de classe en Andalousie, il suffit de regarder vers l’expérience étonnante de Marinaleda : sous la ‘transition démocratique’, des paysans pauvres ont occupé les terres de grands propriétaires fonciers autour de cette localité (ils sont toujours poursuivis en justice dans bien des cas...) et fondé une communauté agricole ‘socialiste’ autogérée. Sous la conduite de leur ‘maire’ (Juan Manuel Sánchez Gordillo), ils mènent à présent des opérations d’‘autoréduction’ (expropriation de nourriture et de produits essentiels dans les supermarchés, redistribués ensuite dans les quartiers populaires dévastés par la crise) dans la région... Le Pays Basque, lui, est à l’origine une terre de petite propriété paysanne libre, encadrée par des ‘lois’ locales séculaires (les fueros, lege zaharrak – ‘vieilles lois’ – en euskara) et un très important petit clergé catholique (l’anticléricalisme y est une bizarrerie presque extra-terrestre). Au 19e siècle et jusqu’au début du 20e, il s’industrialise massivement (à partir, surtout, du centre principal de Bilbao). Sous le ‘despotisme éclairé’ du 18e siècle puis la période révolutionnaire bourgeoise (avec les guerres napoléoniennes et carlistes), ce sont plutôt les provinces intérieures (Navarre, Alava) et les campagnes en général qui sont ‘particularistes’, sur une ligne réactionnaire (traditionaliste, attachée au catholicisme et aux lege zaharrak). Les grandes villes (Bilbao, Donostia, Irùn) et les provinces côtières (Bizkaya, Guipuzkoa) sont dirigées par une bourgeoisie favorable au (relatif) ‘modernisme’ impulsé, le cas échéant, par Madrid (bien sûr, lorsque Madrid est réactionnaire
Le Pays Basque, lui, est à l’origine une terre de petite propriété paysanne libre, encadrée par des ‘lois’ locales séculaires (les fueros, lege zaharrak – ‘vieilles lois’ – en euskara) et un très important petit clergé catholique (l’anticléricalisme y est une bizarrerie presque extra-terrestre). Au 19e siècle et jusqu’au début du 20e, il s’industrialise massivement (à partir, surtout, du centre principal de Bilbao). Sous le ‘despotisme éclairé’ du 18e siècle puis la période révolutionnaire bourgeoise (avec les guerres napoléoniennes et carlistes), ce sont plutôt les provinces intérieures (Navarre, Alava) et les campagnes en général qui sont ‘particularistes’, sur une ligne réactionnaire (traditionaliste, attachée au catholicisme et aux lege zaharrak). Les grandes villes (Bilbao, Donostia, Irùn) et les provinces côtières (Bizkaya, Guipuzkoa) sont dirigées par une bourgeoisie favorable au (relatif) ‘modernisme’ impulsé, le cas échéant, par Madrid (bien sûr, lorsque Madrid est réactionnaire  comme sous Ferdinand VII, ce sont les campagnes/intérieur qui lui sont sympathiques et la bourgeoisie urbaine/côtière qui ‘grogne’, mais sans mettre en avant – à l’époque – une affirmation nationale basque, sinon marginalement). Lorsque dans les années 1830-40, au regard de la situation objective en Europe capitaliste (avec ses deux centres dominants, Paris et Londres), ce traditionalisme historiquement dépassé constitue un obstacle, un frein au développement des forces productives de la péninsule et - par là - du continent tout entier, il va alors devoir par la force des choses disparaître, et c’est dans ce sens que va s’exercer l’autorité castillane avec l’appui de toutes les bourgeoisies nationales ibériques (y compris la basque) ; autorité qui prend garde, toutefois, à contenir les tendances trop ‘radicales’ de Catalogne et du Sud. Au regard du développement global, euro-méditerranéen du capitalisme et donc des forces productives, cela est progressiste comme pourra l’être la conquête de l’Italie méridionale par le Piémont ou même - expliqueront Marx et Engels - la conquête de l’Algérie par la ‘France’. Pour autant, cela n’en reste pas moins une oppression nationale qui voit forcément se lever une résistance ; même si celle-ci, à ce moment-là, est malheureusement réactionnaire, tournée vers le passé et donc ‘perdante’ : ‘paradoxe’ que seule la dialectique marxiste peut permettre de saisir.
comme sous Ferdinand VII, ce sont les campagnes/intérieur qui lui sont sympathiques et la bourgeoisie urbaine/côtière qui ‘grogne’, mais sans mettre en avant – à l’époque – une affirmation nationale basque, sinon marginalement). Lorsque dans les années 1830-40, au regard de la situation objective en Europe capitaliste (avec ses deux centres dominants, Paris et Londres), ce traditionalisme historiquement dépassé constitue un obstacle, un frein au développement des forces productives de la péninsule et - par là - du continent tout entier, il va alors devoir par la force des choses disparaître, et c’est dans ce sens que va s’exercer l’autorité castillane avec l’appui de toutes les bourgeoisies nationales ibériques (y compris la basque) ; autorité qui prend garde, toutefois, à contenir les tendances trop ‘radicales’ de Catalogne et du Sud. Au regard du développement global, euro-méditerranéen du capitalisme et donc des forces productives, cela est progressiste comme pourra l’être la conquête de l’Italie méridionale par le Piémont ou même - expliqueront Marx et Engels - la conquête de l’Algérie par la ‘France’. Pour autant, cela n’en reste pas moins une oppression nationale qui voit forcément se lever une résistance ; même si celle-ci, à ce moment-là, est malheureusement réactionnaire, tournée vers le passé et donc ‘perdante’ : ‘paradoxe’ que seule la dialectique marxiste peut permettre de saisir. Mais cette réalité s’inverse totalement entre la fin de la dernière guerre carliste (1876) et le début de la guerre civile antifasciste (1936). Dès lors, et jusqu’à nos jours, ce sont les provinces côtières urbanisées qui sont le plus massivement abertzale sur une ligne progressiste radicale voire révolutionnaire, et les provinces rurales intérieures (surtout le Sud de l’Alava et de la Navarre) qui sont conservatrices/réactionnaires et… ‘espagnolistes’ (les carlistes, au demeurant, n’étaient nullement abertzale : ils luttaient pour une ‘Espagne’ unie mais traditionaliste, respectant les ‘vieilles lois’ médiévales des nations constitutives). Autrement dit, à travers le processus de la ‘révolution industrielle basque’ (qui correspond globalement à cette période), l’affirmation nationale a changé de camp : elle est passée de majoritairement rurale et ‘de droite’ à majoritairement urbaine et ‘de gauche’. Il faut dire que la petite paysannerie propriétaire, qui caractérisait la grande majorité de la société basque au 19e siècle, est entre temps devenue largement… classe ouvrière et a rencontré dans les quartiers ouvriers et les usines, au contact des travailleurs ‘immigrés’ méridionaux, les idées socialistes, marxistes ou anarcho-syndicalistes qui vont influencer l’abertzalisme (évolution exprimée notamment par la fondation en 1930 de l’Action Nationaliste Basque – Eusko Abertzale Ekintza – sur une ligne socialiste, rompant avec le conservatisme catholique – évoluant, lui, vers la démocratie-chrétienne – du PNV et aujourd’hui… illégale en vertu de la ‘loi des partis’ de 2002, comme ‘soutien’ présumé du ‘terrorisme d’ETA’).
Mais cette réalité s’inverse totalement entre la fin de la dernière guerre carliste (1876) et le début de la guerre civile antifasciste (1936). Dès lors, et jusqu’à nos jours, ce sont les provinces côtières urbanisées qui sont le plus massivement abertzale sur une ligne progressiste radicale voire révolutionnaire, et les provinces rurales intérieures (surtout le Sud de l’Alava et de la Navarre) qui sont conservatrices/réactionnaires et… ‘espagnolistes’ (les carlistes, au demeurant, n’étaient nullement abertzale : ils luttaient pour une ‘Espagne’ unie mais traditionaliste, respectant les ‘vieilles lois’ médiévales des nations constitutives). Autrement dit, à travers le processus de la ‘révolution industrielle basque’ (qui correspond globalement à cette période), l’affirmation nationale a changé de camp : elle est passée de majoritairement rurale et ‘de droite’ à majoritairement urbaine et ‘de gauche’. Il faut dire que la petite paysannerie propriétaire, qui caractérisait la grande majorité de la société basque au 19e siècle, est entre temps devenue largement… classe ouvrière et a rencontré dans les quartiers ouvriers et les usines, au contact des travailleurs ‘immigrés’ méridionaux, les idées socialistes, marxistes ou anarcho-syndicalistes qui vont influencer l’abertzalisme (évolution exprimée notamment par la fondation en 1930 de l’Action Nationaliste Basque – Eusko Abertzale Ekintza – sur une ligne socialiste, rompant avec le conservatisme catholique – évoluant, lui, vers la démocratie-chrétienne – du PNV et aujourd’hui… illégale en vertu de la ‘loi des partis’ de 2002, comme ‘soutien’ présumé du ‘terrorisme d’ETA’).Si l’on schématise, l’‘Espagne’ des guerres carlistes, du processus menant à l’État contemporain, c’est :
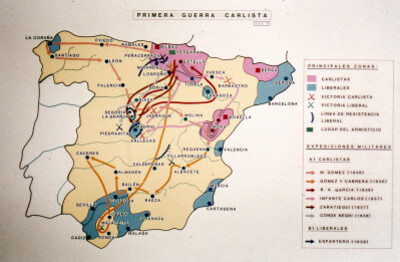 - Au centre, la classe dominante madrilène, ‘aristocratie de Cour’ et grande-bourgeoisie, qui ‘pilote’ l’État ; avec ses tendances plus 'libérales avancées’ ou plus 'modérées-conservatrices’. Autour d’elle, la ruralité de la Meseta est sa ‘masse de manœuvre’.
- Au centre, la classe dominante madrilène, ‘aristocratie de Cour’ et grande-bourgeoisie, qui ‘pilote’ l’État ; avec ses tendances plus 'libérales avancées’ ou plus 'modérées-conservatrices’. Autour d’elle, la ruralité de la Meseta est sa ‘masse de manœuvre’.- La bourgeoisie de la côte nord-atlantique, qui est globalement dans le même schéma.
- La ruralité du Nord, le long des chaînes pyrénéenne et cantabrique : Galice, León, Vieille-Castille, Navarre et ‘Pays Basque intérieur’ en général, ou encore Haut-Aragon ; qui est le ‘bastion’ du conservatisme, du traditionalisme, solidement encadré par l’aristocratie locale et l’Église, et l’attachement basque aux fueros : ‘bastion’ que Madrid, si elle veut que l’‘Espagne’ suive le reste de l’Europe sur le chemin de la modernité, doit briser (dans ce cas, ce sont des caudillos ‘libéraux avancés’ qui sont mis en avant).
- Au Sud et à l’Est, une bourgeoisie ‘libérale avancée’ et des masses aux luttes démocratiques parfois radicales ; choses qu’il s’agit de ‘contenir’ (ce sont alors des caudillos ‘modérés-conservateurs’ qui tiennent le pouvoir à Madrid).
L’‘Espagne’ de l’époque de la révolution prolétarienne, si l’on prend le moment type des années 1930, c’est :
 - Galice, León, Vieille-Castille, Navarre-Alava, Haut-Aragon : classe dominante réactionnaire, masses populaires ‘sous contrôle’ en ce sens (encore qu'existe en Galice une petite force autonomiste de gauche républicaine, l'ORGA).
- Galice, León, Vieille-Castille, Navarre-Alava, Haut-Aragon : classe dominante réactionnaire, masses populaires ‘sous contrôle’ en ce sens (encore qu'existe en Galice une petite force autonomiste de gauche républicaine, l'ORGA).- Sud, Pays catalans, côte nord-atlantique du Pays Basque aux Asturies : les masses sont ‘rouges’ ; la bourgeoisie compte un fort courant démocratique, républicain, réformiste ; la bourgeoisie réactionnaire est isolée.
- Grand Madrid : les masses sont rouges, la classe dominante est conservatrice ou républicaine ‘modérée’ - elle attend, en majorité, l’‘armée de secours’ franquiste (le général Mola appellera ces éléments réactionnaires la "cinquième colonne", s'ajoutant aux quatre colonnes franquistes convergeant vers la capitale, d'où l'expression devenue courante).
Dans les deux cas, la centralisation castillane autoritaire est la ‘clé de voûte’ de l’édifice dominant, qu’il s’agisse de mener une politique ‘modernisatrice mais pas trop’, ou qu’il s’agisse de défendre une ‘tranchée’ du capitalisme mondial contre un détachement local de la révolution prolétarienne.
Ce système, ‘refondé’ par le ‘pacte’ constitutionnel de 1978, est toujours fondamentalement le même aujourd’hui.
Un autre facteur important, qu’il n’est pas possible de laisser de côté, c’est, dans le contexte de la ‘révolution industrielle espagnole’ entre le milieu du 19e siècle et la fin du franquisme (1975), les très importantes migrations internes de travailleurs pour les besoins du Capital ; migrations surtout du Sud et du Centre de la péninsule (au sud du Tage et de Valence) vers le Grand Madrid, la Catalogne et la côte nord-atlantique (Pays Basque, Cantabrie, Asturies). Globalement, il est possible de dire qu’une partie (plus ou moins importante, mais jamais négligeable) de ce prolétariat migrant a ‘fusionné’ politiquement avec le prolétariat de la nation d’accueil, sur une ligne à la fois de lutte de classe anticapitaliste et d’affirmation nationale ; tandis qu’une autre partie est restée ‘prisonnière’ de l’espagnolisme ‘de gauche’ (PSOE/UGT surtout, ou PCE/CC.OO eurocommuniste carrilliste qui forment aujourd’hui ‘Izquierda Unida’ (Gauche unie) avec les écolos, sans oublier de nombreux groupes trotskystes voire ‘ML’ ou même ‘maoïstes’ objectivement espagnolistes, à coup de ‘nihilisme national’).
Aujourd’hui, comme on l’a dit, l’État espagnol est plongé comme toute l’Europe du Sud dans une crise économique et sociale sans précédent dans son histoire.
 La crise générale du capitalisme, commençant dans le pays à peu près concomitamment avec la mort de Franco, avait quelque peu ralenti l’essor économique entamé durant les quinze dernières années de son règne ; cependant, l’‘Espagne’ avait toujours gardé une croissance capitaliste (du PIB) supérieure à celle des autres pays européens et jamais connu de véritable récession (hormis en 1992-93) ; en particulier, entre 1995 et 2008, elle avait connu des taux de croissance très élevés, de l’ordre de 4 à 5% voire parfois approchant les 6% du PIB (vers 2000). Tout ceci s’effondre à partir de fin 2008, la récession atteignant... - 4% en 2009 (!) et la croissance restant proche de zéro aujourd’hui. Le chômage, toujours structurellement fort même dans les périodes de forte croissance (économie fortement basée sur le bâtiment, le tourisme estival, l’agriculture saisonnière), explose pour avoisiner les... 5 millions de chômeurs/euses pour un État moins peuplé que la ‘France’, soit près de 25% de la population active (plus du tiers des moins de 30 ans). Dans ce contexte, les contradictions de classe deviennent évidemment explosives, mais aussi les contradictions inter-bourgeoises sur une base (avant tout) nationale. Le sévère ‘Empereur germanique’ du bloc impérialiste UE, suivi de son ‘co-empereur’ BBR qui n’en mène pas large (la prébende publique étant aussi un ‘pilier’ de son système), exige une ‘cure d’austérité’ du ‘flamboyant’ semi-impérialisme vassal hispanique (qui a, il faut le dire aussi, beaucoup dépensé dans une réelle modernisation de ses infrastructures - routes, rail, ports, transport urbain etc.).
La crise générale du capitalisme, commençant dans le pays à peu près concomitamment avec la mort de Franco, avait quelque peu ralenti l’essor économique entamé durant les quinze dernières années de son règne ; cependant, l’‘Espagne’ avait toujours gardé une croissance capitaliste (du PIB) supérieure à celle des autres pays européens et jamais connu de véritable récession (hormis en 1992-93) ; en particulier, entre 1995 et 2008, elle avait connu des taux de croissance très élevés, de l’ordre de 4 à 5% voire parfois approchant les 6% du PIB (vers 2000). Tout ceci s’effondre à partir de fin 2008, la récession atteignant... - 4% en 2009 (!) et la croissance restant proche de zéro aujourd’hui. Le chômage, toujours structurellement fort même dans les périodes de forte croissance (économie fortement basée sur le bâtiment, le tourisme estival, l’agriculture saisonnière), explose pour avoisiner les... 5 millions de chômeurs/euses pour un État moins peuplé que la ‘France’, soit près de 25% de la population active (plus du tiers des moins de 30 ans). Dans ce contexte, les contradictions de classe deviennent évidemment explosives, mais aussi les contradictions inter-bourgeoises sur une base (avant tout) nationale. Le sévère ‘Empereur germanique’ du bloc impérialiste UE, suivi de son ‘co-empereur’ BBR qui n’en mène pas large (la prébende publique étant aussi un ‘pilier’ de son système), exige une ‘cure d’austérité’ du ‘flamboyant’ semi-impérialisme vassal hispanique (qui a, il faut le dire aussi, beaucoup dépensé dans une réelle modernisation de ses infrastructures - routes, rail, ports, transport urbain etc.). Est-il besoin de rappeler, ces deux dernières années, des mouvements comme celui des Indignad@s (expression de la jeunesse ‘moyenne-inférieure’ paupérisée), avec ses ‘séquelles’ mondiales comme le mouvement Occupy aux États-Unis ; ou, côté prolétarien, le magnifique (1-2-3-4) mouvement de type semi-armé (bien qu’avec des armes non-mortelles) des mineurs asturiens et léonais, mettant en sérieuse difficulté les forces de sécurité du Capital dans ces deux nations, renouant avec le souvenir glorieux de la Révolution asturienne de 1934 ? Parallèlement, il faut le dire aussi, le mouvement de type révolutionnaire qui était jusque-là le plus avancé de la péninsule, le Mouvement de Libération Nationale Basque (MLNV), a vu le triomphe d’une ligne petite-bourgeoise réformiste, qui a ‘fait son nid’ au cours de la dernière décennie, dans un contexte d’échec croissant de la stratégie militaire d’ETA (la branche armée du mouvement), jusqu’au ‘dépôt des armes’ définitif de cette dernière. Mais cette tentative de liquidation réformiste ‘à l’irlandaise’ se trouve en complet décalage avec la réalité objective des masses populaires et de la lutte des classes, en Euskal Herria (EH) comme dans toute la péninsule ; et passé l’‘éblouissement’ des premiers - apparents - ‘triomphes’ électoraux, la contestation va inévitablement se lever avec force (on la voit déjà se lever ça et là, dans un mouvement de libération profondément imprégné de marxisme révolutionnaire) ; car gagner les élections, c’est bien, mais les ‘likis’ (liquidateurs réformistes) vont maintenant devoir gérer la crise générale capitaliste (d'ailleurs, le recul électoral 'Bildu' est déjà net, comparé aux élections municipales et générales de 2011)...
Est-il besoin de rappeler, ces deux dernières années, des mouvements comme celui des Indignad@s (expression de la jeunesse ‘moyenne-inférieure’ paupérisée), avec ses ‘séquelles’ mondiales comme le mouvement Occupy aux États-Unis ; ou, côté prolétarien, le magnifique (1-2-3-4) mouvement de type semi-armé (bien qu’avec des armes non-mortelles) des mineurs asturiens et léonais, mettant en sérieuse difficulté les forces de sécurité du Capital dans ces deux nations, renouant avec le souvenir glorieux de la Révolution asturienne de 1934 ? Parallèlement, il faut le dire aussi, le mouvement de type révolutionnaire qui était jusque-là le plus avancé de la péninsule, le Mouvement de Libération Nationale Basque (MLNV), a vu le triomphe d’une ligne petite-bourgeoise réformiste, qui a ‘fait son nid’ au cours de la dernière décennie, dans un contexte d’échec croissant de la stratégie militaire d’ETA (la branche armée du mouvement), jusqu’au ‘dépôt des armes’ définitif de cette dernière. Mais cette tentative de liquidation réformiste ‘à l’irlandaise’ se trouve en complet décalage avec la réalité objective des masses populaires et de la lutte des classes, en Euskal Herria (EH) comme dans toute la péninsule ; et passé l’‘éblouissement’ des premiers - apparents - ‘triomphes’ électoraux, la contestation va inévitablement se lever avec force (on la voit déjà se lever ça et là, dans un mouvement de libération profondément imprégné de marxisme révolutionnaire) ; car gagner les élections, c’est bien, mais les ‘likis’ (liquidateurs réformistes) vont maintenant devoir gérer la crise générale capitaliste (d'ailleurs, le recul électoral 'Bildu' est déjà net, comparé aux élections municipales et générales de 2011)...Périphérie d’une Europe capitaliste dominée par la ‘banane bleue’ (Italie du Nord, ‘France’ du Nord et de l’Est, Suisse, Allemagne, Bénélux, Angleterre), l’État espagnol, en conformité totale avec les analyses de Servir le Peuple, est aujourd’hui l'un de ceux (avec la Grèce) où le niveau de la lutte de classe prolétarienne atteint ses plus hauts sommets. Et cette lutte de classe, on l’a dit, est devenue de par l’histoire totalement indissociable de la réaffirmation nationale des peuples niés par la construction de l’État moderne et contemporain. S’il peut exister, dans la ‘gauche révolutionnaire’ (marxiste ou libertaire), des courants ‘espagnolistes objectifs’, c’est tout simplement que... comme ici en Hexagone, ces courants sont composés ou dirigés par des petits (voire moyens) bourgeois
 ‘radicaux’, dont l’‘Espagne’ comme État contemporain est la condition d’existence de classe. Il y a en ‘Espagne’ cette particularité, unique en Europe, que sont les libérationistes révolutionnaires... castillans, avec leur drapeau violet frappé de l’étoile rouge et du château (castillo) de Castille, se plaçant dans le prolongement à un niveau supérieur (prolétarien) du mouvement comunero du 16e siècle, mouvement bourgeois-populaire des villes castillanes contre la consolidation de l’État moderne par (à l’époque) un souverain étranger, le flamand et empereur germanique Charles Quint... ce qui n’est pas sans évoquer, aujourd'hui, la très actuelle domination économique de la ‘banane bleue’ européenne sur la péninsule. Autrement dit, les prolétaires révolutionnaires de la nation centrale comprennent parfaitement la fonction de l’État espagnol, avec sa centralité réactionnaire de l’oligarchie castillane, vis-à-vis des masses populaires de toutes les nations, y compris... de Castille. Ils prônent généralement, comme à peu près tous les libérationistes nationaux de la péninsule (sauf peut-être au Pays Basque, à dominante séparatiste), une destruction de l’État ‘espagnol’ oppresseur et une refondation complète des relations sociales territoriales, sur une base confédérale ibérique (pourquoi exclure le Portugal ?), égalitaire entre les peuples (certains, en Aragon ou en Catalogne, y incluraient même volontiers l’Occitanie...). Une conception favorisée par une riche expérience historique en ce sens : le mouvement - on l'a dit - comunero du 16e siècle, la Révolution cantonaliste (républicaine ultra-démocratique et fédéraliste) dans le contexte de 'dislocation de l'État' en 1873-74, ou encore la grande autonomie des fronts et des régions républicaines ('fragmentées' et isolées par les zones franquistes) durant la Guerre civile - Generalitat catalane et République d'Euzkadi, mais aussi le Conseil régional de défense d'Aragon (principalement CNT avec des éléments UGT et POUM) ou encore le Conseil souverain d'Asturies et León de Belarmino Tomás (1936-37 l'un et l'autre).
‘radicaux’, dont l’‘Espagne’ comme État contemporain est la condition d’existence de classe. Il y a en ‘Espagne’ cette particularité, unique en Europe, que sont les libérationistes révolutionnaires... castillans, avec leur drapeau violet frappé de l’étoile rouge et du château (castillo) de Castille, se plaçant dans le prolongement à un niveau supérieur (prolétarien) du mouvement comunero du 16e siècle, mouvement bourgeois-populaire des villes castillanes contre la consolidation de l’État moderne par (à l’époque) un souverain étranger, le flamand et empereur germanique Charles Quint... ce qui n’est pas sans évoquer, aujourd'hui, la très actuelle domination économique de la ‘banane bleue’ européenne sur la péninsule. Autrement dit, les prolétaires révolutionnaires de la nation centrale comprennent parfaitement la fonction de l’État espagnol, avec sa centralité réactionnaire de l’oligarchie castillane, vis-à-vis des masses populaires de toutes les nations, y compris... de Castille. Ils prônent généralement, comme à peu près tous les libérationistes nationaux de la péninsule (sauf peut-être au Pays Basque, à dominante séparatiste), une destruction de l’État ‘espagnol’ oppresseur et une refondation complète des relations sociales territoriales, sur une base confédérale ibérique (pourquoi exclure le Portugal ?), égalitaire entre les peuples (certains, en Aragon ou en Catalogne, y incluraient même volontiers l’Occitanie...). Une conception favorisée par une riche expérience historique en ce sens : le mouvement - on l'a dit - comunero du 16e siècle, la Révolution cantonaliste (républicaine ultra-démocratique et fédéraliste) dans le contexte de 'dislocation de l'État' en 1873-74, ou encore la grande autonomie des fronts et des régions républicaines ('fragmentées' et isolées par les zones franquistes) durant la Guerre civile - Generalitat catalane et République d'Euzkadi, mais aussi le Conseil régional de défense d'Aragon (principalement CNT avec des éléments UGT et POUM) ou encore le Conseil souverain d'Asturies et León de Belarmino Tomás (1936-37 l'un et l'autre).Tout cela s'est par exemple traduit, aux dernières élections européennes de 2009, par la liste Initiative internationaliste - Solidarité entre les Peuples (article Wikipédia en castillan), regroupant diverses forces marxistes et libérationistes marxisantes (y compris castillanes, celles-ci étant même à l'origine de l'initiative) et appuyée notamment par la gauche abertzale basque, dont l'interdiction venait de permettre aux espagnolistes du PSOE et du PP de gouverner la Communauté autonome basque (CAV) pour la première fois depuis 30 ans. L’État espagnol tenta de la faire illégaliser puis, obligé de reculer sous la pression (notamment) des institutions et de ses partenaires européens... organisa une fraude massive et éhontée (lire ici et ici) digne d'une république bananière, portant potentiellement sur des dizaines de milliers de bulletins (!!!) ce qui priva sans doute l'Initiative d'un élu à Strasbourg (il fallait 2%, la liste en a obtenu 1,15). Ces faits sont largement passés inaperçus à l'époque de ce côté-ci des Pyrénées, et tombés depuis dans l'oubli le plus total...
 Dans le même temps, la crise générale capitaliste (entrée dans une phase terminale) et l’’austérité’ conséquente conduisent à un ébranlement, une remise en cause brutale du ‘pacte’ inter-bourgeois de 1978. Trop faibles militairement pour se passer de l’État central, face aux mouvements sociaux qui les secouent, les bourgeoisies du Nord-Ouest (Galice, Asturies, Cantabrie, León) et du Sud (Andalousie, Murcie etc.) se gardent bien de le remettre en cause (d’autant plus que dans le dernier cas, on l’a dit, l’oligarchie est une oligarchie castillane ‘plaquée’ de manière coloniale sur la population ‘re’-conquise). Mais, dans un système de (toute relative) ‘solidarité pan-ibérique’, les puissantes bourgeoisies basque et catalane ne veulent plus ‘payer pour le Sud’, et revendiquent une autonomie élargie (fiscale, notamment) pouvant aller jusqu’à l’indépendance. Et les masses populaires, dominées par une ligne petite-bourgeoise, ne sont malheureusement pas ‘vierges’ de ce type de sentiment : lorsque le ‘modèle social’ vole en éclat sous les coups de l’’austérité’, chacun, dans les masses spontanément économistes (dixit Lénine), tente naturellement de ‘tirer la couverture à lui’. En réponse, les masses populaires méridionales (ou du Nord-Ouest galicien-asturien-léonais, également assez déshérité) vont naturellement s’insurger contre l’’égoïsme’ basque et catalan, et se ranger derrière la ‘gauche’ bourgeoise espagnoliste de type ‘fédéraliste’ (PSOE, IU).
Dans le même temps, la crise générale capitaliste (entrée dans une phase terminale) et l’’austérité’ conséquente conduisent à un ébranlement, une remise en cause brutale du ‘pacte’ inter-bourgeois de 1978. Trop faibles militairement pour se passer de l’État central, face aux mouvements sociaux qui les secouent, les bourgeoisies du Nord-Ouest (Galice, Asturies, Cantabrie, León) et du Sud (Andalousie, Murcie etc.) se gardent bien de le remettre en cause (d’autant plus que dans le dernier cas, on l’a dit, l’oligarchie est une oligarchie castillane ‘plaquée’ de manière coloniale sur la population ‘re’-conquise). Mais, dans un système de (toute relative) ‘solidarité pan-ibérique’, les puissantes bourgeoisies basque et catalane ne veulent plus ‘payer pour le Sud’, et revendiquent une autonomie élargie (fiscale, notamment) pouvant aller jusqu’à l’indépendance. Et les masses populaires, dominées par une ligne petite-bourgeoise, ne sont malheureusement pas ‘vierges’ de ce type de sentiment : lorsque le ‘modèle social’ vole en éclat sous les coups de l’’austérité’, chacun, dans les masses spontanément économistes (dixit Lénine), tente naturellement de ‘tirer la couverture à lui’. En réponse, les masses populaires méridionales (ou du Nord-Ouest galicien-asturien-léonais, également assez déshérité) vont naturellement s’insurger contre l’’égoïsme’ basque et catalan, et se ranger derrière la ‘gauche’ bourgeoise espagnoliste de type ‘fédéraliste’ (PSOE, IU). Aux dernières élections basques et catalanes, en tout cas, l'on observe 1°/ un recul des nationalistes grands-bourgeois PNV et CiU (respectivement -3 et -12 sièges), porteurs ‘historiques’ (depuis 1975) de l’affirmation nationale, mais passant également pour des ‘partis de l’austérité’ ; il faut dire que, s'ils sont généralement considérés comme de 'centre-droit' dans une péninsule où 'droite dure' rime inévitablement avec 'espagnolisme', plus grand chose, dans leur conception du monde, ne les distingue en réalité du PP, avec lequel il n'hésitent d'ailleurs plus (depuis les années 1990) à s'allier ; 2°/ une forte poussée du nationalisme ‘de gauche’ petit-bourgeois (la bourgeoisie nationale proprement dite, et non la bourgeoisie ‘intégrée’ dans le ‘système Espagne’ de 1978), avec Bildu en EH (malgré, on l'a dit, un recul assez net par rapport aux échéances de 2011) et la Gauche républicaine (ERC) ou la Candidature d’Unité populaire (CUP) en Catalogne (+16 et +11 sièges, la CUP faisant son entrée avec 3 élus) ; 3°/ une légère poussée, en Catalogne, de la gauche ‘radicale’ espagnoliste (ICV), avec +3 sièges ; 4°/ un effondrement du PSOE, avec sa ligne ‘fédéraliste’ (-9 et -8 élus), ainsi qu’un léger recul du PP (ligne espagnoliste dure) en Euskadi ; 5°/ en Catalogne, en revanche, un léger progrès du PP (+1) et du ‘Parti des Citoyens’ (espagnoliste ‘centriste’, qui gagne 6 élus), ce qui montre que le camp espagnoliste ‘durcit’ ses positions (en EH il est discrédité pour avoir gouverné ces trois dernières années, en coalition PSOE-PP, alors que la gauche abertzale était sous le coup de la ‘loi des partis’).
Aux dernières élections basques et catalanes, en tout cas, l'on observe 1°/ un recul des nationalistes grands-bourgeois PNV et CiU (respectivement -3 et -12 sièges), porteurs ‘historiques’ (depuis 1975) de l’affirmation nationale, mais passant également pour des ‘partis de l’austérité’ ; il faut dire que, s'ils sont généralement considérés comme de 'centre-droit' dans une péninsule où 'droite dure' rime inévitablement avec 'espagnolisme', plus grand chose, dans leur conception du monde, ne les distingue en réalité du PP, avec lequel il n'hésitent d'ailleurs plus (depuis les années 1990) à s'allier ; 2°/ une forte poussée du nationalisme ‘de gauche’ petit-bourgeois (la bourgeoisie nationale proprement dite, et non la bourgeoisie ‘intégrée’ dans le ‘système Espagne’ de 1978), avec Bildu en EH (malgré, on l'a dit, un recul assez net par rapport aux échéances de 2011) et la Gauche républicaine (ERC) ou la Candidature d’Unité populaire (CUP) en Catalogne (+16 et +11 sièges, la CUP faisant son entrée avec 3 élus) ; 3°/ une légère poussée, en Catalogne, de la gauche ‘radicale’ espagnoliste (ICV), avec +3 sièges ; 4°/ un effondrement du PSOE, avec sa ligne ‘fédéraliste’ (-9 et -8 élus), ainsi qu’un léger recul du PP (ligne espagnoliste dure) en Euskadi ; 5°/ en Catalogne, en revanche, un léger progrès du PP (+1) et du ‘Parti des Citoyens’ (espagnoliste ‘centriste’, qui gagne 6 élus), ce qui montre que le camp espagnoliste ‘durcit’ ses positions (en EH il est discrédité pour avoir gouverné ces trois dernières années, en coalition PSOE-PP, alors que la gauche abertzale était sous le coup de la ‘loi des partis’).Dans les deux cas, la gauche nationaliste petite-bourgeoise devient la deuxième force parlementaire devant le PSOE.
Il va de soi, comme cela a déjà été expliqué ici, que l’’indépendance’ prônée par ces forces (qui appellent à des référendums) ne saurait être que 100% bourgeoise et réactionnaire, ne serait-ce que (déjà) par la démarche ‘ne plus payer pour le Sud’ qui les porte ; et que dans tous les cas, un Pays Basque (avec ou sans la Navarre ?) et une Catalogne ‘indépendants’, dès lors que cela ne s’inscrit pas dans une véritable libération nationale expression locale de la révolution prolétarienne européenne et mondiale, resteraient totalement intégrés dans le ‘système Europe’ sous domination franco-allemande. Peut-être – peut-on se prendre à rêver – que face à la montée des luttes populaires, ces bourgeoisies devenues ‘indépendantes’ se retrouveraient rapidement démunies sans l’appui politico-militaire de Madrid… Mais, quoi qu’il en soit, cette poussée des aspirations ‘centrifuges’, faisant voler en éclat le ‘pacte’ post-franquiste, montre bien que l’’Espagne’, comme le reste de l’Europe et de la planète, est bel et bien entrée dans la fin d’un monde.
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
Nous sommes les Nouveaux Partisans - L'Ora es Venguda

 ]
]





